Éloge de l’idiotie FAUX TITRE 343 Etudes de langue et littérature françaises pu
Éloge de l’idiotie FAUX TITRE 343 Etudes de langue et littérature françaises publiées sous la direction de Keith Busby, †M.J. Freeman, Sjef Houppermans et Paul Pelckmans Marie Berne AMSTERDAM - NEW YORK, NY 2009 Éloge de l’idiotie Pour une nouvelle rhétorique chez Breton, Faulkner, Beckett et Cortázar Illustration couverture: “Twelve outlines of idiots” de Johann Caspar Lavater (Essays on physiognomy 1789) © Wellcome Library, Londres. Maquette couverture: Pier Post. The paper on which this book is printed meets the requirements of ‘ISO 9706: 1994, Information and documentation - Paper for documents - Requirements for permanence’. Le papier sur lequel le présent ouvrage est imprimé remplit les prescriptions de ‘ISO 9706: 1994, Information et documentation - Papier pour documents - Prescriptions pour la permanence’. ISBN: 978-90-420-2753-4 E-Book ISBN: 978-90-420-2754-1 © Editions Rodopi B.V., Amsterdam - New York, NY 2009 Printed in The Netherlands Remerciements Au Canada, je remercie Ralph Sarkonak pour la confiance gé- néreuse qu’il a toujours manifestée en mon travail, soutenu par son esprit méticuleux, ses critiques et ses inspirations. Je salue également Carlo Testa et André Lamontagne dont les encouragements et exacti- tudes se sont avérés précieux tout au long de mes recherches. En France, et pour ce qui est de l’origine du livre, j’adresse toute ma gratitude à Alain Roger qui a fait naître en moi le goût de la recherche esthétique, à Valérie Deshoulières qui a été la première per- sonne à me parler d’idiotie, et à Françoise Gaillard qui s’est intéressée à cette étude et a donné de précieux conseils. Ailleurs, – parce qu’il y a tout le monde dans l’histoire – je salue et remercie ma famille et mes amis, notamment Freddy, Astrid, William, Émilie, Doo-seung, Alexis, Alice et puis surtout, Jack. A mon frère Jean-Christophe Todo el diá, sentados en el patio, en un banco, estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio Mazzini-Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos, y volvían la cabeza con toda la boca abierta. Horacio Quiroga, « La gallina degollada », A la deriva y otros cuentos (Toute la journée, assis dans la cour, les quatre enfants idiots des Mazzini-Ferraz se tenaient sur un banc. La langue pendante entre les lèvres, le re- gard hébété, ils remuaient la tête la bouche grande ouverte. « La poule égorgée », Contes d’amour, de folie et de mort) Introduction […] come gli mostra il libro che far debbia ; e si sciolse il palazzo in fumo e in nebbia. Ludovico Ariosto, Orlando furioso, XXII, 23 ([…] comme le livre lui montrait qu’il devait faire, et le palais partit en fumée et brouillard. Roland furieux XXII, 23) Bella donna Oui, voilà – ne rien comprendre… Sinon, au bout du compte, on pourrait bien comprendre de tra- vers. Zéno Bianu, L’Idiot, dernière nuit « Le peintre est légèrement en retrait du tableau. Il jette un coup d’œil sur le modèle ; peut-être s’agit-il d’ajouter une dernière touche, mais il se peut aussi que le premier trait encore n’ait été posé. » (Foucault Les Mots et les Choses 19)1 Pourtant, d’une façon ou d’une autre, le sujet de la toile devance la représentation. Au fond d’un bois, dans le secret et la solitude, une femme est prise de convulsions. En pleine clairière, à l’écart, chantant d’étranges mélodies, elle cueille des racines et capture des insectes pour ses préparations qui guérissent le mal. Elle invoque l’anti-Dieu. Arriérée et démente, voyante et errante, victime et puissante, au cœur des hommes qui la rejettent et l’appellent tout ensemble, se dresse cette 1 Toutes les références aux ouvrages cités seront données entre parenthèses avec le nom de l’auteur. Si plus d’un ouvrage du même auteur paraît dans la bibliographie, le nom de l’auteur sera remplacé par le titre en question. Enfin, et c’est le cas ici, lorsque l’identité de l’auteur n’est pas mentionnée auparavant, nous inscrivons entre parenthè- ses son nom puis le titre de l’œuvre. ELOGE DE L’IDIOTIE 12 enfant de la nuit, sur un « pont entre les deux mondes » (Michelet 98)2 – la sorcière. Lorsque qu’en 1861 Jules Michelet évoque la femme damnée du Moyen Âge, il crée un recueil dont le genre littéraire se situe entre roman et précis historique, entre art et science, car selon Roland Barthes dans son livre sur l’historien, « ce n’est pas la réflexion qui corrige l’instinct, c’est le cœur, l’intuition qui donne sa forme complète à l’idée » (Michelet 137). Œuvre romantique, La Sorcière présente le personnage d’abord comme victime dans un contexte historique particulier pour faire ensuite la démonstration progressive de ses dons puis du rôle irremplaçable qu’elle joue au sein de la communauté. L’historien revisite une vaste période de l’histoire de France : de la mort du dieu Pan, c’est-à-dire le début de la domination de l’ère chrétienne, jusqu’à 1730. C’est l’atmosphère négative qui importe d’emblée lors de la naissance de la sorcière. Dès les premières lignes du livre, Michelet explique : « D’où date la Sorcière ? Je dis sans hésiter “Des temps du désespoir.” » (35) La crise se manifeste par la perte de la foi, du lien sacré avec les dieux et la nature. On y substitue le surnaturel, et les hommes font toutes sortes « de rêves étranges, riches de miracles, de folies absurdes et charmantes » (Viallaneix 21). Le malaise envahissant se traduit en comportements étranges comme la « danse de Saint-Guy », « un acheminement vers l’épilepsie » dont les conséquences sont terribles : « L’Europe couverte de fous, de furieux, d’idiots ! » (111) C’est aux maladies des siècles que l’on doit l’apparition des sorcières, lesquelles « offrent au désespoir collectif, non une délivrance, mais une compensation » (Viallaneix 22). Dans un monde bouleversé, un individu marginal, singulier et rejeté est né au sein de la communauté qui manifeste ainsi un certain besoin. En incarnant précisément les travers du monde, la sorcière exprime une difformité qui dérange les esprits tout en les attirant « par un respect mêlé de crainte » (33), difformité qu’il convient d’écarter. Puisque la sorcière est marginale du fait de son sexe d’abord, Jules Michelet vient renverser les idées reçues sur le sujet : dans son portrait historique, l’influence des forces surnaturelles, de Satan ou de Dieu, ne vient qu’en second lieu après la présentation de l’individu lui-même. La sorcière est d’abord cette « Belle dame (bella 2 Dans le préambule, les références faites au livre La Sorcière de Jules Michelet figu- reront désormais entre parenthèses et sans le nom de l’auteur. INTRODUCTION 13 donna) » (33) qui vit sa relation avec le monde sur le mode du déca- lage et de la solitude : « Elle sent son isolement. » (99) Désormais, la vie « normale », surtout celle qu’entend et préconise l’Église, ne comprend aucune place légitime pour l’exclue considérée au même titre que les fous et les miséreux (Caspar 14) : « Car la folie marque, en général, un lieu d’exclusion, le dehors d’une culture. » (Felman 13) Cette inquiétante solitude aurait poussé la sorcière jusqu’à la solution ultime du « Pacte avec Satan » : « [...] on en venait là qu’à l’extrémité, en désespoir de toute chose, sous la pression terrible des outrages et des misères. » (70) De manière instantanée, l’anormalité de la sorcière s’appelle maladie, physique mais surtout mentale, maladie contre laquelle les médecins sont sans remèdes ni expliquation : « Beaucoup étaient de demi-folles. » (162) S’il est question de demi-folie, c’est aussi que la singularité de cet être refuse d’intégrer une catégorie connue à ce jour et se définit justement comme « une espèce à part » : « À son apparition, la Sorcière n’a ni père, ni mère, ni fils, ni époux, ni famille. C’est un monstre, un aérolithe, venu on ne sait d’où. » (36) À la fois au-dehors et dans ce monde, l’étrangeté de la sorcière pousse les hommes à réagir comme face aux fous et aux idiots. À ces « malades sous l’empire d’une illusion », on impose la violence, celle des injures avant d’en venir à une solution plus radicale : « Elle était si agitée qu’on fut contraint de la lier. » (190) Peu après l’enfermement – qui n’ôtait en rien l’incessante manifestation de l’esprit malin, « le trouvant trop fort dans l’âme, on veut le chasser des corps » (160) – viennent les bûchers qui lavent la conscience des hommes. En précipitant sa mort, ils condamnent la sorcière à une existence éphé- mère qui laissera cependant les traces de son passage. Révélée par les comportements violents à son égard, la sor- cière s’affirme comme présence gênante. Avec ses crises inattendues, ses danses saccadées, tout son corps se meut selon des mouvements inexplicables. Le spectacle dérange comme une chorégraphie grin- çante. À propos de l’œuvre de Jules Michelet, Barthes explique que « l’objet historique peut toujours se réduire au dégoût, à l’attrait ou au vertige qu’il provoque » (Michelet 157). Les sorcières ébranlent les certitudes, et leur mystère effraie : « Elles exerçaient sur le pays une uploads/s1/ faux-titre-no-343-berne-marie-eloge-de-l-x27-idiotie-pour-une-nouvelle-rhetorique-chez-breton-faulkner-beckett-et-cortazar-2009-rodopi.pdf
Documents similaires
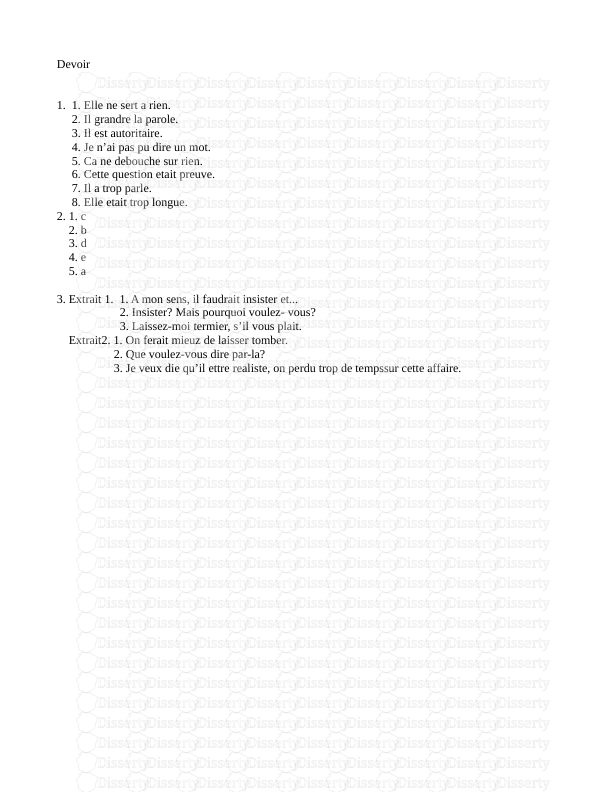









-
31
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 14, 2022
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 1.7610MB


