1 “On imagine un Hegel philosophiquement barbu, un Marx philosophiquement glabr
1 “On imagine un Hegel philosophiquement barbu, un Marx philosophiquement glabre au même titre qu’une Joconde moustachue”. Gilles Deleuze Le Temps du ready-made Thierry de Duve De même, imaginons un Malraux esthétiquement célibataire. Ce serait Marcel. Fin de l’introduction. Le Musée imaginaire de Malraux appelle un passage à la limite. Pourvu qu’on l’y pousse un peu, il se déclarerait volontiers prêt à annexer n’importe quel objet qu’une temporalité particulière, faite de mémoire et d’irruption, prédestine au musée. Cette temporalité – la métamorphose – fait du musée un partenaire actif dans le processus artistique: le musée a le pouvoir de nommer l’art en l’incorporant à la culture, et l’art ne se reconnaît comme tel qu’une fois cette incorporation faite. Causalité circulaire : pour qu’un objet quelconque soit éligible au musée imaginaire, il faut et il suffit qu’il reproduise sur lui-même le mouvement producteur qui sera celui du musée. Il n’est d’objet d’art pour Malraux, que pris d’origine dans le temps propre de l’art. Et de ce temps propre, le musée détermine la figure et donne le pas. Et si maintenant cette causalité circulaire s’emballait ? Ella aura tôt fait qu’on ne distingue plus l’antécédent du conséquent. Qu’on ne saura plus si l’objet est au musée parce que c’est de l’art ou si c’est de l’art parce qu’il est au musée. Plaçons donc au musée un objet quelconque, aussitôt le voilà objet d’art. Bientôt même l’objet sera superflu, l’idée y suffira. Juste de quoi entretenir une métamorphose court-circuitée, une ellipse de dialectique, par lesquelles en fin de compte le musée s’entretient comme institution artistique, et l’art comme tautologie. Le musée-machine célibataire en somme. Tout aurait commencé, vous vous en doutez, un certain jour de 1913 où Duchamp inventa, sinon déjà le mot, du moins son premier objet readymade : Roue de bicyclette. Et tout serait venu se condenser – très vite malgré quelques fourvoiements du côté de l’art de l’objet – dans un texte que Joseph Kosuth publie en 1969 : Publié dans Marcel Duchamp abécédaire. Jean Clair (éd.). Paris, Musée National d’Art Moderne, Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou, 1977, pp. 166-184. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, escaneada o distribuida de manera impresa o electrónica sin permiso. No part of this book may be reproduced, scanned, or distributed in any printed or electronic form without permission. ©2008FundacionProa 2 Thierry de Duve Art after philosophy.1 D’un geste inaugural, poussant à bout la logique du musée imaginaire, Duchamp aurait propulsé l’art contemporain vers l’annexionnisme absolu, qui est aussi – et sans paradoxe – l’annexionnisme minimal, puisque annexion de soi: a rose is a rose is a rose is a rose. C’est la vie. L’art et la vie réconciliés dans une grande lyse des signes et une intense dérive sur place du musée. Pas si vite. Un tel raccourci de l’histoire de l’art contemporain est évidemment suspect. Tout l’art d’aujourd’hui ne converge pas vers le conceptuel, tant s’en faut. Celui-ci – y compris la pratique de Kosuth – est plus complexe que Art after philosophy ne le laisse paraître. Et puis, dans ce qui a mené à l’art conceptuel, Duchamp n’est pas tout. (Par exemple : mettre en rapport, dans ce même texte, ce que Kosuth doit à Ad Reinhardt avec le peu que Reinhardt devait à Duchamp devrait nous conduire à plus de circonspection.) Mais surtout : que Duchamp procède, par emballement de la machine métamorphique, à une sorte de dialyse de l’art et à la dérive du musée, rien n’est moins sûr. Revenons à Malraux. Croire que Duchamp, provoquant le musée et l’obligeant à se dévoiler, donne le signal d’une formidable libération de l’art moderne, ce serait – même si c’est d’une manière que Malraux probablement, ne reconnaîtrait pas pour sienne – donner raison à Malraux sur son terrain. Or le paradoxe veut qu’on lui donne raison, mais sur le terrain de Duchamp. Le readymade n’opère pas le passage à la limite du Musée imaginaire, il en modifie complètement la figure temporelle. Le test sera celui-ci : pour Malraux, tout objet est éligible, pourvu qu’il soit avec le musée dans un rapport d’isochronie. Ancienneté, oubli des origines, temps actif et temps passif, mutilation et usure, sont des conditions qui préparent l’intronisation de l’objet au musée. Quelle est à cet égard, la chronie du readymade ? D’abord, c’est évident, il est neuf et intact. Sans passé, sans mémoire, sans trace de lutte ni d’usure. Comme de plus il est choisi sans équivoque en dehors du domaine de l’art, il n’est pas question qu’il s’y réfère a priori. Il n’est porteur d’aucun des stigmates dont le temps artistique marque d’origine les objets élus et que le musée restitue à leur sens à la fois pérenne et diachronique : les signes de l’imitation, de la rupture et de l’affirmation de soi, qui sont les trois étapes de la métamorphose. Du readymade, il est impossible de dire en paraphrasant Malraux : « Tout grand style est une réduction du chronos à l’homme, une mise en forme des éléments du temps qui permettent d’orienter celui-ci vers un des ses moments essentiels. » (Malraux avait écrit respectivement : cosmos, monde, et parts essentielles).2 Le readymade n’a pas de style, il se refuse obstinément à son incorporation aux styles. On dira : que le readymade n’ait pas de style, c’est l’évidence même. Mais que vous argumentiez cela sur une question de temps, et non de forme, vous risquez bien qu’on vous contredise sans effort : d’abord le readymade imite, étant prélevé dans une série industrielle, il est la reproduction de chacun de ses semblables. Ensuite, le readymade naît certainement d’une rupture, celle qui l’arrache à sa fonction utilitaire. Enfin il s’individualise et affirme sa singularité, du fait même que l’artiste l’a choisi. Vous vous trompez, cher contradicteur, et sur un point capital. Car vous cherchez à donner tort à Malraux sur son terrain, qui est celui de l’esthétique. Si la question du style était affaire de forme – ou de sens, à eux deux les fiefs sacrés de l’esthétique – pour sûr le readymade représenterait un style nouveau. On aurait tôt remarqué qu’il est un excellent candidat au style : forme en rupture de ban et négation des valeurs esthétiques sont d’excellentes lettres de créance. On lui trouverait aussitôt des qualités plastiques et des profondeurs symboliques. Un urinoir n’est- il pas une sculpture ? La miction ne se rattache-t-elle pas au thème de la chute d’eau, central chez Duchamp ? Et dans la foulée, on en conclurait avec empressement que tout peut être style, qu’il y a dorénavant une esthétique du quotidien, que l’art et la vie, etc. Airs connus. Non. Dans le débat sur le style, les querelles de forme sont toujours futiles. Laissez faire le temps, il les tranchera pour son compte. La grande originalité de l’esthétique de Malraux, c’est qu’en sous-main des questions de forme et de sens, c’est le temps – une certaine figure du temps – qui organise l’esthétique et légitimise le musée. Le fil rouge des styles, ce n’est rien d’autre que la temporalité particulière qui les fait se succéder, s’opposer, se nier et se reprendre, la chronie commune à l’art et au musée. Cette chronie appelle un passage à la limite. Mais le readymade ne répond pas à cet appel, malgré les apparences. Il opère autrement, d’une façon qui menace autrement fort l’esthétique. On peut en voir les symptômes chez Malraux lui-même : il réfute l’art des fous, mais non sans Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, escaneada o distribuida de manera impresa o electrónica sin permiso. No part of this book may be reproduced, scanned, or distributed in any printed or electronic form without permission. ©2008FundacionProa 3 Le Temps du ready-made pour autant. Il porte l’imitation à une perfection sans faille, non parce qu’il reproduit l’original à s’y méprendre, mais parce qu’il n’y a jamais eu d’original : la production industrielle est d’emblée reproduction. Aucune rupture à espérer de ce côté-là. Soit maintenant le readymade au-delà du seuil : l’objet d’art est installé dans une mimésis absolue, et porte la représentation à son comble. Non contente d’imiter la forme du modèle, la copie lui a volé sa matière, elle a pris corps en lui, elle est le modèle même. Ni la reproduction parfaite, ni la représentation comblée ne justifient le passage de l’objet quelconque à l’objet d’art. La faille n’est pas dans l’imitation, mais entre deux imitations sans faille. Il sera aisé de montrer qu’il en est de même pour la rupture, seconde étape de la métamorphose. Quelle rupture ? De celle qui arrache le readymade à sa fonction, peut-on dire qu’elle médiatise son passage à l’art ? Il faudrait pour cela que l’objet en garde trace, comme ces outils que l’archéologue exhume et que le temps, l’enfouissement et l’usure ont transformés en objets d’art. Mais le readymade est neuf, et reste parfaitement utilisable. Ce n’est donc pas en rompant avec son usage que le readymade franchit le seuil de l’art, mais parce qu’il uploads/s3/ 08-letempsdureadymade-pdf.pdf
Documents similaires







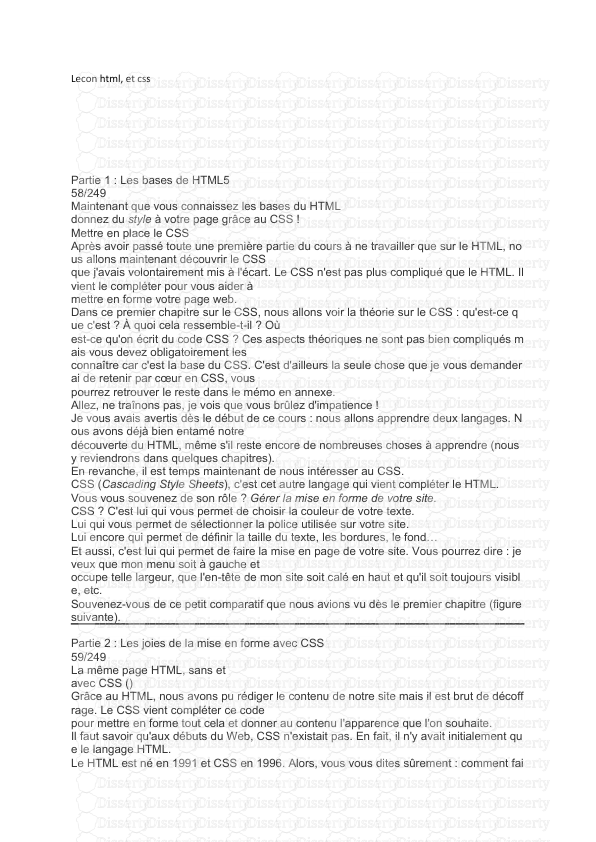


-
58
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 21, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 2.1935MB


