Le calcul des langues JACQUES DERRIDA Le calcul des langues Distyle Édition éta
Le calcul des langues JACQUES DERRIDA Le calcul des langues Distyle Édition établie par Geoffrey Bennington et Katie Chenoweth ÉDITIONS DU SEUIL 57, rue Gaston-Tessier, Paris XIXe Ce livre est publié dans la collection Bibliothèque Derrida sous la direction de Katie Chenoweth. isbn 978.2.02.145585.4 © Éditions du Seuil, mai 2020 Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. www.seuil.com Préface Phalanges Le Calcul des langues. Distyle est un texte inédit, inachevé, visi- blement abandonné en cours de route : texte expérimental, expé- rience d’écriture et de pensée. Ce texte inattendu, énigmatique était pourtant annoncé comme « à paraître » en quatrième de couverture de l’édition de l’Essai sur l’origine des connaissances humaines de Condillac publiée par Charles Porset aux éditions Galilée en octobre 19731, édition qui comporte une préface de Derrida longue d’une centaine de pages (« L’archéologie du fri- vole », qui deviendra par la suite un petit livre2). Le Calcul des langues était destiné à paraître dans la même collection que l’édi- tion de l’Essai (la collection « Palimpsestes », dirigée par Porset), mais, « laissé de côté pour un temps3 », ce texte curieux ne fut 1. La disposition du titre pose déjà un problème : sur la quatrième de couverture le mot « distyle » apparaît centré sous « Le calcul des langues » (le tout en italique) ; à l’intérieur du volume, p. 302, sous la rubrique « Dans la même collection », le mot « distyle » est approximativement centré sous « Le calcul des langues, » mais cette fois imprimé en romain. Dans les deux cas, on annonce aussi comme devant paraître dans la même collection le texte de William Warburton, Essai sur les hiéroglyphes, avec une introduction de J. Derrida. Le texte de Warburton est dûment paru en 1977, pré- cédé de « Scribble : pouvoir/écrire » de Derrida et d’un texte de Patrick Tort, mais aux éditions Aubier-Flammarion, où la collection « La philosophie en effet » devait aussi chercher refuge pendant quelques années, avant de passer chez Galilée. 2. L’Archéologie du frivole. Lire Condillac, Paris, Denoël/Gonthier, 1977, repris par les éditions Galilée, coll. « La philosophie en effet », en 1990 : c’est cette der- nière édition que nous citons ici. 3. Selon une lettre de Jacques Derrida à Roger Laporte, citée par Benoît Peeters dans Derrida, Paris, Flammarion, coll. « Grandes biographies », 2010, p. 319. Nous tenons par ailleurs à remercier Benoît Peeters et Thomas Clément Mercier pour de précieuses indications matérielles concernant Le Calcul des langues. 7 de toute évidence jamais repris ; il fut seulement retrouvé après la mort de Derrida. * Rien de très étonnant, peut-être, à ce que Jacques Derrida solli- cite ici la forme même du livre. Dès 1963, dans son premier texte publié, « Force et signification », il met en question toute « simul- tanéité théologique du livre », affirmant qu’il « n’y a pas d’identité à soi de l’écrit », du moment où « le sens du sens » serait « l’im- plication infinie », « le renvoi indéfini de signifiant à signifiant »1. Et De la grammatologie (1967) annonçait déjà (c’est le titre de son premier chapitre) « la fin du livre et le début de l’écriture2 ». Du moment où la déconstruction n’est pas simplement activité théo- rique, mais, comme le dit souvent Derrida à cette époque, décon- struction pratique3, il est prévisible qu’elle s’attaque plus ou moins directement à la forme du livre, la forme-livre, le volume lui-même. Avant Le Calcul des langues, il y avait déjà eu un certain travail sur la mise en page dans « La double séance4 », et même un texte qui déjà se présentait en deux colonnes (« Tympan », qui ouvre Marges – de la philosophie5). Et tout de suite après l’abandon du Calcul des langues, il y aura bien sûr le monumental Glas, auquel le lec- teur aura pensé tout de suite en ouvrant ce volume, et en faveur duquel, semble-t‑il, Le Calcul des langues aura été abandonné en cours de route. Et pourtant, Le Calcul des langues – laissé inachevé, certes –, loin d’être simplement encore une tentative de troubler la forme du livre (tentative plutôt ratée, doit-on supposer, aux yeux de Derrida lui-même), est un texte non seulement singulier, qui en fait ne ressemble que superficiellement à « Tympan » ou à Glas, 1. Jacques Derrida, L’Écriture et la différence, Paris, Seuil, coll. « Tel Quel », 1967, p. 41‑42. 2. De la grammatologie, Paris, Minuit, coll. « Critique », 1967. 3. Cf. par exemple Positions, Paris, Minuit, coll. « Critique », 1972, p. 93 et 116 ; La Dissémination, Paris, Seuil, coll. « Tel Quel », 1972, p. 10 et passim ; Glas, Paris, Galilée, coll. « La philosophie en effet », 1974, p. 21b ; et ici même dans Le Calcul des langues, p. 1a, 35b, 38a, 54a, 59b. 4. In La Dissémination, op. cit., p. 198, 201‑202, 318. 5. In Marges – de la philosophie, Paris, Minuit, coll. « Critique », 1972. LE CALCUL DES LANGUES 8 mais même, de certains points du vue, encore plus radical et ambi- tieux que ces deux textes très connus. Petit frère mort-né de Glas, pourrait-on croire, donc, mais Le Calcul des langues diffère de plusieurs façons du gros volume carré de 1974, n’en est pas simplement la même chose en miniature. D’abord parce que, à la différence de Glas, Le Calcul des langues fut composé – dactylographié – directement en deux colonnes. Interrogé vers 1990 par Geoffrey Bennington au sujet de ce texte annoncé mais jamais paru1, Derrida lui-même insistait sur le côté artisanal de la chose : il racontait comment il mettait chaque feuille (avec deux copies carbone) une première fois dans la machine (sa « petite Olivetti » manuelle2), ayant réglé le retour de chariot sur le milieu de la page (approximativement : la largeur des colonnes du tapuscrit varie en fait selon la page), et, la première colonne arrivée en bas de page, remettait la même feuille avec le début de ligne désormais réglé un peu à droite de la première colonne, et composait la deuxième colonne à côté de la première. Si bien que (Derrida insistait là-dessus) Le Calcul des langues fut non pas com- posé en mettant ensemble deux textes d’abord écrits séparément3, mais bel et bien écrits, en principe, quasiment en même temps, une colonne déjà en vue de l’autre, d’emblée au regard de l’autre, page après page : un texte qui appellera donc ce que lui-même appelle une « lecture stéréographique » (P. 42a). Il faut pourtant de toute évidence nuancer un peu cette descrip- tion qu’avait donnée Derrida lui-même du processus de composi- tion du Calcul des langues. D’abord parce que, au moins vers la fin (ou plutôt l’interruption) du texte, on voit qu’une seule colonne – la droite – continue sur plusieurs pages (P. 94-107) sans réponse 1. Avec « Entre deux coups de dés », annoncé dans La Dissémination (op. cit., p. 158, note 57), c’est un exemple rare d’un texte « perdu » de Derrida. 2. Cf. Papier Machine, Paris, Galilée, coll. « La philosophie en effet », 2001, p. 152 et 158‑159, cité par Benoît Peeters, Derrida, op. cit., p. 320. Ce texte date effec- tivement de l’époque où Derrida écrivait « de plus en plus à la machine » (Papier Machine, p. 153). 3. Comme c’est le cas et pour « Tympan », où la colonne de droite est intégrale- ment composée d’une longue citation de Michel Leiris, et pour Glas, où les colonnes furent écrites, peut-être, dans l’idée au moins vague de leur éventuelle juxtaposition ou confrontation, mais non pas simultanément et à la même page. PHALANGES 9 de l’autre côté. Ensuite parce que la colonne de gauche (comme d’ailleurs c’est le cas de la colonne de gauche de Glas) n’est pas composée de toutes pièces en vue de ce livre1, mais suit d’assez près le texte d’un cours ou séminaire : dans le cas de Glas le séminaire « La famille de Hegel » (1971‑1972) pour les premiers 225 pages, le séminaire « Religion et philosophie » (1972‑1973) pour le reste, et dans le cas du Calcul des langues le séminaire « Philosophie et rhétorique au xviiie siècle : Condillac et Rousseau » (1971‑1972)2 dont la colonne de gauche suit d’assez près les premières séances. Là aussi, une étude détaillée révèle d’importantes différences entre Le Calcul des langues et Glas : car malgré certaines apparences (et quelques ajouts), Glas – le plus souvent – suit le texte du sémi- naire sur Hegel page par page (souvent phrase par phrase, même si peu de phrases restent inchangées du séminaire au uploads/s3/ derrida-le-calcul-des-langues.pdf
Documents similaires



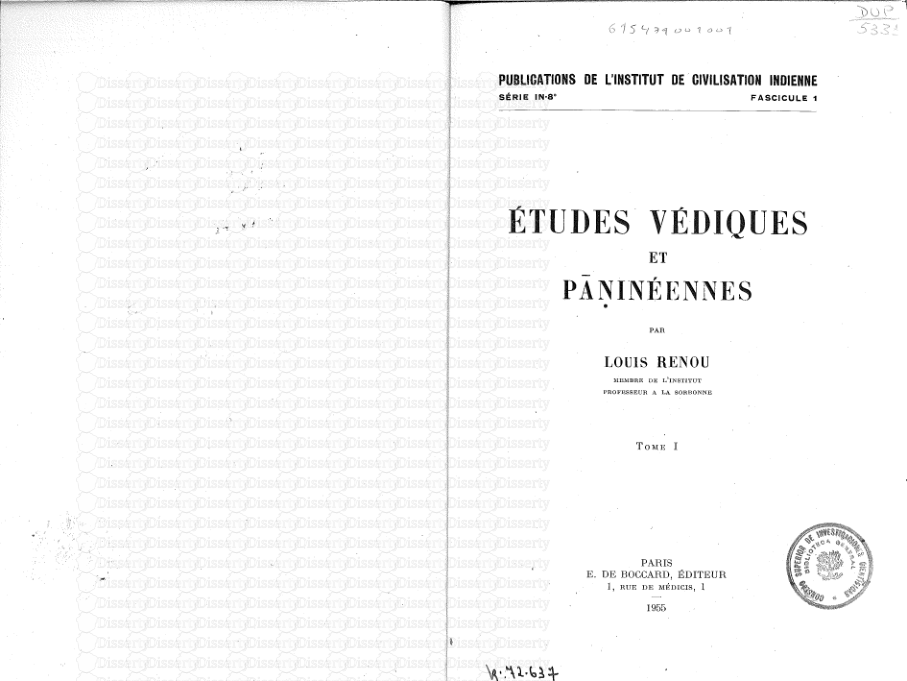






-
39
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 25, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.8492MB


