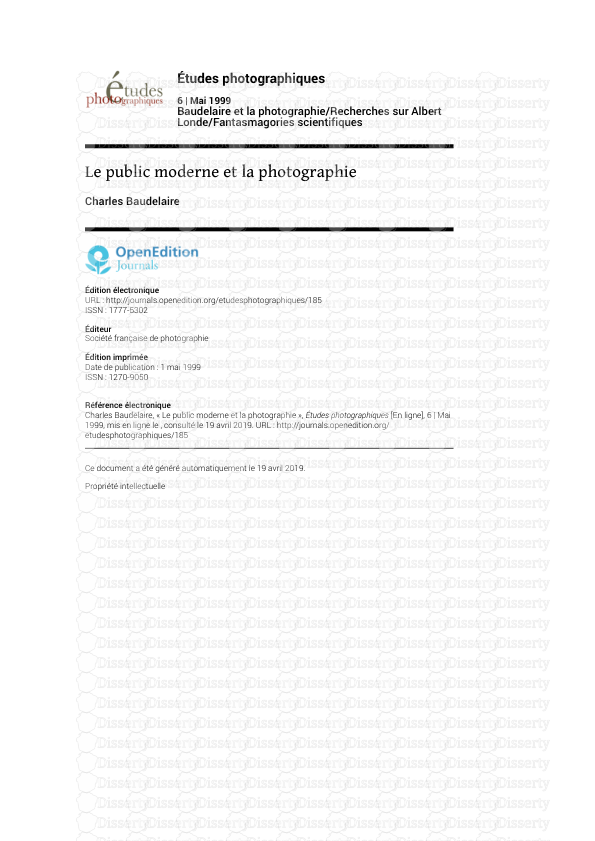Études photographiques 6 | Mai 1999 Baudelaire et la photographie/Recherches su
Études photographiques 6 | Mai 1999 Baudelaire et la photographie/Recherches sur Albert Londe/Fantasmagories scientifiques Le public moderne et la photographie Charles Baudelaire Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/etudesphotographiques/185 ISSN : 1777-5302 Éditeur Société française de photographie Édition imprimée Date de publication : 1 mai 1999 ISSN : 1270-9050 Référence électronique Charles Baudelaire, « Le public moderne et la photographie », Études photographiques [En ligne], 6 | Mai 1999, mis en ligne le , consulté le 19 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/ etudesphotographiques/185 Ce document a été généré automatiquement le 19 avril 2019. Propriété intellectuelle Le public moderne et la photographie Charles Baudelaire 1 Mon cher Morel1, si j'avais le temps de vous égayer, j'y réussirais facilement en feuilletant le catalogue et en faisant un extrait de tous les titres ridicules et de tous les sujets cocasses qui ont l'ambition d'attirer les yeux. C'est là l'esprit français. Chercher à étonner par des moyens d'étonnement étrangers à l'art en question est la grande ressource des gens qui ne sont pas naturellement peintres. Quelquefois même, mais toujours en France, ce vice entre dans des hommes qui ne sont pas dénués de talent et qui le déshonorent ainsi par un mélange adultère. Je pourrais faire défiler sous vos yeux le titre comique à la manière des vaudevillistes, le titre sentimental auquel il ne manque que le point d'exclamation, le titre calembour, le titre profond et philosophique, le titre trompeur, ou titre à piège, dans le genre de Brutus, lâche César2! "Ô race incrédule et dépravée! dit Notre Seigneur, jusques à quand serai-je avec vous? jusques à quand souffrirai-je3?" Cette race, en effet, artiste et public, a tant de foi dans la peinture, qu'elle cherche sans cesse à la déguiser et à l'envelopper comme une médecine désagréable dans des capsules de sucre; et quel sucre, grand Dieu! Je vous signalerai seulement deux titres de tableaux que d'ailleurs je n'ai pas vus: Amour et gibelotte4! Comme la curiosité se trouve tout de suite en appétit, n'est-ce pas? Je cherche à combiner intimement ces deux idées, l'idée de l'amour, et l'idée d'un lapin dépouillé et rangé en ragoût. Je ne puis vraiment pas supposer que l'imagination du peintre soit allée jusqu'à adapter un carquois, des ailes et un bandeau sur le cadavre d'un animal domestique; l'allégorie serait vraiment trop obscure. Je crois plutôt que le titre a été composé suivant la recette de Misanthropie et Repentir5. Le vrai titre serait donc: Personnes amoureuses mangeant une gibelotte. Maintenant, sont-ils jeunes ou vieux, un ouvrier et une grisette, ou bien un invalide et une vagabonde sous une tonnelle poudreuse? Il faudrait avoir vu le tableau. Monarchique, catholique et soldat! Celui-ci est dans le genre noble, le genre paladin, itinéraire de Paris à Jérusalem (Chateaubriand, pardon! les choses les plus nobles peuvent devenir des moyens de caricature, et les paroles politiques d'un chef d'empire des pétards de rapin6). Ce tableau ne peut représenter qu'un personnage qui fait trois choses à la fois, se bat, communie, et assiste au petit lever de Louis XIV. Peut-être est-ce un guerrier tatoué de fleurs de lys et d'images de dévotion. Le public moderne et la photographie Études photographiques, 6 | Mai 1999 1 Mais à quoi bon s'égarer? Disons simplement que c'est un moyen, perfide et stérile, d'étonnement. Ce qu'il y a de plus déplorable, c'est que le tableau, si singulier que cela puisse paraître, est peut-être bon. Amour et gibelotte aussi. N'ai-je pas remarqué un excellent petit [263] groupe de sculpture dont malheureusement je n'avais pas noté le numéro, et quand j'ai voulu connaître le sujet, j'ai, à quatre reprises et infructueusement, relu le catalogue. Enfin vous m'avez charitablement instruit que cela s'appelait Toujours et jamais7. Je me suis senti sincèrement affligé de voir qu'un homme d'un vrai talent cultivât inutilement le rébus8. [p. 22] 2 Je vous demande pardon de m'être diverti quelques instants à la manière des petits journaux. Mais, quelque frivole que vous paraisse la matière, vous y trouverez cependant, en l'examinant bien, un symptôme déplorable. Pour me résumer d'une manière paradoxale, je vous demanderai, à vous et à ceux de mes amis qui sont plus instruits que moi dans l'histoire de l'art, si le goût du bête, le goût du spirituel (qui est la même chose) ont existé de tout temps, si Appartement à louer 9et autres conceptions alambiquées ont paru dans tous les âges pour soulever le même enthousiasme, si la Venise de Véronèse et de Bassan a été affligée par ces logogriphes, si les yeux de Jules Romain, de Michel-Ange, de Bandinelli ont été effarés par de semblables monstruosités; je demande, en un mot, si M. Biard est éternel et omniprésent, comme Dieu. Je ne le crois pas, et je considère ces horreurs comme une grâce spéciale attribuée à la race française. Que ses artistes lui en inoculent le goût, cela est vrai; qu'elle exige d'eux qu'ils satisfassent à ce besoin, cela est non moins vrai; car si l'artiste abêtit le public, celui-ci le lui rend bien. Ils sont deux termes corrélatifs qui agissent l'un sur l'autre avec une égale puissance10. Aussi admirons avec quelle rapidité nous nous enfonçons dans la voie du progrès (j'entends par progrès la diminution progressive de l'âme et la domination progressive de la matière11), et quelle diffusion merveilleuse se fait tous les jours de l'habileté commune, de celle qui peut s'acquérir par la patience. 3 Chez nous le peintre naturel, comme le poëte naturel, est presque un monstre. Le goût exclusif du Vrai (si noble quand il est limité à ses véritables applications) opprime ici et étouffe le goût du Beau. Où il faudrait ne voir que le Beau (je suppose une belle peinture, et l'on peut aisément deviner celle que je me figure), notre public ne cherche que le Vrai12 . Il n'est pas artiste, naturellement artiste; philosophe peut-être, moraliste, ingénieur, amateur d'anecdotes instructives, tout ce qu'on voudra, mais jamais spontanément artiste. Il sent ou plutôt il juge successivement, analytiquement. D'autres peuples, plus favorisés, sentent tout de suite, tout à la fois, synthétiquement. 4 Je parlais tout à l'heure des artistes qui cherchent à étonner le public. Le désir d'étonner et d'être étonné est très-légitime. It is a happiness to wonder, "c'est un bonheur d'être étonné;" mais aussi, it is a happiness to dream, "c'est un bonheur de rêver13". Toute la question, si vous exigez que je vous confère le titre d'artiste ou d'amateur des beaux-arts, est donc de savoir par quels procédés vous voulez créer ou sentir l'étonnement. Parce que le Beau est toujours étonnant, il serait absurde de supposer que ce qui est étonnant est [264] toujours beau. Or notre public, qui est singulièrement impuissant à sentir le bonheur de la rêverie ou de l'admiration (signe des petites âmes), veut être étonné par des moyens étrangers à l'art, et ses artistes obéissants se conforment à son goût; ils veulent le frapper, le surprendre, le stupéfier par des stratagèmes indignes, parce qu'ils le savent incapable de s'extasier devant la tactique naturelle de l'art véritable14. 5 Dans ces jours déplorables, une industrie nouvelle se produisit, qui ne contribua pas peu à confirmer la sottise dans sa foi et à ruiner ce qui pouvait [p. 23] rester de divin dans Le public moderne et la photographie Études photographiques, 6 | Mai 1999 2 l'esprit français. Cette foule idolâtre postulait un idéal digne d'elle et approprié à sa nature, cela est bien entendu. En matière de peinture et de statuaire, le Credo actuel des gens du monde, surtout en France (et je ne crois pas que qui que ce soit ose affirmer le contraire), est celui-ci: "Je crois à la nature et je ne crois qu'à la nature (il y a de bonnes raisons pour cela). Je crois que l'art est et ne peut être que la reproduction exacte de la nature 15(une secte timide et dissidente veut que les objets de nature répugnante soient écartés, ainsi un pot de chambre ou un squelette). Ainsi l'industrie qui nous donnerait un résultat identique à la nature serait l'art absolu." Un Dieu vengeur a exaucé les voeux de cette multitude. Daguerre fut son Messie16. Et alors elle se dit: "Puisque la photographie nous donne toutes les garanties désirables d'exactitude (ils croient cela, les insensés), l'art, c'est la photographie17." A partir de ce moment, la société immonde se rua, comme un seul Narcisse, pour contempler sa triviale image sur le métal. Une folie, un fanatisme extraordinaire s'empara de tous ces nouveaux adorateurs du soleil. D'étranges abominations se produisirent. En associant et en groupant des drôles et des drôlesses, attifés comme les bouchers et les blanchisseuses dans le carnaval, en priant ces héros de bien vouloir continuer, pour le temps nécessaire à l'opération, leur grimace de circonstance, on se flatta de rendre les scènes, tragiques ou gracieuses, de l'histoire ancienne18. Quelque écrivain démocrate a dû voir là le moyen, à bon marché, de répandre dans le peuple le goût 19de l'histoire et de la peinture, commettant ainsi un double sacrilège et insultant ainsi la divine peinture et l'art uploads/s3/ etudesphotographiques-185.pdf
Documents similaires










-
73
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 09, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2222MB