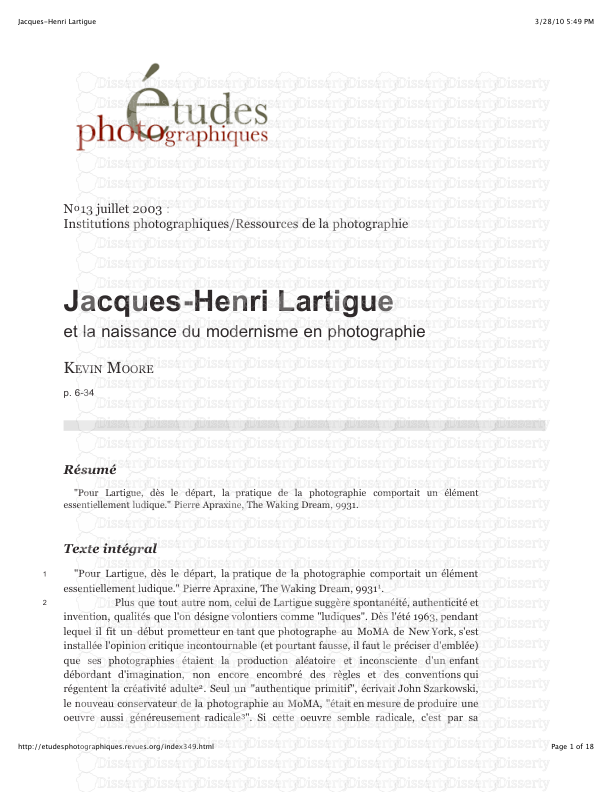3/28/10 5:49 PM Jacques-Henri Lartigue Page 1 of 18 http://etudesphotographique
3/28/10 5:49 PM Jacques-Henri Lartigue Page 1 of 18 http://etudesphotographiques.revues.org/index349.html No13 juillet 2003 : Institutions photographiques/Ressources de la photographie Jacques-Henri Lartigue et la naissance du modernisme en photographie KEVIN MOORE p. 6-34 Résumé Texte intégral "Pour Lartigue, dès le départ, la pratique de la photographie comportait un élément essentiellement ludique." Pierre Apraxine, The Waking Dream, 9931. "Pour Lartigue, dès le départ, la pratique de la photographie comportait un élément essentiellement ludique." Pierre Apraxine, The Waking Dream, 99311. 1 Plus que tout autre nom, celui de Lartigue suggère spontanéité, authenticité et invention, qualités que l'on désigne volontiers comme "ludiques". Dès l'été 1963, pendant lequel il fit un début prometteur en tant que photographe au MoMA de New York, s'est installée l'opinion critique incontournable (et pourtant fausse, il faut le préciser d'emblée) que ses photographies étaient la production aléatoire et inconsciente d'un enfant débordant d'imagination, non encore encombré des règles et des conventions qui régentent la créativité adulte2. Seul un "authentique primitif", écrivait John Szarkowski, le nouveau conservateur de la photographie au MoMA, "était en mesure de produire une oeuvre aussi généreusement radicale3". Si cette oeuvre semble radicale, c'est par sa candeur, sa vivacité et son dynamisme formels, mais aussi du fait qu'elle a été produite 2 3/28/10 5:49 PM Jacques-Henri Lartigue Page 2 of 18 http://etudesphotographiques.revues.org/index349.html candeur, sa vivacité et son dynamisme formels, mais aussi du fait qu'elle a été produite pendant les premières décennies du XXe siècle, avant l'invention du Leica, de l'Ermanox, et des autres appareils compacts4. Pour Szarkowski, les photographies de Lartigue ressemblaient à une version infantile du reportage* de grand style tel que Henri Cartier- Bresson l'avait popularisé dans les années 1930. Mieux encore, elles paraissaient annoncer la "photographie de [p. 7] rue" délibérément acerbe et provocatrice de Garry Winogrand, l'inventeur de ce qu'on a appelé l'"esthétique de l'instantané5". Tout d'un coup, les photographies de Lartigue ont rencontré un vaste public et éveillé l'intérêt de la critique. Bien que ce public ait en général montré une immense admiration, il n'a pas manqué de s'interroger sur la nature de cette photographie, sur la lignée à laquelle elle appartenait. Dans les modestes limites du corpus photographique "innocent" de Lartigue, ce public était curieux de découvrir ses propres valeurs. Est-ce vraiment une coïncidence que la notion de spontanéité, ce mot qu'utilisent les adultes pour parler de jeu, soit devenue si essentielle chez les artistes et les critiques de l'Amérique d'après-guerre? Daniel Belgrad, dans son livre The Culture of Spontaneity, définit l'émergence d'une "esthétique cohérente de la spontanéité" dans la culture américaine des années 1950. Le geste spontané, selon Belgrad, était dans l'air du temps, et signifiait, pour les artistes d'avant-garde et le public, un rejet simultané de la culture du Vieux Monde et de l'idéologie dominante américaine de consumérisme et de progrès technologique. La spontanéité promettait "une troisième voie, opposée à la fois à la culture de masse et à la "haute culture" académique des années d'après-guerre6". Pour les peintres de l'expressionnisme abstrait, la spontanéité signifiait une approche de la pratique artistique novatrice par la forme, capable de fonder une fois pour toutes un "style américain", et une production empreinte d'un contenu psychologique, authentique, chose qui n'avait guère cours dans le vaste panorama matérialiste de la vie américaine. 3 Par rapport à ce phénomène, l'art photographique américain occupait une place particulière. À l'écart de la structure traditionnelle qui opposait académisme et avant-garde, confinée dans le domaine de la presse illustrée de l'entre-deux-guerres, la photographie ne fit son entrée dans l'institution qu'à partir des années 1960 et 1970. Bien que complexe, la priorité devint alors de définir pour l'art photographique un statut cohérent avec les efforts antérieurs du MoMA pour légitimer cet art7, qui le différencie du travail commercial vulgarisé par les revues illustrées, de l'essor de la photographie d'amateur et des évolutions dans les autres médias. La spontanéité incarnée par Lartigue offrait une solution, tandis que la stase classique d'Eugène Atget en fournissait une autre. Ensemble, ces deux sensibilités artistiques établissaient les frontières de la pratique photographique. Ainsi l'alternative se situait entre [p. 8] une approche spontanée et une démarche raffinée entre "fenêtre" et "miroir", pour reprendre les termes de Szarkowski en 19788. Dans un cas comme dans l'autre, le photographe se devait de respecter les limites de son médium, selon l'indiscutable axiome de la photographie depuis la fin du pictorialisme. 4 La mission que Szarkowski s'était fixée de modifier le cours de l'art photographique dans les années 1960 rencontra la complicité de Lartigue si ce n'est sa complaisance. Par ignorance, à cause d'interprétations erronées, ou simplement faute d'un véritable questionnement des sources (il faut dire que Lartigue, encore vivant, contribua largement à sa propre mythification9), Szarkowski s'appliqua à ce que Lartigue "intégrât" les principes théoriques qui étaient siens. Pour illustrer son récit de la naissance du modernisme en photographie, le conservateur mit l'accent sur la forme, l'intuition et l'expérience au mépris du contenu, du savoir-faire et de l'art. Ce regard sur 5 3/28/10 5:49 PM Jacques-Henri Lartigue Page 3 of 18 http://etudesphotographiques.revues.org/index349.html Prélude l'intuition et l'expérience au mépris du contenu, du savoir-faire et de l'art. Ce regard sur Lartigue était aussi biaisé qu'il pouvait être influent: scénario typique de la nature générale du transfert historique. Quand Nietzsche écrit dans De l'utilité et de l'inconvénient des études historiques: "Toute action exige l'oubli", il soutient qu'un peu de fiction dans l'histoire aide à la rendre plus efficace et plus "utile" pour engendrer la modification du présent10. L'intrusion de Lartigue dans les sacro-saintes galeries du MoMA en dit plus long que les simples déformations qui se produisent quand un moment historique cherche son inspiration dans un autre; elle amplifie aussi les effets d'un tel geste dans ce cas, une requalification théorique radicale de la photographie, une révision de son histoire, et la naissance d'un nouveau "maître". Dans les années 1950, il y avait sans doute en France quelques visionnaires au sujet de la photographie, mais elle ne disposait pas d'une institution telle que le MoMA, ni d'une publication telle que Aperture pour promouvoir l'idée d'une photographie artistique11. Il y avait bien des agences photographiques, telles que Magnum, et des éditeurs spécialisés comme Robert Delpire, mais leur rapport au travail des photographes restait inspiré par la photographie de presse12. Quant aux institutions, la Bibliothèque nationale servait depuis longtemps de dépôt légal des photographies et privilégiait le contenu de la photographie, au point de la classer par sujet plutôt que par auteur. On rapporte par exemple en 1953: [p. 9] 6 "M. Prinet, du cabinet des Estampes, à la Bibliothèque nationale, et plus spécialement chargé de la section photographique, me disait combien il lui était difficile de trouver des photographies de la vie quotidienne des intérieurs et des images des moeurs de notre temps , alors qu'il avait pour des époques plus lointaines, sur ces mêmes sujets, des gravures innombrables13." 7 Ce texte fut publié dans Point de vue, revue qui entendait élever la photographie au rang d'oeuvre d'art. Malgré les ambitions du rédacteur en chef, Albert Plécy, la photographie était envisagée de même qu'à la Bibliothèque nationale, comme un fournisseur de contenu. Plécy adressait les conseils suivants aux lecteurs: 8 "En dehors des grands faits historiques illustrés en général par des professionnels, il existe tout un monde à fixer sur la pellicule qui, avec le temps, se valorise comme le bon vin. C'est pourquoi les amateurs doivent classer avec soin leur album photographique et protéger leurs négatifs, "un trésor est caché dedans"14." 9 Plécy n'était pas à la tête de la bonne publication pour lancer une avant-garde de la photographie. Point de vue était une revue illustrée comme Life et s'adressait à un public populaire. Une discussion sur le médium photographique risquait d'ennuyer les lecteurs. Quand Plécy décida de publier une série des premiers travaux de Lartigue en 1954, [p. 10] il agença les images comme des documents d'intérêt historique, accompagnés de longues légendes écrites à la main traitant les images exactement comme les "photographies de la vie quotidienne" étiquetées et cataloguées à la Bibliothèque nationale15. Le commentaire précisait: "J.-H. Lartigue avait trouvé dans sa propre famille les sujets et les éléments pour la constitution de véritables archives photographiques16." 10 La première diffusion publique des fameuses "photographies d'enfance" de Lartigue suivit une organisation thématique. En septembre 1954, Point de vue publiait un 11 3/28/10 5:49 PM Jacques-Henri Lartigue Page 4 of 18 http://etudesphotographiques.revues.org/index349.html Szarkowski et le modernisme en photographie Lartigue suivit une organisation thématique. En septembre 1954, Point de vue publiait un choix d'environ cinquante photographies de voitures anciennes regroupées sous l'item: "Aux temps héroïques de l'automobile". En février 1955 paraissait une autre sélection: "Toute l'aviation dans une vie d'homme", suivie d'une autre rubrique consacrée aux avions intitulée: "Quel sera l'aspect des avions que Lartigue photographiera dans quarante-cinq ans, en l'an 2000?". Enfin, un choix de photographies de mode, "Courses d'hier...", est publié en juin 195517. Voilà donc à quoi se résuma l'entrée en scène de Lartigue, du moins dans les pages de Point de vue. Les rédacteurs d'autres publications européennes remarquèrent le uploads/s3/ jacques-henri-lartigue.pdf
Documents similaires










-
52
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 31, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2833MB