BERNARD QUIRINY L’ANGOISSE DE LA PREMIÈRE PHRASE Nouvelles PHÉBUS Illustration
BERNARD QUIRINY L’ANGOISSE DE LA PREMIÈRE PHRASE Nouvelles PHÉBUS Illustration de couverture : Tom Curry Tourista (détail) © Éditions Phébus. Paris. 2005 www phebus-editions.com L’ANGOISSE DE LA PREMIÈRE PHRASE Qu’une phrase soit la dernière, il enfaut une autre pour le déclarer, et elle n’est donc pas la dernière. JEAN-FRANÇOIS LYOTARD La première phrase : voilà l’ennemi. C’est ce que pensa Gould le jour où il décida d’écrire le livre auquel il songeait depuis de nombreuses années. Devant sa feuille blanche, il passa des heures à chercher la première phrase idéale. Sans cesse il posa la pointe de son stylo sur le papier et tentait de libérer son poignet pour dessiner la boucle de la première lettre ; il s’interrompait à chaque fois avec la certitude horripilante qu’il y avait une meilleure manière de démarrer le texte. Tout ce qu’il écrivait en découlerait, une mauvaise première phrase contaminerait tout le livre. Elle devait être un roc, un granit sur quoi construire en toute sécurité, il – 3 – fallait la travailler jusqu’à atteindre la perfection. La majorité de ses futurs lecteurs commencerait par elle, elle était en quelque sorte l’équivalent de la main qu’on tend lors d’un premier rendez-vous. Si vous ongles sont sales ou que vous écrasiez les doigts de votre interlocuteur en secouant sa main comme un moineau mort, vous ne risquez pas de produire une impression favorable. Il en va de même pour les premiers mots d’un livre. Gould les traqua durant toute une journée comme s’ils étaient une bête rusée et retorse, avec l’impression troublante d’être engagé avec eux dans une lutte sans merci. C’est sans doute cette angoisse du commencement qui a conduit à l’invention de l’exergue. L’exergue est une façon de tricher sur la première phrase en l’empruntant à un écrivain célèbre. Gould était opposé à ce procédé, qui était pour lui une forme de lâcheté. D’après lui, il était à la portée de n’importe qui de tirer d’un chef- d’œuvre une phrase dont le génie rejaillirait indûment sur le texte qu’elle introduirait ; cette manière de fuir sa responsabilité en se cachant derrière un grand homme lui était inadmissible. Ce n’était guère mieux que de chiper un insigne sur le capot d’une berline de luxe pour le coller sur celui de son tacot personnel. Gould, qui n’était pas du genre à céder à la facilité, rejeta donc l’option de l’exergue et continua de chercher la première phrase idéale. Il pensa à Flaubert qui disait n’avoir trouvé celle de son Bouvard et Pécuchet qu’après « tout un après-midi de torture ». Comment les grands écrivains se sont-ils sortis de cette épreuve ? Gould décida de méditer quelques ouvertures tirées de ses romans favoris, en espérant glaner auprès des maîtres des enseignements capables de l’aider à franchir le pas. Les deux premières phrases les plus célèbres de la littérature nationale sont sans doute : « Aujourd’hui, maman est morte » et « Longtemps, je me suis couché de bonne heure ». Gould les répéta plusieurs fois chacune à voix haute. Elles ne payent pas de mine, mais il faut bien admettre que leur simplicité exprime un authentique génie. Dès lors qu’on les regarde d’un peu près, on se dit qu’elles semblent avoir été conçues tout exprès pour les chefs-d’œuvre qu’elles instaurent. C’est comme si la langue française avait été arrangée dès l’origine pour permettre ces combinaisons de mots parfaites, combinaisons qu’il appartenait à des gens tels que Proust ou Camus de découvrir. Gould songea qu’il existait peut-être, dispersé dans l’air ambiant, une – 5 – sorte de troupeau de premières phrases parfaites que seuls les grands écrivains pouvaient voir et capturer. Et comme un grand écrivain, par définition, écrit de grands livres, les grands livres ont toujours des premières phrases parfaites. Gould sortit de sa bibliothèque ses livres favoris pour n’en lire que les premiers mots. Non sans surprise, il constata que plusieurs génies avaient eux-mêmes inventé des stratagèmes habiles pour ne pas avoir à se donner de peine avec le commencement. — Certains recouraient à l’exergue. Gould, on l’a vu, n’était pas favorable à ce procédé, mais il estima que l’usage qu’en faisaient les grands écrivains n’était pas condamnable. Il n’y a rien de commun entre un écrivaillon qui refuse d’affronter son angoisse de la première phrase en citant un classique et un génie qui salue un semblable en lui empruntant une formule. Pour ce dernier, l’exergue n’est qu’une ruse pour exprimer son appartenance à la communauté des grands esprits, non un bouclier sans lequel il n’oserait partir à l’assaut de son propre livre. À tout prendre, à partir d’un certain niveau d’excellence, les grands écrivains deviennent une seule et même personne, ils se transforment en autant de figures particulières d’un même qui s’appelle littérature. Gould voyait le monde des grands écrivains comme une sorte d’assemblée de la Table ronde où chaque partie est le tout et le tout chaque partie. Peu importe donc, dans cette optique, que la première phrase du livre du grand auteur X ait en réalité été écrite par le grand auteur Y : dans les deux cas, il s’agit de grande littérature. Reste l’hypothèse du grand auteur X qui, en exergue de son chef-d’œuvre, placerait une citation de l’auteur de navets Z. mais l’idée dégoûtait tellement Gould qu’il refusait d’y penser. — Dans Lolita, Vladimir Nabokov avait eu l’idée habile de faire précéder le texte proprement dit d’un avant-propos rédigé par un médecin imaginaire, le docteur John Ray. C’était astucieux : personne n’aurait eu l’idée d’exiger d’un document médical qu’il fasse preuve de qualités de style particulières. On ne choisit pas son toubib pour sa plume. Nabokov se débarrassait ainsi de l’angoisse du commencement sur John Ray et pouvait alors écrire le cœur léger, sans torture. Cela revenait en quelque sorte à inventer soi-même son propre exergue, en l’attribuant à un personnage fictif dont le style n’était pas la préoccupation principale. — Oscar Wilde, en revanche, avait choisi la difficulté. Son Portrait de Dorian Gray débutait par – 7 – une déclaration d’intention tonitruante, d’une somptuosité sans égale, qui laissait le lecteur littéralement KO. « L’artiste est un créateur de beauté », disait la première phrase de cette préface. Gould comprit qu’elle faisait partie intégrante du texte et que le courageux Wilde n’avait pas faibli face à l’ennemi : elle explosait littéralement comme un soleil, et il ne l’en admira que davantage. — La Montagne magique de Thomas Mann, elle aussi, commençait par un long « Dessein » à propos duquel Gould arriva à des conclusions identiques : la préface était déjà le texte, et Mann avait affronté l’appréhension de l’attaque avec toute la bravoure qu’on est en droit d’attendre d’un si grand homme. Musil, Joyce, Faulkner, Powys, Lawrence, Orwell, Céline, Döblin, tous avaient des premières phrases d’une étonnante perfection. Au fur et à mesure de ses recherches, Gould s’interrogea sur sa méthode : n’eût-il pas été plus judicieux, plutôt que de s’éparpiller ainsi, de se contenter d’étudier la manière d’un seul génie ? Et n’y avait-il pas quelque chose de ridiculement prétentieux à n’étudier que les plus grands ? Des premières phrases tirées de livres médiocres et de romans de gare l’auraient peut-être instruit de façon plus réaliste sur la façon d’exorciser sa peur. Voulait-il donc réussir du premier coup à tourner une phrase liminaire comparable à celles d’un Walser ou d’un Sterne, lui qui n’avait jamais été fichu d’écrire un livre faute de pouvoir le commencer ? Il y réfléchit quelques instants et rejeta l’argument. Certes, il aurait été plus modeste d’étudier les premières phrases d’œuvres moins grandioses que celles auxquelles il s’était attaqué, mais se choisir délibérément un mauvais maître est une attitude profondément antipédagogique. Qui veut s’initier à la peinture gagne à contempler Matisse plutôt qu’une croûte champêtre. En bonne logique, cela vaut aussi pour la littérature. Quoi qu’il en soit, l’étude des premières phrases de ses romans favoris n’aida pas Gould comme il l’aurait souhaité. Il retira de ses lectures une impression ambiguë. Parfois, il se sentait prêt, se disant qu’après tout la barrière n’est que psychologique, que les premiers mots ne comptent pas tellement plus que les suivants ; c’est une question de volonté et d’état d’esprit, cela n’a rien à voir avec une prétendue insaisissabilité ontologique de la phrase en question. Mais à d’autres moments, il se disait qu’il n’y arriverait jamais, que la première phrase était une bête trop forte pour lui, que seuls les vrais grands écrivains étaient capables – 9 – de se mesurer à elle. Il était alors gagné par l’abattement et se réfugiait dans le cynisme, songeant à utiliser la carte déloyale de la parodie (ce qui aurait donné quelque chose comme : « Aujourd’hui, maman est morte, et ça ne m’a pas empêché de me coucher de bonne heure »). Effondré, il avait l’impression que la première phrase parfaite, celle qu’il cherchait depuis si longtemps, le narguait comme un canard vicieux. Cruelle et fielleuse, elle lui faisait ressentir à quel point il était médiocre, indigne des grands. uploads/s3/ l-angoisse-de-la-premiere-phrase-bernard-quiriny.pdf
Documents similaires








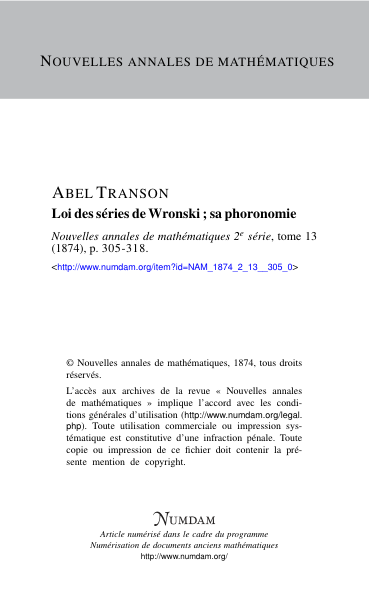

-
73
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 04, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 1.0808MB


