L’objet de mon propos est de rendre compte de ce genre spécifi que d’ac- tivisme
L’objet de mon propos est de rendre compte de ce genre spécifi que d’ac- tivisme esthétique qu’est l’interven- tion artistique en milieu urbain et de pointer les évolutions de ce genre d’art, moins soucieux de représen- tation que de « présentation » en n’omettant pas une de ses perversions postmodernes, qu’il convient d’ana- lyser : la tentation, pour l’industrie culturelle de changer ces formes d’art « en contexte réel » en une création intégrée, festivalière et relevant de l’animation distractive, de changer ces formes d’art en ce qui pourrait bien servir à l’occasion d’alibi aux po- litiques d’intégration sociale, au nom de la nécessaire restauration du lien social. Où l’on verra, en l’occurrence, qu’il y a débat. L’ESPACE PUBLIC COMME ESPACE D ’ATTRACTION Entre les territoires humanisés, l’es- pace public de la ville se qualifi e avec la modernité comme un espace de forte attraction. L’univers pacifi é de la campagne, longtemps, avait attiré les artistes œuvrant « sur le motif » (mode poussinienne du paysage ro- main, paysagistes fl amands, école de Barbizon…). Le développement urbain qui accompagne, tout au long du XIXe siècle, la révolution indus- trielle, périme cette dilection. La ville devient alors un « chronotope » es- sentiel, hautement magnétique, de la création moderne. En pleine extension spatiale, phy- siquement transformée (New York comme la « ville debout » que célèbre Bardamu dans Voyage au bout de la nuit, de Louis-Ferdinand Céline), transfi gurée par les activités nou- velles de l’industrie et du commerce de masse, de plus en plus indéfi nie aussi (ses limites reculent sans cesse, à l’origine des phénomène de la co- nurbation, de la « ville infi nie »), la ville est comme l’analogon d’une créa- tion artistique moderne elle-même en butte aux démons de l’expansion, du débordement et de l’activisme. Les impressionnistes, ainsi, la cé- lèbrent (Monet, La rue Montorgueil pavoisée), de même que les futuristes (Boccioni, La ville qui monte), les da- daïstes puis les surréalistes en font un théâtre pour des actions d’un genre nouveau, de type intervention, le ci- néma expressionniste l’élit comme un constituant décisif de l‘« écran démoniaque » (Lotte Eisner), sinon comme un personnage à part entière (Fritz Lang, Metropolis). Lieu d’une activité continue, la ville née de la révolution industrielle s’érige de concert au rang d’espace public par excellence, le périmètre groovy qui la défi nit étant dès lors appréhendé de deux façons par l’ar- tiste qu’inspire la ville. D’une part, de façon de plus en plus obsolète, comme un spectacle, à la manière de la Neue Sachlichkeit allemande ou de la peinture réaliste d’un Edward Hopper au début du XXe siècle – le DÉBATS Comment dresser un inventaire raisonné des principales formes d’intervention artistique en milieu urbain repérables aujourd’hui ? Quelles formes prennent ces interventions ? L’artiste – un plasticien, ou un artiste venu du spectacle vivant – se saisit de la ville et donc, du public, pour insérer en celle-ci des créations pas forcément attendues, en général non programmées, qui sollicitent – parfois sans ménagement – l’attention des passants. L’IMPLICATION DE L’ARTISTE DANS L’ESPACE PUBLIC* Paul Ardenne l’Observatoire - No 36, hiver 2009-10 - débats | page 3 page 4 | l’Observatoire - No 36, hiver 2009-10 - débats regard s’exerce ici de façon tradition- nelle, depuis le dehors, tandis qu’est reconduit le classique principe de l’art comme formule de représenta- tion. D’autre part, de façon cette fois plus expérimentale, comme l’occa- sion d’un échange, d’une rencontre en prise directe avec un public. Le fait même de la proximité physique de l’artiste à son objet d’étude, dans ce cas, fait passer au second plan la question de la représentation. L’art dit « public », jusqu’alors avait relevé exclusivement de la déci- sion ou de la commande offi cielles, et s’incarnait pour l’essentiel dans l’élévation de statues au milieu de squares ou le long d’avenues, sur un mode somptuaire, de célébration ou de propagande. De la même façon, le monde du spectacle vivant était cantonné dans ses lieux tradition- nels de représentation pérennes ou éphémères et nomades : la salle de spectacle, le chapiteau du cirque. Tout change avec la modernité, qui concrétise un principe de « sor- tie ». Dorénavant, en effet, l’artiste « sort » de plus en plus fréquemment en ville, avec cette conséquence esthétique : l’expression artistique mute. Naissance de l’intervention artistique, du happening au dehors, dans ce vaste « atelier sans murs » (Jean-Marc Poinsot) qu’est l’univers de la rue. VERS UN ART « D’INTERVENTION » EN MILIEU PUBLIC Les premières interventions artis- tiques en milieu urbain combinent fréquemment univers des arts plas- tiques et univers des arts du spec- tacle. C’est le cas dans les premières années de l’Union soviétique, notam- ment. L’art d’« intervention » qui se met alors en place se qualifi e par son goût de l’intrusion, et parfois par ses velléités de clandestinité, et de provo- cation : interventions, par exemple, du Bread and Puppet Theater, ou du Living Theater, dans les années 1960, qui participent ouvertement, dans cette agora élargie qu’est la rue amé- ricaine, à divers mouvements de pro- testation, contre la guerre du Viet- nam par exemple. En termes esthétiques, l’art d’inter- vention en milieu public se carac- térise d’abord par un mouvement d’extraction physique hors des lieux traditionnels d’exposition ou d’ex- pression que sont musées, galeries d’art et salles de spectacle : l’art qui investit la rue, en bonne logique, en appelle directement aux spectateurs, soit parce qu’il s’éprouve dehors, en plein air, soit parce qu’il réclame du public, au sein de l’espace public même, un geste, une participation. Le plasticien Daniel Buren, pion- nier dans ce domaine, choisit dès les années 1960 de montrer son tra- vail dans la rue : ce qu’il appellera la création « in situ ». Il s’adonne par exemple à l’« affi chage sauvage » dans le quartier parisien de l’Odéon puis, internationalement, à proximité des lieux abritant de grandes expositions ou au hasard. L’artiste, qui répugne ici à l’offi cialité de l’art décoratif traditionnel, utilise l’espace public comme espace de libre appropriation physique, en s’adonnant à des perfor- mances réalisées de façon impromp- tue, sans avertissement. Jochen Gerz dessine sur les murs, les membres du groupe Untel tentent une Appropria- tion du sol urbain, Ben et Didier Cour- bot s’auto-exposent. Le Thaïlandais Manit Sriwanichpoom crée le Pink Man, personnage toujours vêtu d’un costume rose poussant devant lui un “Les premières interventions artistiques en milieu urbain combinent fréquemment univers des arts plastiques et univers des arts du spectacle. (...) L’art d’« intervention » qui se met alors en place se qualifi e par son goût de l’intrusion, et parfois par ses velléités de clandestinité, et de provocation...” l’Observatoire - No 36, hiver 2009-10 - débats | page 5 caddie rose (le rôle en est tenu par un ami de l’artiste, l’acteur-écrivain Sompong Thawee) : une fi gure bien réelle déambulant entre supermar- chés et galeries marchandes de Ban- gkok pour y mettre en scène, à même ses lieux de prédilection, le consom- mateur middle class, ce produit social du boom thaïlandais de la dernière décennie, fi gure à la fois embléma- tique et caricaturale. Et ainsi de suite, dans une liste impossible à clore. L’artiste qui intervient en milieu ur- bain – c’est-à-dire, hors des cadres de la permission institutionnelle – n’est pas sans s’« emparer » du lieu public, il est d’abord question, comme disent les artistes activistes québécois, qu’il y « manœuvre » à sa guise, et qu’il y fasse ce qu’il veut. L’apparition de ce type d’art d’intervention, à cet égard, n’est pas le fait du hasard. Elle corres- pond à un double sentiment. D’une part, le sentiment que la création est à l’étroit dans l’atelier ou la salle de spectacle, des lieux de moins en moins représentatifs d’une création moderne qui veut se saisir du monde réel, propice à occuper l’espace dans son entier, sans restriction. D’autre part, le sentiment qu’un doute doit être émis quant à l’art offi cialisé par les structures institutionnelles, réser- vé à une élite ou conditionné par des critères esthétiques complexes qui en interdisent le plus clair du temps l’ac- cès culturel au grand public. D’un point de vue esthétique, non sans raison ni mobile, l’art d’inter- vention va ainsi se caractériser le plus souvent par des propositions qui, pour contrastantes et en porte-à-faux qu’elles soient, entendent bien de- meurer le plus possible élémentaires, d’une lisibilité, sinon d’un sens, im- médiats : happenings, processions, bannières, installations éphémères, public pris à parti. La notion de « contexte », du coup, s’avère fonda- mentale. L’intervention ne s’accom- plit jamais au jugé, elle implique un principe de confrontation, elle vise l’agrégation ou la polémique, jamais le consentement tacite ou mou. La non-pérennité est aussi le lot des formes d’art public ou d’expression scénique non programmée, dont le destin est de disparaître rapidement. En dérive une expression artistique qualifi able de contextuelle, activiste et volatile, suscitant l’acquiescement ou l’ire des pouvoirs publics, qui laissent faire ou interdisent selon uploads/s3/ implication-de-l-artiste-dans-l-espace-public.pdf
Documents similaires








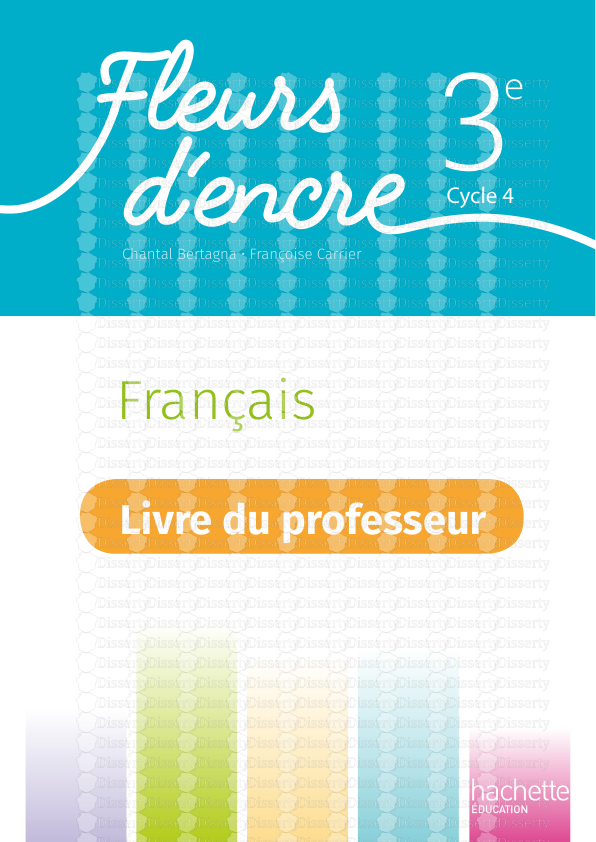

-
130
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 22, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1320MB


