Grammaire universelle. Livre premier. Définitions et autres préliminaires. Chap
Grammaire universelle. Livre premier. Définitions et autres préliminaires. Chapitre premier. Objet de cet ouvrage. Les avantages que les Hommes retirent de l'Art par lequel ils peignent leurs idées, sont inappréciables : cet Art est la base de la Société & la source des douceurs qu'on y éprouve. Par cet Art admirable, qui nous distingue de tous les autres Êtres, nous manifestons nos besoins, nos craintes, nos plaisirs, nos lumières ; nous recevons de la part des autres les secours, les conseils, les avis, les connoissances qui nous sont nécessaires. Par lui, une ame se dévelopant à une autre, 1acquiert toutes les perfections dont elle peut être susceptible : sentimens du cœur, feu du génie, richesses de l'imagination, profondeur d'esprit, tout devient un bien commun aux hommes : les connoissances de l'un, font les connoissances de tous : ainsi en ajoutant sans cesse découvertes à découvertes, arts sur arts, lumieres sur lumieres, l'esprit de l'homme s'embellit, s'agrandit, se perfectionne sans cesse ; s'embrâsant mutuellement, il s'éléve aux plus grandes choses, rien ne lui paroît au-dessus de ses forces, il ose tout, & tout paroît s'aplanir devant son audace : tandis que sans cette émulation, l'homme seul, isolé, plongé dans une langueur stupide, n'auroit presqu'aucune supériorité sur les Animaux qui vivent en famille, & que des cris avertissent de leurs besoins mutuels. Mais l'Homme ne peint pas seulement ses idées à ceux qui l'environnent, & au milieu desquels il vit ; comme s'il remplissoit la T erre, comme s'il vivoit dans l'étendue des siécles, il a trouvé le moyen de peindre ses idées d'une maniere qui les rende sensibles à ceux dont il est éloigné, comme s'ils étoient sous ses yeux : la peinture de ses idées, si dégagées de toute matiere, prend la consistence du marbre, elle se transporte d'un bout du Monde à l'autre, elle pénétre à travers l'immensité des âges. Ainsi l'esprit de tel Homme est présent pour tous les Peuples, lors même que cet Homme n'est plus : ainsi nous pouvons profiter des connoissances, des charmes de la conversation, du génie de tous les Sages, dans quelque tems & en quelque lieu qu'ils ayent existé. En vain, les Hommes ont vécu épars, à de grandes distances & dans des époques prodigieusement éloignées : leur esprit se concentre en un seul point, & toujours leur génie anime & rejouit les Mortels ; d'autant plus grand qu'il s'étend sur la Nature entiere, qu'il en emprunte les couleurs & les graces ; qu'avec elle, il tonne, il fulmine, il éclate ; & qu'après nous avoir agités & émus par les T ableaux les plus terribles, s'adoucissant avec elle, il nous charme par les accens les plus doux, par le coloris le plus flatteur & par la peinture des objets les plus délicieux. Par quel moyen l'homme est-il parvenu à cet Art admirable ? Comment a-t-il pu descendre au dedans de lui-même, démêler ce qui s'y passe, saisir les T ableaux qui s'y forment ; & se repliant hors de lui, rendre ces T ableaux sensibles aux hommes, toutes les fois qu'il espéroit quelqu'avantage de cette communication ? Depuis que le Monde existe, l'Homme n'a pu être insensible à ces merveilles : déja depuis long-tems, il a dû rechercher comment elles s'opéroient ; 2& les régles nécessaires pour les exécuter de la maniere la plus propre à produire les effets qu'on en attend : déja, nombre de Savans distingués, se sont exercés sur cet objet. Ils sont allés aussi loin qu'on pouvoit aller ; & si leurs Ouvrages ne produisent pas tout l'effet qu'on en devroit recueillir, s'ils paroissent quelquefois trop métaphysiques, si l'on n'en voit pas les diverses Parties naître les unes des autres avec toute la clarté qu'il seroit à désirer ; s'ils nous apprennent plutôt ce qui est, que les raisons de ce qui est, ne nous en prenons pas à eux ; ce n'est nullement leur faute ; ce n'est ni manque de soins ni infériorité de génie : ils ne pouvoient faire autrement, parce qu'ils n'avoient encore pu remonter à l'origine primitive du langage, & parce qu'on n'avoit pu par-là même ramener l'art de peindre les idées à un principe simple & sensible, qui devenant le fondement de cet art, portât dans toutes ses parties une vive lumière, & les rendît aussi énergiques qu'elles sont sans lui froides & pénibles. Nos recherches sur les connoissances primitives des Hommes, & sur les causes de ces connoissances, ont dû au contraire nous conduire à ces premiers principes, qui une fois donnés, deviennent le fondement de cet Art & la raison de ses régles. Ce sont ces recherches que nous mettons ici sous les yeux du Public, sous le nom de Grammaire Universelle. Nous dirons moins en quoi consiste cet Art, que nous ne le laisserons deviner à nos Lecteurs : ils présideront eux-mêmes à sa formation ; ils verront naître ses préceptes : dépouillé ainsi de sa fine métaphysique, qui faisoit croire qu'il étoit au-dessus des forces d'un commençant, il sera tout en action ; & il deviendra intéressant pour ceux qu'on destine à l'étude des Langues, dont cet Ouvrage sera une clef indispensable, ainsi que de toutes les Grammaires qu'on a déja composées, qui n'en seront que des conséquences & qui en deviendront plus utiles.3 Chapitre II. Etymologie ou origine du mot GRAMMAIRE. Mais comme ce mot GRAMMAIRE est barbare pour nous & ne présente par lui-même aucune idée à notre esprit, remontons à son origine ; nous verrons combien on eut raison de le choisir ; & il nous préparera en quelque sorte lui-même à tout ce que nous aurons à dire. Car telle est l'utilité de l'Étymologie, qu'elle rétablit l'énergie de chaque mot & en fait voir à l'instant la valeur, qu'avoient obscurcie la longueur des siècles & les altérations successives des Langues. Ce mot qui paroît avoir été inventé par hazard, parce qu'il n'offre dans nos Langues modernes, & même dans celle des Latins, aucun raport avec l'Art qu'il désigne, étoit cependant très-expressif dans la Langue de ceux qui le consacrerent à cet usage. Il vient du Grec GRAMMA, qui signifie une Peinture, un T ableau, & qui, prononcé GRAB, GRAV ou GRAF, fit dans la même Langue les mots GRAPH-eus, un Peintre, & GRAPH-ein, peindre. De cette racine, se forma en Grec & en Latin l'adjectif Grammatica, qui désignoit manifestement chez eux l'Art de peindre ; mot que nous avons adopté & altéré ensuite en celui de GRAMMAIRE, qui ne peint plus rien à l'esprit. Ce mot n'est pas même d'origine grecque : il leur étoit commun avec les Celtes & avec les Orientaux qui le prononçoient : ceux-ci, GRAB , ceux-là, GRAFF & GRAPH ; & chez qui il signifioit dans son sens propre & universel, INCISION ; & ensuite les SILLONS d'un champ, qui en sont les incisions ; ensorte qu'il signifia au sens figuré, le LABOURAGE lui-même, qui consiste à tracer des sillons. Il existe encore avec ces divers sens chez les Arabes, qui le tiennent de la plus haute antiquité. Ce mot devenu GREC, signifia chez eux tout ce que peut désigner un T rait : mais en se partageant en deux mots, Graptys & Gramma, Celui de Graptys, offroit ces sens : 1°. Une Incision en général. 2°. Une Incision sur le corps humain, une déchiquetture, ou scarification. 3°. Ces Caractères ou figures qu'on traçoit sur le corps humain en faisant des incisions sur la peau, & qu'on remplissoit de couleurs, comme chez les Sauvages.4 Celui de Gramma offroit ceux-ci : 4°. Un T rait. 5°. Une Ligne. 6°. Une Lettre, parce qu'elles étoient sillonnées ou gravées profondément sur le marbre, &c. 7°. Un T ableau, une Peinture quelconque, qui sont formes de traits. Cest de-là que nous sont venus nos mots GRAVER, avec toute sa famille ; GRAMMAIRE, ORTHO-GRAPHE, GREFFIER, GREFFER, MONOGRAMME. D'un autre côté, le verbe GRAPH-ein, signifiant écrire, s'altéra en passant chez les Latins : il se chargea de la siflante S : A s'adoucit en ai & puis en i : PH en b : ainsi les Latins le prononcerent SCRAIB-ere, comme les Allemans qui le prononçant encore de même, disent SCHREIB-en, pour ÉCRIRE ; & puis SCRIB-ere dont nous fîmes scribe, & escribe, escrire & enfin ÉCRIRE, qu'on ne croiroit jamais être frere de graver, & descendu d'un même pere. Ce mot GRAB ou GRAPH tenoit lui-même à un mot plus ancien & primitif qui subsiste encore dans les Langues Orientales, le mot GRA, en Hébreu & en Arabe KRAH ou Krha, qui signifie incision ; faire une incision ; & qui est lui-même une onomatopée, l'imitation du bruit que l'on fait en déchirant, en fendant, en faisant une entaillade ; que nous peignons par notre Cri-Cra ; & qui a formé un grand nombre d'autres familles. C'est ainsi qu'en remontant à l'origine des mots, on voit qu'ils porterent toujours leur signification avec eux ; & que puisés dans la Nature, ils en eurent toujours l'énergie.5 Chapitre III. Définition de la GRAMMAIRE, & sa uploads/s3/ ling-court-de-gebelin-grammaire-universelle.pdf
Documents similaires
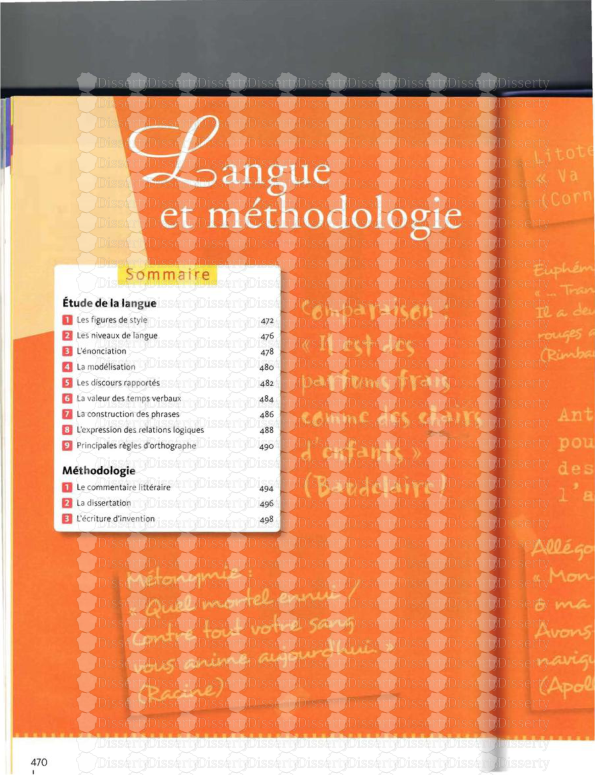









-
46
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 10, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 2.1981MB


