1 VIGGO BR0NDAL ESSAIS D~ L~NGUISTI~ GENERALE PUBLIÉS AVEC UNE BIBLIOGRAPHIE DE
1 VIGGO BR0NDAL ESSAIS D~ L~NGUISTI~ GENERALE PUBLIÉS AVEC UNE BIBLIOGRAPHIE DES OEUVRES DE L'AUTEUR EJNAR MUNKSGAARD COPENHAGUE 1943 Co/Jyrighl 1943 by p;,J NAJ: ~fUNKSGAARD, CO PEN HAGEN Printed in Demnark V ALD. PEDERSENS BOGTRYKKERI K0BENHAVN A la mémoire de NICOLAS TROUBETZKOY Le Prince Nicolas de Troubetzkoy, fils du directeur de l'Université de Moscou, spécialiste des études cau- casiques, sauvé miraculeusement de la Révolution 1917, réfugié à Constantinople 1919, puis lecteur à Sofia 1920, enfin professeur de philologie slave à Vienne 1922, mort prématurément à l'âge de 48 ans 1938. - Aux congrès de La Haye 1928, de Genève 1931, de Rome 1933 et de Copenhague 1936, ses idées s'étaient peu à peu imposées. - Sur les détails de sa vie et de son oeuvre, lisez le remarquable article de son ami et collaborateur intime que nous avons publié à Copen- hague : Roman Jakobson, Acta Linguistica vol. I, 1939, p. 64-76. \ AVANT-PROPOS A la mort de Vwao BR0NDAL, les douze premiers chapitres de ce recueil se trouvaient déjà imprimés. L'auteur avait l'intention d'y ajou- ter trois articles nouveaux, ainsi qu'une préface. La mort est venue interrompre ce travail. Pour les chapitres sur la constitution du mot et sur les formes fondamentales du verbe et pour la préface, il n'a laissé que des esquisses très succinctes, pour le chapitre sur la dérivation rien. Mais avant sa mort il nous avait communiqué les idées qu'il comptait développer dans ces articles. C'est pourquoi nous nous som- mes permis de les faire paraître ici, sous une forme dont nous sommes seuls responsables, et en soulignant que les idées ne sont pas non plus présentées sous l'aspect définitif que leur aurait certainement donné l'auteur lui-même. Nous avons cru faire oeuvre utile en y ajoutant . enfin un seizième chapitre dont le sujet touche de très près aux autres essais du volume. Pour établir ce texte, nous avons utilisé un manuscrit, malheureusement très sommaire, d'une conférence faite devant un auditoire très restreint, comme introduction à des études grammaticales. Cette conférence était la première esquisse d'un livre que l'auteur comptait publier en danois au printemps 1943, pour inaugurer une série grammaticale projetée. Ce chapitre sur la délimitation et la subdivision de la grammaire, le plus général du volume, nous paraît bien fait pour conclure ce recueil d'essais de linguistique générale dont le premier chapitre traite d'un sujet analogue. La comparaison entre ces deux chapitres fournit d'ailleurs la preuve manifeste de l'évolution de la doctrine de l'auteur dont il parle lui-même dans sa préface. RosALL Y BR0NDAL KNUD TüGEBY PRÉFACE Le présent recueil, dont la plupart des articles ont déjà paru ail- leurs, porte pour titre Essais de linguistique générale. C'est pourquoi nous avons supprimé tous les articles de caractère moins général, comme ceux traitant d'étymologie ou de toponymie, et même les essais de pho- nologie : Les systèmes vocaliques ( Travaux du Cercle linguistique de Prague, VI), Sound and phoneme ( conférence faite au Congrès phonétique de Londres 1935 ), The variable nature of umlaut (con- férence faite au Congrès phonétique de Gand 1938 ) . Enfin nous avons supprimé Le Français langue abstraite) conférence faite à Bucarest en 1936, qui formera - ainsi qu'une conférence à l'Institut français de Prague ( 1937 ) - un chapitre d'un volume spécial sur les caractères du français. On trouvera, à la fin du volume, dans une BibliograjJhie comjJlémentaire) de brefs résumés de tous ces opuscules supprimés. Les essais parus ailleurs sont les douze premiers. Nous y ajoutons trois autres que nous faisons imprimer ici pour la première fois. Tous les trois se rattachent, en y apportant des corrections, à nos « Parties du Discours » ( 1928, en danois ) dont nous préparons une édition fran- çaise. Le premier, Constitution du Mot) fait entrer le problème des parties du discours dans l'ensemble de la morphologie. Le deuxième, Théorie de la Dérivation) souligne le caractère secondaire des mots dérivés par rapport aux mots simples. Le troisième, Formes fondamen- tales du Verbe) a pour but de montrer que des formes telles que l'in- finitif, le participe, le gérondif etc. ne représentent pas des sous-classes du verbe, mais des formes flexionnelles de celui-ci. Le recueil présent aura pour résultat, espérons-nous, de faire mieux comprendre notre doctrine linguistique. Cette doctrine, dont on pourra suivre ici-même l'évolution, nous l'avons appliquée tout d'abord à des questions particulières, à des points spéciaux, plus tard nous l'avons développée par une généralisation toujours croissante. Par conséquent elle a été caractérisée au début par une confusion relative qui peu à peu a cédé la place à une plus grande harmonie. PRÉFACE Les caractères de cette doctrine sont aussi simples que généraux 1 • Elle consiste à retrouver dans le langage les concepts de la logique, tels qu'ils ont été élaborés par la philosophie depuis ARISTOTE jusqu'aux logiciens modernes. Il s'agit de deux séries de concepts : les concepts relationnels ( symétrie, transitivité, connexité, variabilité, pluralité, gé- néralité, continuité, totalité, extension, intégrité, universalité ) et les con- cepts génériques ( relation et objet, qualité et quantité ) . Il faut néces- sairement distinguer ces deux séries de concepts, les derniers formant le plus souvent le cadre des premiers dans le langage, mais d'autre part il existe une connexion profonde entre eux, les derniers étant en quelque sorte la cristallisation des premiers. La constitution du langage au moyen de ces concepts est d'ailleurs soumise à certaines règles de corrélation, d'opposition et de solidarité. Ces concepts sont valables dans toute la grammaire, aussi bien en morphologie et en syntaxe qu'en phonologie et en prosodie, comme ils le sont, paraît-il, dans toutes les sciences. Ces idées ne sont pas très éloignées de celles du prince TROUBETZ- KOY. Cette convergence, entrevue par tous les deux dès la fin du Con- grès de La Haye ( avril 1928 ) , et manifeste depuis, a été discutée à Rome ( 1931 ), à Londres ( 1935 ), à Copenhague ( 1936 ), enfin à Brno ( 1937 ) où Troubetzkoy est venu chez des amis communs m'offrir amicalement la présidence de la section linguistique du Congrès psycho- logique de Paris, sa maladie l'empêchant d'entreprendre lui-même le voyage. Ma doctrine se distingue, certes, par quelques différences de détail de la phonologie de Troubetzkoy, mais les deux sont caractérisées par une direction commune, née à la fois de la méditation constante des prin- cipes du langage et de la grande tradition philosophique. C'est pourquoi je dédie ces pages à la chère mémoire de mon ami génial. VIGGO BR0NDAL ( 1) cf. l'importance d'une inspiration unique, idée profonde exprimée pm· HENRI BERGSON au Congrès philosophique de Bologne en 1900. I LE SYSTÈME DE LA GRAMMAIRE On a travaillé de manière bien différente en . ( , . d l l ) " grammaire = theone e a angue : Tantot on a décrit un état de langue considér' , moment donne tantôt on a e't d' , l e a un ' < u Ie es rapports entre 1 · ' ( grammaire comparée et histori ue ) ' . p usieurs etats ont établi les re'gle d' g . D autre part les traditionalistes s une norme donnée . 1 · 1 . le 'b'l' , . . ' es ratwna Istes ont recherché .s poss1 1 1tes et conditiOns générales du lanaaa . . .. vistes enfin ont .insisté surtout sur les variatiOI~s d~a~~~~; ' les positl- est :1: I; :ravall pl~s ou moins organisé de tant d'esprits différents on résume;~:n:~~:~:;~tr~:sq:~s~:::iti~ns grammaticales qui peuve~t se 10 s ons et systèmes de sons. ;: V~leur symboliqu: des éléments phonétiquesl. Syllabe, accentuatiOn. »- ; assimilation et dissi- 4o « .Spr.·achkorper und Sprachfunktr'on " milatiOn, métathèse. 5° s 60 yntaxe phonétique, sandhi, liaisons. Forme extérieure des mots. 7o Parties du Discours. 8° F , ormation des mots, dérivation, composition. ( 1) Cc sujet, traité depuis l'antiquité a été . ' GRAMMONT ( Onomatopées et mots ex 1: . repns d une manière décisive par M. 1901 ), puis par M. JESPERSEN ( L. p csstfs, RLevue des Langues Romanes XLIV V 1 ' anguage andon 1922 1 X r ' a ue of the Vowcl I Ph ·z z · I ' ' c 1. X · Symbolic L ' 1 0 ogzca , Oxford 1922 ) C ' es consonnes géminées en latin Paris Î929 . . : omparez aussi A. GRAUR, théorie de la gémination affecti:e ' qm msiste avec M. MmLLET snr la (2) J' . emprunte cette expression au l' . 1 • ( B ·l' 199 · Ivre Jicn connu d M W er m ~ 1 ) pour exprimer 1 . . , . c · ILHEL~r HoRN volume logique ct le volume phe ~rt~nc!ped dune certame proportionnalité entre le 1906 one Jque cs mots - .· . f' ' ' . par M. WACKERNAGEL ( Wort f p!mclpe ~cond, enonce dès mJe de Gêittingue ) ct J'nti'n1 t 1~~ ang und Wortform, Nachrzchten de l'Acadé- cmcn 1e au « p.· · uploads/s3/ broendal-1943-essais.pdf
Documents similaires


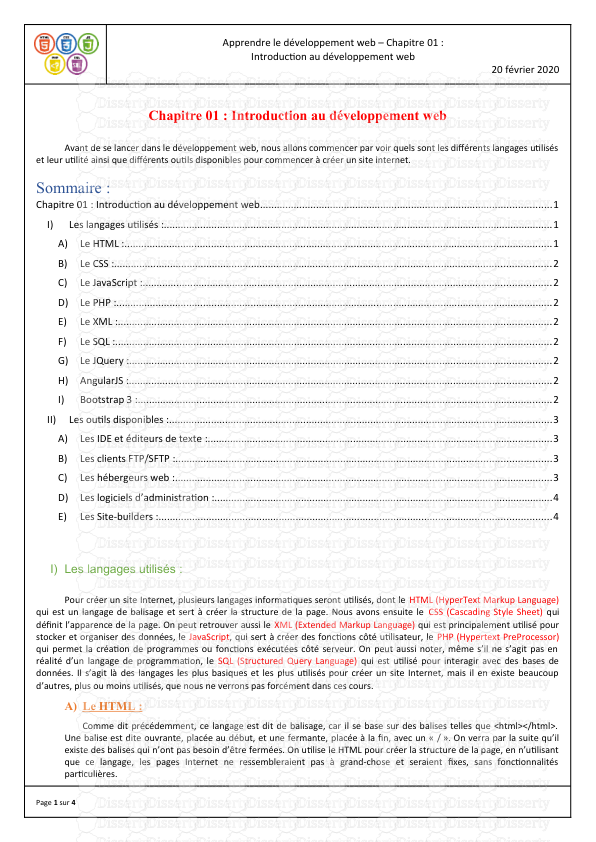







-
77
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 02, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 5.2269MB


