RFDA RFDA 2018 p.397 Droit administratif et droit international (1) Carlo Santu
RFDA RFDA 2018 p.397 Droit administratif et droit international (1) Carlo Santulli, Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II) Exécution des décisions juridictionnelles internationales : le cas de la Cour européenne des droits de l'homme Publiée au Recueil et adoptée en section, une importante décision lue par le Conseil d'État le 22 décembre 2017 (2) apporte des indications précieuses sur l'exécution des décisions des juridictions internationales, notamment celles qui sont rendues par la Cour européenne des droits de l'homme. Le requérant avait fait l'objet d'un premier décret d'extradition tendant à faire droit à une demande de coopération formulée par le Royaume du Maroc dans une affaire où la qualification terroriste avait été retenue par un mandat d'arrêt délivré par le procureur général de Rabat. Saisie par le destinataire de la mesure d'éloignement, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) avait toutefois jugé le 30 mai 2013 que son exécution aurait exposé le requérant à une violation de l'article 3 de la Convention européenne (3). Ayant reçu par note verbale les assurances du Maroc quant au traitement qui serait réservé à la personne poursuivie, le Premier ministre a rapporté le premier décret puis adopté, au vu de ces assurances, une nouvelle décision d'extradition. C'est celle-ci qui a fait l'objet du recours jugé le 22 décembre dernier. Le Conseil d'État annule le deuxième décret motif pris de ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel n'avait pas été saisie une deuxième fois en vue d'autoriser l'adoption du nouveau décret. Le raisonnement du Conseil d'État aurait pu être construit comme une simple interprétation de la législation française relative à la procédure d'extradition pour poser la conclusion qu'il consacre : à nouveau décret d'extradition, nouvelle autorisation du juge répressif. Cependant, la Haute juridiction choisit de rattacher sa conclusion à l'obligation d'exécuter la décision juridictionnelle internationale. Le premier enseignement juridique qui ressort de l'analyse du Conseil d'État doit être inféré du silence de ses motifs. La décision internationale de justice en effet n'est pas un accord international au sens de l'article 55 de la Constitution. Sa nature juridique est certes discutée en doctrine, mais du moins ne permet pas d'hésitation sur ce qu'elle n'est pas : elle n'est pas un traité international. À vrai dire cependant, le débat doctrinal est concentré sur la nature juridique des sentences arbitrales (4) car les décisions judiciaires internationales, elles, sont toutes invariablement issues d'organisations intergouvernementales, y compris le cas échéant d'organisations ayant pour seule fonction d'administrer la juridiction elle-même, comme dans le cas de la Cour pénale internationale. C'est donc bien à une décision individuelle d'une organisation intergouvernementale, non publiée au Journal officiel de la République française, que le Conseil d'État reconnaît, sans le dire, au moins une autorité supérieure à celle des lois. C'est un résultat heureux et il n'est fondé que sur une lecture de l'article 46 de la Convention européenne des droits de l'homme qui pose l'obligation d'exécuter les décisions de la Cour : « Les Hautes parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties ». Il est remarquable que l'article 46 soit rédigé en des termes qui, lorsqu'ils sont insérés dans des accords conclus par la République française, conduisent généralement le Conseil d'État à un résultat opposé, à savoir celui du prétendu défaut d'effet direct (motif pris de ce que le traité se réfèrerait à l'engament étatique au lieu de poser une loi pour les particuliers). Or ici, face à l'évidence du risque de condamnations à répétition en cas d'inexécution des arrêts de la Cour européenne, le Conseil d'État raisonne en termes d'obligation internationale de l'État et exprime la nécessité de rechercher la décision qui permet à l'État d'exécuter ses obligations (et par là même de pouvoir réclamer efficacement l'exécution à ses pairs). C'est ce qu'implique l'alinéa 14 de la Constitution française de 1946 (« La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international ») et une théorie bien comprise des obligations internationales. On ne peut que saluer cette construction tout en regrettant qu'elle n'ait pas encore fait disparaître les références jurisprudentielles à l'obscure théorie de l'effet direct (5). Le silence du Conseil d'État est également remarquable sur un autre point : aucune limite, constitutionnelle ou autre, n'est opposée à l'exécution de la décision de la Cour européenne, et aucun contrôle n'est effectué ni simulé à son endroit. Or il est impossible de ne pas souligner que le Conseil d'État paraît à contre-courant d'une jurisprudence qui se plaît à imaginer des limites caveant et autres so lange, aux décisions européennes (6). Je ne me risquerai pas à saluer un dévouement particulier, spécialement dans une décision qui, on y reviendra, est destinée à ne pas fermer la porte à l'extradition litigieuse. Mais précisément, il me semble infiniment plus persuasif de s'appuyer sur le contenu de l'arrêt européen que sur des spécificités alléguées du droit national. Ce faisant, le Conseil d'État sauvegarde la marge de manoeuvre nationale, y compris la sienne propre, gagne en capacité d'influence et adopte une position qui - signe ambivalent des temps - paraît plus « ouverte » que celle d'autres juridictions suprêmes européennes. S'agissant de la question d'espèce, le Conseil d'État considère que la décision de la Cour européenne quant à l'illicéité de l'éloignement litigieux « ne fait pas obstacle à ce que soit ultérieurement reprise une décision d'extradition à l'égard de la personne réclamée, au vu d'éléments nouveaux de nature à satisfaire aux exigences de la Convention et, en particulier, de garanties apportées par l'État requérant » (mais à la condition, de droit français, que la chambre de l'instruction soit à nouveau saisie). Cette possibilité n'est ni surprenante ni nouvelle. Dès l'apparition de la jurisprudence excluant les mesures d'éloignement vers les États où la personne serait exposée à une violation de la Convention, il avait été admis que l'obtention de garanties permettant d'écarter un tel risque ouvrait la voie à l'éloignement litigieux. Cela avait déjà été le cas à l'occasion de l'exécution de l'arrêt Soering (7), et le Conseil d'État du reste en avait immédiatement tiré les conclusions dans sa propre jurisprudence Davis Aylor (8). Restait alors la question de l'autorité internationale de la chose jugée et, sur ce point, le Conseil d'État adopte une décision qui ne soulève pas d'objection sous l'angle du droit international. Cependant, si elle reprend des principes déjà établis en jurisprudence (9), la décision n'est pas réellement motivée sur la question spécifique qui était posée au juge par les circonstances de l'espèce. Le Conseil d'État en effet raisonne en trois temps. Il considère d'abord « qu'il résulte des stipulations de l'article 46 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la complète exécution d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant un État partie à la Convention implique, en principe, que cet État prenne toutes les mesures qu'appellent, d'une part, la réparation des conséquences que la violation de la Convention a entraînées pour le requérant et, d'autre part, la disparition de la source de cette violation ». Sur ce premier point, on peut se contenter d'observer que la réparation est effectivement le « contenu » de la responsabilité internationale (10) et que c'est bien sa détermination qui est en cause dans une « condamnation » de la Cour européenne des droits de l'homme. Plus obscure est évidemment la référence à la « disparition de la source » de la violation. La Convention n'étant pas un traité portant loi uniforme et les conséquences du fait générateur de la responsabilité étant effacées par la réparation elle-même, la disparition de la source désigne soit la cessation de l'illicite en cas de fait continu, soit une incertaine directive d'opportunité destinée à éviter les violations répétées (11). La première interprétation est dictée par le droit, la seconde rencontre généralement le bon sens et la logique institutionnelle, mais il est difficile de savoir avec certitude ce qui l'emporte dans la décision du collège réuni au Palais-Royal. Ensuite, le Conseil d'État note « qu'eu égard à la nature essentiellement déclaratoire des arrêts de la Cour, il appartient à l'État condamné de déterminer les moyens de s'acquitter de l'obligation qui lui incombe ainsi ». Le concept de décision déclaratoire dans la doctrine juridique française et internationaliste est à ce point protéiforme que la jonction de l'adverbe « essentiellement » décourage d'avancer une hypothèse d'interprétation de l'arrêt qui séparerait cette affirmation de la conséquence qui y est attachée : « il appartient à l'État condamné de déterminer les moyens » d'exécuter la décision. Réduite à cette conséquence, la nature déclaratoire soulignée par le Conseil coïncide avec un principe simple du droit du contentieux international : en l'absence d'habilitation spéciale contraire, il n'appartient pas à la juridiction internationale de choisir entre différents moyens d'exécuter la décision et, par conséquent, les conclusions qui lui demanderaient d'arbitrer entre ces différents moyens ou, plus généralement, de préciser les modalités d'exécution de la décision sont tenues pour irrecevables devant les juridictions uploads/S4/ c-santulli-droit-administratif-et-droit-international.pdf
Documents similaires




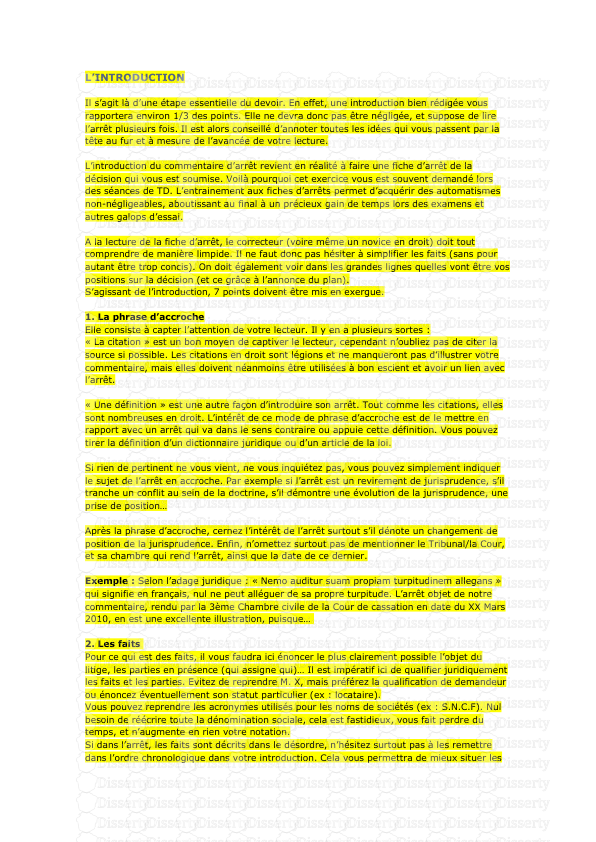





-
40
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 12, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.0905MB


