Contrats spéciaux Introduction I. La source A. La source interne La code civil
Contrats spéciaux Introduction I. La source A. La source interne La code civil 1. la reconnaissance des contrats spéciaux en 1804 sur la loi de 1804, la code civil consacre des dispositions aux principaux contrats, droit commun pour tous les contrats et des règles particuliers pour les contrats spéciaux. Art 1107 code civil « Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce. » Distinction entre les grands contrats et les petits contrats La vente, l’échange, le louage, la société, le dépôt => grands contrats Le mandat, le prêt ; le cautionnement, le jeux, la transaction => petits contrats Distinction entre les contrats consensuels et les contrats réels (inspiré par le droit romain) L’intérêt de la distinction : exigence de la remise de chose La Code civil se débarque du droit romain en écartant la distinction de contrats nommé et non nommé. 2. l’essor des contrats spéciaux après 1804 une grande diversité 1ère évolution : multiplication des contrats- conséquence de - la complicification de shéma économique. Ex : contrat de concession, une nouvelle catégories répondant aux besoins économiques. - La nouvelle téchnologie - La internationalisation des échanges besoin de nouveaux modèles de contrat 2ème évolution : spécialisation des contrats S’agissant des contrats nommés par la code civil, elles se divisent en plusieurs catégories et chaque catégorie correspond aux règles particulières difficulté juridique : faut articuler des règles très spéciales dans les règles particulières, ex : bail = droit civil de contrat ( droit commun) + les règles de louage des choses (règle particulière) + des règles très spéciales 3ème évolution : la volonté de renforcer la protection de l’ordre publique ( l’ordre publique économique) ex : contrat de travail, contrat de consommation, contrat d’assurance Une des parties est présumée d’être plus faible, cela bouleverse le droit commun de contrat. 4ème évolution : l’organisation des source La code civil n’est plus la source première des contrats spéciaux, d’autre disciplines de droit, ex droit de la consommation, droit de la concurrence. droit des contrats spéciaux perd son caractère suppléXXX La jurisprudence Un rôle très actif La jurisprudence complète les disposition du code civil. La cour Ex : question de la détermination dans le contrat, le contrat de prêt, s’agit il d’un contrat réel ou d’un contrat consensuel ? C. Cass : « autant réel et consensuel dépendant de la qualité de prêteur, s’il s’agit du professionnel du crédit => contrat consensuel, sinon, contrat démeure réel (position de 1804) Décision administrative :autorité administrative indépendante -l’autorité de la concurrence Une autorité spécialisée dans l’analyse d’irrégularité de la fonction du marché. Fonction consultative et fonction contentieuse, ex : 8 décembre 2011 l’entreprise lessive, rencontre secret, politique tarifaire promotionnelle commune -la commission des clauses abusives Suppression de certaine clauses abusives Définition des clauses abusives : Article L 132-1 Code de la consommation « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non- professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces autorité indépendantes ne sont pas soumises au hiérarchie traditionnel un contrat légitime au regarde du code civil peut être illicite à ces autorités B. La source internationale les sources supraeuropéennes convention internationale le transport : convention de Bruxelles sur le transport maritime convention montréal sur le transport aérien la vente : convention de vienne sur la vente internationale des marchandises les coutumes internationales les sources européennes 1. droit de l’union européenne 1er temps, timidement intéressé : l’absence de disposition spécifique dans le traité de Rome a tardé les règles des contrats spéciaux. Mais il y avait quand même quelques dispositions, par ex, concernant les consommateurs, - La directive du 25 juillet 1985 sur les produits de santé défectueux transfert en France par la loi du 19 mai 1998, insérés dans l’article 1386-1 à 1386-18 du Code civil. - La directive du 25 mai 1999 sur la garantie des biens de consommation Transfert en France par l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 2ème temps, volonté d’harmoniser le droit des contrats générales et le droit des contrats spéciales. 2. livre vert relatif aux actions envisageables en vue de la création d'un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises du 1 juillet 2010 propose plusieurs enjeux envisageables et aussi plusieurs options possibles : - méthode douce : boîte à outil, rédaction proposition de nouveaux texte dès l’adaption du texte - instrument facultatif de droit européen de contrat. Les parties disposent soit recourir au système national soit droit européen de contrat, un choix autonome. - Méthode dur : harmonisation totale. Règlement de droit européen se substitue au droit national 2 remarques de ce livre vert : - onsensus côté de représentant d’entreprise et s’association consommateur - restitution du champ de la réforme 3. droit du conseil de l’union européenne Convention européenne de droit de l’homme : neutraliser certaines clauses contraires à la convention européenne de droit de l’homme. Ex, arrêt 22 mars 2006, un bail d’habitation, clause interdisant le locataire d’héberger ses membres de famille. La cour de cassation : clause pas valable car contraire à l’article 8 de la convention, contraire au respecte de la vie familiale. II. Les frontières A. la classification des contrats spéciaux identifier : une exercice de qualification, rattacher la situation des faits donnés à une catégorie juridique prédonnée. 1. auteur de la qualification les parties définissent le contrat. L’article 1156 c civ « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. » ici, on est sur la phase de qualification, pas l’intéprétation. Le juge n’est pas lié à la qualification donné par les parties 2. les techniques de qualification l’enjeu c’est d’associer un régime juridique pour déterminer les règles appliquables. La technique principale : recherche de l’obligation principale du contrat Distinction entre l’obligation principale et l’obligation accessoire Une méthode privilégée qui trouve sa source dans le droit international privé 3 critiques - l’obligation caractéristique n’est pas toujours l’obligation au sens stricte. Ex : transfert du propriété n’est pas en soi une obligation - la qualification du contrat dépend moins à l’obligation essentielle que des modalité dans lesquelles exerce la prestation - il est parfois difficile de dégager une obligation principale. 3. les résultats de la qualification - la réussite : le rattachement se faire au profit d’une seule catégories juridique : la qualification unique - rattachement du contrat à plusieurs régimes : la qualification mixte. Ex : un contrat de reportage prévoit prestation de reportage, hébergement…etc. - l’échec : impossible de rattacher à une catégorie identifiée. Ex : le contrat sui generis B. La sélection des contrats spéciaux La justification de la sélection : - certains contrats doivent faire l’objet d’analyse spéciale en raison de l’autonomie de droit civil, ex contrat de travail, contrat d’assurance. D’autres contrats sont trop spécifiques qu’on justifie une étude particulière. C. La classification des contrats spéciaux Regroupement de l’ensemble des contrats spéciaux qui permet d’établir le rapport contractuel en associant le principe commun. Solution 1) classer selon l’importance des contrats : grands contrats et petits contrats 2) classer selon la source des contrats : ceux régies par code civil et ceux règlementés en dehors de code civil. Inapproprié à cause de la décodification 3) classer selon l’objet de l’obligation principale : 3 familles de contrats spéciaux : - contrat pour objet de transférer la propriété : contrat de vente - contrat porté sur un service : contrat de mandat - contrat porté sur les litiges : contrat de la transaction Contrats ayant pour objet le transfert de propriété : contrat de vente Distinction entre contrat de vente et contrat d’échange qui a aussi pour objet le transfert de propriété : dans le contrat de vente, la contre partie du transfert s’est aperçu un montant d’argent, dans le contrat d’échange, c’est un autre transfert de propriété. L’article 1702 « L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. » En principe, l’existence d’un soulte ne modifie pas la nature de contrat d’échange, mais si la soule devient une obligation principale, le contrat d’échange deviendra un contrat de vente. L’intérêt de distinction : contrat d’échange échappe les règles protectrices de contrat de vente. l’évolution du contrat de vente - droit roumain : base du droit positif de vente. Ex : l’article 1641 garanties des défauts de la chose vendue relève de la garantie de XXX du droit romain. L’article 1641 « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui uploads/S4/ contrats-speciaux.pdf
Documents similaires





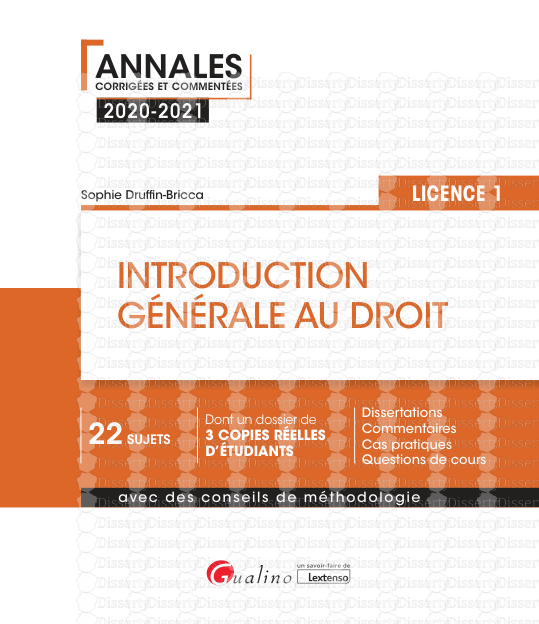




-
44
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 30, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1201MB


