COURS : MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 Les directives non transposées en droit intern
COURS : MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 Les directives non transposées en droit interne produisent des effets juridiques qui sont variables selon Il est fait interdiction à l’administration d'édicter des règlements contraires à ces directives. Il est toujours possibles d’invoquer la méconnaissance des directives Objectif et sanctionner. Pour quelle raison ? ➔l'article 88-1 de la Constitution oblige l'État français a transposé les directives européennes. Le Conseil constitutionnel à consacré l'exigence constitutionnelle de transposition qui oblige l'État à transposer les directives européennes. Cette approche a été encore rappelée dans le dernier arrêt de la fiche (le document 37), rendu par l'Assemblée du contentieux, le 17 décembre 2021. Au considérant 8, il est souligné que : Le respect du droit de l'Union constitué une obligation, tant en vertu du traité de l'Union et du traité sur le fonctionnement qu’en application de l'article 88-1 de la Constitution. Il emporte l'obligation d'adapter le droit interne au règlement européen. Ainsi, après l'expiration du délai de transposition, les règles de droit interne, qui sont incompatibles avec ces objectifs, sont illégales. Pendant le délai de transposition, les obligations, la sanction de la méconnaissance des objectifs est moins forte puisqu’il est simplement exigé à l'administration à ne pas édicter de réglementation qui serait de nature à compromettre la réalisation des objectifs conclus et contenus dans la directive qu'il s'agit de transposer. C'est la solution dégagée en 2001 par l'arrêt Association France Nature Environnement. Les normes internationales était susceptible de produire des effets juridiques en droit interne. PARAGRAPHE 2 : LA PLACE DE LA NORME INTERNATIONALE DANS LA HIÉRARCHIE DES NORMES. La place de la norme internationale dans la hiérarchie des normes est une question controversée. Ce qui fait précisément débat est la question des rapports entre le droit international et le droit (les sources) constitutionnel et les normes législatives. Il y a 2 questions sujettes à débat : ➔la question de la place de la loi par rapport au droit international. ➔Et le droit international par rapport à la constitution. A- la place du droit international par rapport à la loi. La lecture de l'article 55 de la Constitution peut sembler tout à fait claire et sans difficulté. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. Implication : Quand il y a un conflit entre la loi et la règle internationale, c'est la règle internationale qui l'emporte. Toutefois, le Conseil d'État comme le Conseil constitutionnel ont fait une lecture très formaliste de l'article 55 de la Constitution si bien que la supériorité de la norme internationale sur la loi apparaît limitée. ● Première observation : le Conseil d'État fait une lecture formelle de l'article 55 parce qu' il considère que seuls les traités où accords régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à celles des lois. Ce qui signifie que seules les normes internationales contenues dans un traité ont une valeur supérieure à la loi. OUVERTURE : la coutume International public la coutume La coutume tient une place très importante en droit international. Or, le Conseil d'État considère que la coutume n'est pas inclus dans la notion de traité où accord régulièrement ratifié où approuvé. Si bien qu'il considère que la coutume ne prime pas sur la loi, la coutume ou pas supérieure à la loi. C’est ce qu'il a décidé dans cet arrêt du 6 juin 1900 aquaron (Documents 15). Le conseil d’Etat considère que la coutume quand bien même, elle est comprise dans l'expression principe général du droit international public auquel la France a rappelé son attachement à travers le préambule de la constitution de 1946. Toutefois, le Conseil d'État en fait une lecture formaliste. Que suppose cette conception formaliste ? Cela suppose tout simplement qu'il s'en tient au mode d'élaboration de traité. Or , la coutume : ➔elle ne respecte pas. ➔C'est une norme qui est produite par l'usage et la répétition de l'usage. ➔Elle n'est évidemment pas négociée. ➔Elle ne fait pas l'objet d'une ratification. ➔Elle relève des principes coutumiers du droit international public. Ainsi, dès lors que l'article 55 de la constitution ne parle que des traités et des accords régulièrement ratifiés où approuvés, on est obligé d'exclure la coutume. Cependant, le Conseil d'État aurait pu tout à fait décider l'inverse et prendre en considération la coutume. Et considérer que le traité pouvait recevoir une conception matérielle et pas simplement formelle. Le Conseil constitutionnel a également fait une lecture formaliste de l'article 55 de la Constitution. Dès lors que l'article 55 de la constitution énonce que les Traités ont une valeur supérieure aux lois, et que le Conseil constitutionnel contrôle la constitutionnalité des lois, Il aurait dû contrôler la conventionnalité des lois. Puisqu’il aurait pu, sur la base de l'article 55 de la constitution considérer que l'article 55 l'habilité finalement en quelque sorte à contrôler la conventionnalité des lois. Sauf que le Conseil constitutionnel n'a pas suivi cette interprétation, il a toujours refusé d'inclure les normes internationales, et plus particulièrement les traiter dans le bloc de constitutionnalité. La célèbre décision du 15 janvier 1975 concernant la constitutionnalité de loi de la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse. L'un des moyens d’inconstitutionnalité soulevés était que la loi portait atteinte au droit à la protection de la vie. Or, le droit à la protection de la vie n'est pas consacré dans une norme constitutionnelle, mais à la Convention européenne, mais seulement dans la Convention européenne des droits de l'homme. Donc le droit à la protection de la vie, c'est un droit conventionnel et non un droit constitutionnel. En effet, on a un droit à la protection de la santé, mais pas un droit à la protection de la vie dans le bloc de constitutionnalité. Il s'en tenait à une conception formelle du contrôle de constitutionnalité puisqu' il a déclaré qu'une loi contraire aux traités, ne sera pas pour autant contraire à la Constitution. telle se présente la lecture formaliste de l'article 55 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel s'en tient au rôle de juge de la constitutionnalité des lois. A retenir : Cette lecture est une lecture contestable de l'artiste 55 de la constitution. Car à partir du moment où la Constitution reconnaît la supériorité du traité sur la loi. Et bien, il incombe au juge constitutionnel de vérifier que cette supériorité est respectée. Or, une loi qui est au contraire un traité ne respecte pas la supériorité du Traité Cependant, le juge constitutionnel a toujours depuis réaffirme son incompétence. A ce propos, il a signifié ne pas être compétent à l'époque. Il va même renvoyer au juge judiciaire et au juge administratif le soin de contrôler la conventionnalité des lois. Et s'il avait eu une lecture moins formaliste. S'il avait accepté de contrôler la conventionnalité des lois, peut-être qu'il aurait jamais eu de contrôle de conventionnalité des lois devant le juge judiciaire et devant le juge. Mais cette position connaît un tempérament lié à la spécificité du droit européen. En effet, la spécificité du droit européen est depuis la révision du 25 juin 1992, prise en compte dans la Constitution à l'article 88-1 de la Constitution : La République participe aux Communautés européennes, à l'Union européenne, constituée d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont institués, l'exercer en commun, certaines de leurs compétences. Il a déduit de cette disposition, l'exigence constitutionnelle qui oblige l'État français à transposer les directives. C'est ce qui ressort de la décision 496 DC du 10 juin 2004. l’exigence constitutionnel oblige les États à transposer les directives. Dans ce cas, que se passe-t-il ? Les directives peuvent-elles être transposées par une loi ou un règlement (art 34 et 37) ? Prenons l'hypothèse dans laquelle, une directive doit être transposée par une loi. Cette loi est déférée au conseil constitutionnel. Est ce que le juge constitutionnel peut vérifier que la loi a bien transposé la directive? Est ce que la bonne transposition de la directive ne serait-elle pas une exigence constitutionnelle ?. Ce qui conduirait le juge constitutionnel à contrôler d’une certaine manière la loi par rapport à un acte de droit dérivé. NB : la directive n’est pas une convention ! Si on s’en tient à la décision l’IVG, normalement le juge constitutionnel n’est pas compétent, puisque ça reste une décision internationale. Et pourtant, dans cette décision de 2004, le Conseil constitutionnel va ouvrir la voie au contrôle de conventionnalité des lois transposant les directives. Il va vérifier que la loi de transposition Directive a bien transposé les objectifs de la directive. Il va plus précisément vérifier que la loi transposant la directive n'est pas incompatible avec ces objectifs. Problème : cela le conduit à interpréter lui-même le droit de l'Union européenne. Ce qu'il n'a pas vraiment, la possibilité de faire en principe. En raison de ce fait, le Conseil constitutionnel va saisir la Cour de justice de questions d'interprétation du droit de l'Union. La suite de l’analyse montrera que cela conduit d'une uploads/S4/ cours-de-droit-administratif 6 .pdf
Documents similaires
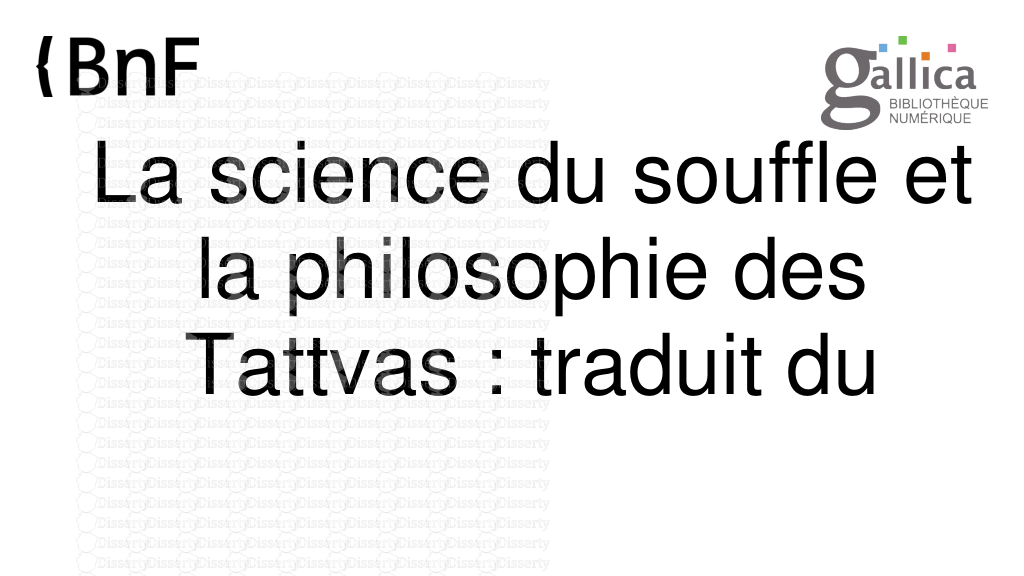









-
44
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 12, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.3431MB


