Droit pénal général L2 Droit La Rochelle Université Année 2020/2021 Plan du Cou
Droit pénal général L2 Droit La Rochelle Université Année 2020/2021 Plan du Cours : Introduction générale Partie I : L'infraction Partie II : L'auteur de l'infraction Partie III : La neutralisation de l'infraction Conclusion générale 1 Introduction générale Droit pénal ou droit criminel ? Longtemps le droit pénal n'a pas porté ce nom, on désignait bien volontiers la même matière sous le vocable de droit criminel et ce n'est qu'assez récemment que le basculement s'est opéré vers l'expression de droit pénal qui s'est généralisée dans la quasi totalité de l'enseignement supérieur français (dans les établissements anglo-saxon l'expression de « criminal law » pour sa part a toujours largement cours). On relèvera qu'en France la référence au droit criminel n'a toutefois pas complètement disparu : – vos enseignants sont des MCF ou des PR en Droit privé et sciences criminelles, – certains services de police sont encore désignés comme Brigade criminelle même si, ici, l'expression à un sens plus étroit, – le service du Ministère de la Justice en charge des affaires pénales est La direction des affaires criminelles et des grâces, On voit donc qu'il y a une certaine difficulté à se séparer de cet ancien vocable de « criminel » et cela pour une raison tout à fait compréhensible : – le vocable de droit pénal est tout à fait explicite : le propre du droit pénal est de mener les individus à une sanction très particulière la peine, qu'aucune autre branche du droit ne pourrait employer, – mais le vocable de droit criminel, lui, oriente vers un autre aspect très spécifique du droit pénal : il s'intéresse à une catégorie bien particulière d'individus les criminels. Les expressions de droit criminel et de droit pénal s'opposent donc mais, en réalité se complètent, car : – le criminel mérite une peine, – la peine s'applique au criminel. 2 Mais alors une nouvelle question se pose nécessairement : si l'on admet que le criminel mérite une peine encore faut il s'entendre sur la notion même de criminel ? Nous allons donc maintenant envisager ces deux manières de concevoir la matière, par le criminel et par la peine. La notion de crime et de criminel Nous commencerons par la notion de droit criminel et donc par la notion de crime et de criminel puisque logiquement la peine ne doit intervenir que dans un second temps, lorsque un crime a été commis et qu'un criminel est appréhendé. Qu'est ce que le crime ? La notion de crime est particulièrement difficile à cerner pour plusieurs raisons : – sa variabilité dans le temps : beaucoup de comportements aujourd'hui considérés comme légaux ont longtemps été considéré comme des crimes (les exemples sont multiples en droit français : l'avortement qui est légalisé en 1975, l'homosexualité qui a longtemps été une infraction mais cesse de l'être en 1971 ou encore le suicide qui n'est plus une infraction depuis 1810). – sa variabilité dans l'espace : certains comportements sont considérés comme répréhensibles dans certains pays alors que dans d'autres ils sont considérés comme légaux. Les exemples évoqués plus haut fonctionnent mais l'on constate également que dans certains pays la consommation de produit stupéfiants et légale tandis qu'elle est strictement interdite dans d'autres. – sa variabilité en terme de gravité : on pourrait croire que le crime est une notion « unitaire » en ce sens que tous les crimes sont comparables, que peut être tous les crimes seraient traités de la même manière : – la sagesse populaire connaît un adage qui accrédite cette idée « qui vole un œuf, vole un bœuf » en ce sens que n'importe quelle violation de la loi pénale est une violation de la loi pénale peu important la faible gravité du préjudice, 3 – en réalité tous les « crimes » ne sont pas tout à fait comparables. Le droit français procède même à une distinction entre les « crimes » en trois catégories selon leur gravité : – les infractions les plus graves, qui mènent aux peines les plus sévères, sont expressément qualifiées de « crimes » : on y trouve essentiellement des infractions contre les personnes telles que le meurtre ou le viol. Les peines encourue pour les crimes peuvent aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. – les infractions de gravité intermédiaires sont qualifiés de « délits » : on trouve ici souvent des infractions contre les biens telles que le vol, l'escroquerie ou encore l'abus de confiance mais également des infractions contre les personnes telles que les agressions sexuelles. Les peines classiquement encourues pour les délits sont un emprisonnement d'une durée maximale de 10 ans et une amende dont le montant maximal est fixé par le législateur. – enfin, les contraventions sont la dernière catégorie d'infraction, classiquement les moins graves. Elles ont la particularité d'être divisée en cinq « classes » de la 1ère à la 5ème, la 5ème étant la plus grave et expose à des peines d'amende de gravité croissante pouvant aller jusqu'à un maximum de 1500 euros pouvant être porté à 3000 euros en cas de récidive. On y trouve beaucoup de choses : les contraventions routières par exemple mais également certaines violence légères exercées contre les individus ou les animaux, – Pour décrire cette grande subdivisions des infractions en trois catégories on parle classiquement de la « classification tripartite des infractions » ou de la classification « cardinale du droit pénal ». Deux remarques méritent toutefois d'être faites : – cette distinction n'est pas que dans la gravité et la peine encourue : selon qu'une infraction appartient à l'une ou l'autre de ces catégories la procédure applicable va énormément changer : les crimes sont jugés par une cours d'assise composé de magistrats professionnels et de jurés populaires après une longue procédure d'instruction, les délits sont jugés par un tribunal correctionnel (rattaché au TJ) composé de 1 ou 3 magistrats professionnels, les contraventions ne font souvent l'objet d'aucun jugement au sens propre et les amendes directement appliquées par un agent verbalisateur. – la plupart des pays du monde n'adoptent pas cette distinction : par exemple en droit anglo-saxon il n'existe que deux catégories d'infractions : les fellonies, 4 équivalent de nos crimes, les misdemeanours, équivalent de nos délits. Les contraventions sont en effet dans beaucoup de pays considérées comme de trop faible gravité pour relever du droit pénal. Elles fond l'objet d'un traitement différencié. En réalité le droit français prévoit un statut vraiment très particulier pour les contraventions mais il persiste à considérer qu'il s'agit d'une composante du droit pénal. En droit anglais, on enseigne presque pas les contraventions comme relevant du droit pénal. On le voit, le crime est variable dans le temps, dans l'espace, en terme de gravité, mais également en ce qui concerne sa dénomination précise : crime / délits / contravention. Ce constat amène à une remarque d'ordre sémantique et à une interrogation plus fondamentale : • Pour ce qui est de la remarque sémantique : C'est peut être cette grande variabilité du crime et fait que le vocable de droit criminel a été abandonné : les crimes ne sont qu'une catégorie de comportement prohibés à coté des délits et des contraventions, parler de droit criminel voudrait donc dire qu'on ne par que du droit des crimes … et pas du droit des contraventions ou des délits : • on parle donc de droit pénal parce que tous ces comportements ont pour trait commun d'amener à une peine, • et pour désigner tous ces comportements (crimes, délits, contraventions) il a fallu trouver un vocable général : celui d'« infractions ». Le droit pénal est donc le droit qui s'appliquent aux personnes ayant commis des infractions qu'il s'agisse de crimes, de délits ou de contraventions. • Pour ce qui est de l'interrogation plus fondamentale : Est-il possible de donner une définition absolue ou invariable du crime ? ◦Cette question est intéressante parce que la plupart des définitions du crimes sont relativement simplistes et sans intérêt. Souvent le crime est défini comme « le comportement qui expose son auteur à une peine ». Pour savoir ce qu'est un crime, il faut donc savoir ce qu'est une peine parce qu'il suffit alors de trouver un comportement passible d'une peine pour conclure que ce comportement est un crime. Toutefois, la difficulté apparaît lorsqu'on s'interroge sur la notion de peine qui est généralement définie comme « la mesure qui vient sanctionner la commission d'un crime ». Le crime 5 est ainsi passible d'une peine qui sanctionne un crime qui est passible d'une peine.. On le voit, la notion de crime serait relativiste : elle ne serait pas absolue elle serait fonction selon les époques et les pays du rejet par le groupe social d'un certain comportement et de la volonté de ce même groupe social d'appliquer à ceux qui adoptent ce comportement une sanction que l'on considère comme suffisamment grave pour être une peine. Les premiers sociologues qui ont étudié le crime au XIXème siècles estimaient ainsi qu'il ne faut pas chercher à définir le uploads/S4/ cours-droit-pe-nal-general.pdf
Documents similaires








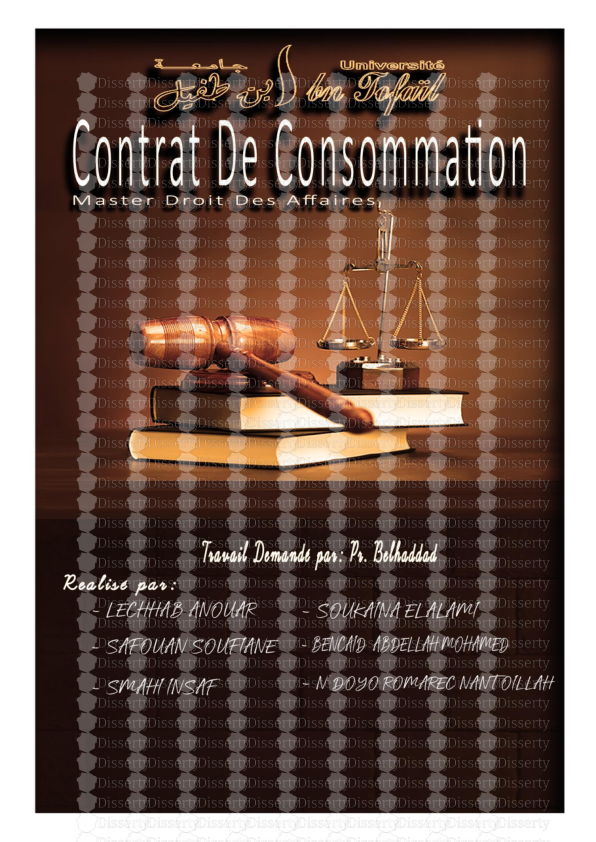

-
53
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 07, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.5274MB


