Introduction 1. Les concepts Les différents sens du mot emploi Du point de vu
Introduction 1. Les concepts Les différents sens du mot emploi Du point de vue historique, l’emploi correspond à un poste de travail, à une place qu’un individu va tenir ( illustration dans l’art 6 de la DDHC: « Tous les citoyens sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics » ). Le terme « emploi » est apparu aussi dans les relations de droit privé pour désigner un simple travail. Dans la distinction entre travail et emploi se dessine une différence de statut qui a perduré aujourd’hui. L’ouvrier était payé à la journée alors que l’employé était payé à la fin du mois et disposait de certains avantages par rapport à l’ouvrier. Le terme emploi utilisé au singulier a un double sens: - Envisagé de manière abstraite, l’emploi désigne le fait pour un salarié d‘avoir un travail et de pouvoir prétendre le conserver. Selon François Gaudu, il est « titulaire » d’un emploi. - Un emploi peut aussi correspondre à une situation de travail spécifié voire même une fonction très précise. Au pluriel, l’emploi correspond à une globalité. L’ambivalence du terme « emploi » se retrouve dans la langue même du législateur : dans la loi Aubry I du 13 juin 1998, l’engagement de maintient de l’emploi se calculait en fonction d’un pourcentage par rapport à un effectif donné. Stabilité, sécurité, mobilité ou flexibilité de l’emploi Stabilité. _ Le concept d’emploi s’est surtout développé dans les 20-30’s avec l’idée de le rendre stable notamment avec la loi du 19 juillet 1928 créant l’actuel article L. 122-12 du code du travail qui a organisé le maintient des contrats de travail en cas de changement d‘employeurs. Influencée par cette stabilité, la jurisprudence privilégie la suspension du contrat plutôt que sa rupture en cas de grève par exemple. Sécurité. _ L’objectif de stabilité a été relayé par la sécurité de l’emploi ( ANI 10 février 1969).Devant l’impossibilité de conserver le salarié dans l’entreprise, en raison notamment de motifs économiques justifiant la rupture du contrat, l’idée s’est fait jour dans les 60’s de faciliter la mobilité de l’emploi. Mobilité. _ En instituant le Fonds National de l’Emploi ( FNE), la loi du 18 décembre 1963 voulait notamment faciliter la mobilité des salariés. L’ordonnance du 13 juillet 1967, qui a institué l’ANPE, poursuivait le même objectif, dans l’optique de lutter contre le chômage frictionnel. Flexibilité. _ La flexibilité est devenue le maître mot en droit du travail dans les 70’s. L’origine de cette flexibilité vient d’un courant doctrinale libérale qui indique que la protection de l’emploi et la protection sociale dessert l’emploi. Certains gouvernements ont donc introduit des techniques flexibles 1979 naissance du CDD ; une ordonnance de 1982 était venue restreindre considérablement le recours aux contrats précaires ; une ordonnance de 1986 qui prévoit plusieurs possibilités de recours au CDD. La flexibilité est devenue aux yeux des employeurs la contrepartie nécessaire au maintien ou à la création d’emploi. Les lois Robien ( 1996), Aubry I et II ( 1998 et 2000), ont facilité l’aménagement du temps de travail tout en le réduisant. 2. Les frontières Recoupements. _ Le droit de l’emploi recouvre une territoire à la superficie incertaine entre le droit du travail et le droit du chômage. Diversité des conceptions. _ Aude Benoît en 1995 a donné au droit de l’emploi une conception assez étroite. Mais en 1997, Jean Pelissier a donné une conception plus large de la matière partant de l’idée que le droit du travail et de l’emploi par finalité. Ainsi Antoine Jeammaud le définit comme « un droit de l’emploi est un corps de dispositions qui saisit la périphérie des rapports de travail en traitant de la formation ou du placement des demandeurs d’emplois ou de l’indemnisation des chômeurs mais aussi en aménageant une aide public à l’embauche, un passage à des situation d’inactivité ou d’activité réduite et en tentant d’engager la création d’entreprises ou d’activités ». 3. Les sources Le droit constitutionnel de l’emploi Droit de chacun à un emploi. _ Le droit constitutionnel de l’emploi a été instauré par le préambule de la Constitution de 1946 auquel il est fait référence dans la Constitution de 1958 : « chacun à le devoir de travail et le droit d’obtenir un emploi ». Jurisprudence constitutionnelle. _ 3 décision successives de 1982, 1984 et 1986 du CC qui ont toutes trait au cumul d’un emploi et d’une retraite et qui ont été rendues sur le fondement du droit à l’emploi. Ce qui est présenté comme une droit subjectif au travail se présente comme un droit collectif au plein emploi qui impose au législateur la recherche comme objective. Dans la décision de 2002 rendue à propos du projet consistant à réduire le domaine du licenciement, le CC a invoqué le droit à l’emploi mais ne la pas fait prévaloir puisque la emporté la liberté d’entreprendre. Obligation d’adaptation. _ La jurisprudence a imposé à l’employeur, dans un arrêt Expovit, d’aider les salariés à acquérir des connaissances nouvelles pour s’adapter à leurs postes de travail. Cette exigence s’est traduite par la nécessité d’offrir une formation au salarié pour faciliter son adaptation. Le manquement à l’obligation d’adaptation prive l’employeur du droit de se prévaloir d’un motif économique pour se séparer de son salarié. Obligation de reclassement. _ L’employeur qui envisage de licencier un salarié pour motif économique doit tout faire pour essayer de le reclasser. La Cour de cassation a décidé qu’un licenciement ne pouvait avoir de motif économique justifié que si, au préalable, l’employeur avait tenté de reclasser le salarié. L’employeur doit donc mettre en œuvre tout ce qui est en son pouvoir pour reclasser son salarié. Apport de la loi de modernisation sociale. _ La loi du 17 janvier 2002 est venue intégralement consacrer à l’art. L 321-1 CT les obligations, créées initialement par la jurisprudence, d’adaptation et de reclassement. Distinction entre obligation de reclassement et droit au reclassement. _ Cette obligation mise à la charge de l’employeur ne va pas jusqu’à offrir au salarié un droit au reclassement L’obligation de reclassement a la nature d’une obligation de moyens. Une législation et une réglementation technocratique La loi est loin d’être le seul outil utilisé pour mettre en place ces dispositifs ; les pouvoirs publics agissent aussi par décrets qui, parfois, se complètent par d’autres décrets ultérieurs, venant ouvrir ou restreindre le champ d’application des dispositifs déjà mis en place. Il faut également compter sur les textes prolifiques qu’édictent les institutions telles que l’ANPE au travers d’instructions et l’UNEDIC au travers de circulaires. Un contentieux en expansion Evolution du Contentieux. _ Pendant longtemps, le droit de l’emploi a été marqué par une quasi-absence de contentieux, significative de l’incapacité des intéressés à prendre quelque initiative que ce soit vis-à-vis d’une application des règles qu’ils ne peuvent que subir. La rareté du contentieux pouvait s’expliquer par la précarité, la manque de moyens et l’impréparation des intéressés en recherche d’insertion. L’accumulation de textes et leur imbrication sont aussi à l’origine d’une incompréhension du droit de l’emploi; le recours au juge devient alors un passage obligé pour obtenir une clarification des dispositifs. Éclatement du contentieux. _ Le conseil de prud’hommes est sans doute la juridiction la plus souvent sollicitée en droit de l’emploi ( contentieux relatif aux contrats d’insertion financés par le FNE sera porté devant les prud’hommes). Le Tribunal de Grande Instance a aussi un rôle important à jouer en droit de l’emploi: il connaît des litiges survenus entre les ASSEDIC et les demandeurs d’emplois indemnisés. Mais le droit du chômage se nourrit également des décisions du Conseil d’Etat, à qui il revient de se prononcer, par exemple, sur la légalité des agréments ministériels des conventions collectives relatives au chômage. Le juge administratif sera également compétent pour connaître des actes de l’administration qui sont nombreux en droit de l’emploi ( contrôler la légalité du refus de signature d’une convention contrôlée par l’Etat ). Le juge pénal peut enfin être saisi en cas de contraventions ou de délits correctionnels ( Art. L 365-1 CT). Un grand nombre de décisions du Tribunal des Conflits portent sur des questions de droit de l’emploi. La négociation collective sur l’emploi C’est à ce niveau que sont posés le problème de la force obligatoire des engagements sur l’emploi et celui de leur insertion dans un schéma donnant-donnant. Les auteurs évoquent à ce sujet l’existence d’accords « partage de travail » pour désigner ceux qui, pour sauvegarder emploi prévoient des sacrifices salariaux, avec ou sans réduction de la durée du travail. Chapitre 1: l’emploi recherché, le service public du placement Le monopole du placement n’est pas seulement dévolu à L’ANPE, mais à un ensemble d’organismes composant le service public du placement. I. Présentation de l’ANPE Depuis sa création en 1967, l’ANPE a fait l’objet de réformes successives, touchant notamment son organisation, qui ont permis d’améliorer les services qu’elle rend pour réaliser son objet principal: assurer le placement des travailleurs. Les réformes successives Création. _ L’ANPE créée par l’ordonnance du 13 juillet 1967 pour remplacer uploads/S4/ droit-de-l-x27-emploi-s2b.pdf
Documents similaires



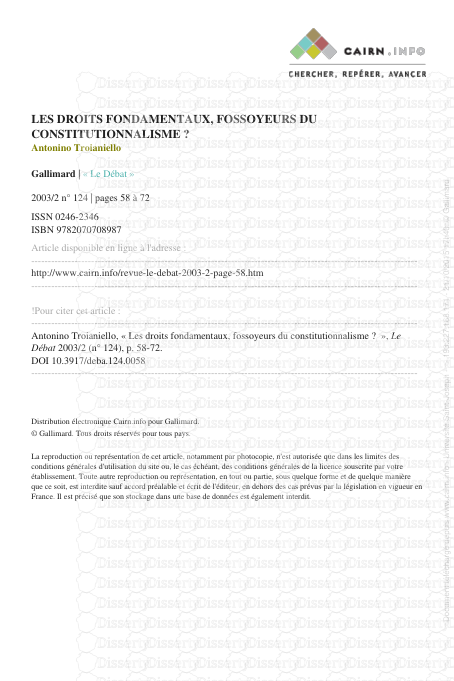






-
98
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 17, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.2929MB


