DROIT PENAL SPECIAL Raisonnement du juge : Se réfère au texte (principe de léga
DROIT PENAL SPECIAL Raisonnement du juge : Se réfère au texte (principe de légalité) : vérifie si l’élément matériel et moral est rempli. Si le juge conclu qu’il n’y a pas d’infraction pénale alors il n’y a pas de responsabilité pénale. En revanche, si le juge estime que l’infraction est constituée dans tous ses éléments il devra déterminer quelle est la personne (ou les) susceptible d’être déclarée responsable de l’infraction. Qui en est pénalement responsable ? Étudier la responsabilité pénale revient à étudier deux notions qu’il ne faut pas confondre : Imputation de la responsabilité : opération technique de la part du juge qui revient à se demander si l’infraction constituée peut être imputée à une personne et donc lui reprocher la commission de cette infraction qui deviendra alors le responsable pénal. On peut être responsable de l’infraction comme auteur ou comme complice. Imputabilité de la responsabilité : il se peut parfois que l’infraction ne soit pas imputable à une personne. Ici, ce sera une opération différente. Elle sera subjective et non objective (intellectuelle et non matérielle) pour savoir si la personne a la capacité de répondre de cette infraction. Dans certains cas la personne peut ne pas y répondre décrit dans la doctrine comme cause d’imputabilité (ex : démence). Pour que la RP d’une personne soit reconnue il faut imputation et ensuite qu’elle ait agi avec son libre arbitre : à défaut de libre arbitre on n’engage pas sa RP. Il y a dans le droit pénal français, il y a deux catégories de personnes : les personnes pénalement responsables, les personnes qui ne sont pas pénalement responsable (vice du consentement) ou personne bénéficiant d’une cause d’atténuation de la RP (mineurs dans certains cas). Le CP actuel s’intéresse à la RP dans le titre II de son livre Ier (dispositions générales) : art. 121-1 à art. 129. Ce titre II du livre Ier contient deux chapitres : 1. Dispositions générales (règles relatives à l’imputation de la responsabilité donc pour les personnes pénalement responsables) art. 121-1 et suivants 2. Des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité : imputabilité et cas des personnes pouvant être pénalement irresponsable ou dont la responsabilité peut être atténuée art. 121-1 et suivants PARTIE 1 : Les personnes responsables : les conditions de la responsabilité pénale Cette opération d’imputation n’est pas compliqué lorsque nous sommes en présence d’une seule infraction commise par une seule personne. Néanmoins, dans le cas de pluralité d’infraction, pluralité de participant et pluralité de victime, cela devient plus complexe. Qui a fait quoi ? Le juge dispose d’un certain nb de règles posées par le Code pénal quant à la détermination des personnes pénalement responsables. Principe de responsabilité pénale personnelle : seule la personne qui a personnellement ou individuellement à la commission d’infraction peut voir sa responsabilité pénale engagée. La responsabilité pénale : personne physique ou, depuis 1994, une personne morale. Deuxième série de règle : que ce soit une personne morale ou physique, elle n’engage sa responsabilité pénale que si elle participe personnellement à la commission de l’infraction en qualité d'auteur ou de complice. Il y a, en droit pénal, deux modes de participation à l'infraction : l'action et la complicité. Cependant, il y a des conditions spécifiques pour les personnes morales ; la volonté d’une personne morale ne s’exprime pas de la même façon qu’une personne physique, de même pour les peines applicables. TITRE 1 : Les conditions communes de la détermination de la personne pénalement responsable Ces conditions communes reposent sur la participation criminelle au sens générique du terme (donc pas forcément un crime mais participation à l’infraction). La participation criminelle doit remplir certains caractères, notamment le caractère personnel ; et elle ne peut adopter que certains modes de participation criminelle. Elle doit donc répondre à certains critères. Chapitre 1 : Le caractère personnel de la responsabilité pénale En droit civil il y a plusieurs faits générateurs de l’engagement de la responsabilité civile : Responsabilité du fait personnel (responsabilité pour faute) Art. 1382 Le fait d’une chose que l’on a sous sa garde 1 Le fait d’autrui (responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs) En droit pénal, la responsabilité pénale repose exclusivement sur le fait personnel. Ce principe est réellement affirmé qu’avec le Code pénal actuel . Section 1 : L'affirmation du principe Sous l’empire de l’ancien code pénal de 1810, le principe du caractère personnel de la responsabilité pénale n’était pas affirmé par le code mais par la jurisprudence. « Nul n’est pénalement responsable qu’à raison de son fait personnel » (jurisprudence de la chambre criminelle) Sous l’empire du Code pénal actuel, la grande nouveauté est qu’on trouve une consécration expresse dans le code pénal : c’est le premier article du chapitre I du titre II du livre I (art. 121-1). « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » Cette consécration officielle n’a pas changé la signification du principe. Il ne faut pas confondre le principe de la RP personnel avec le principe de la personnalité des peines. Le principe de la RP veut dire qu’on ne peut être pénalement que des faits que l’on a commis. Le principe de la personnalité des peines signifie que seule la personne déclarée pénalement responsable qui peut exécuter la peine prononcée et non quelqu’un d’autre. En droit civil, sauf exception, on peut payer la dette d’autrui. Ce principe de la RP personnel vaut, dans l’état actuel des choses, aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Pourquoi ? Parce que le CP actuel, en même temps qu’il consacrait l’art. 121-1, prévoyait la RP des personnes morales. La chambre criminelle s’est assez rapidement intéressée à ce principe dans le cas d’une personne morale notamment dans le cas de la fusion-absorption. Deux arrêts : 20 juin 2000 et 14 octobre 2003. La chambre criminelle : la société absorbante ne peut être déclarée pénalement responsable d’un fait commis antérieurement par la société absorbée. La difficulté est qu’une personne morale et qu’une personne physique est différente : la mort d’une personne morale peut être décidée volontairement (décision volontaire de fusion-absorption) à l’inverse du décès d’une personne physique (sauf dans le cas du suicide). Ainsi, des personnes morales peuvent s’entendre pour tenter d’échapper à la responsabilité pénale. Consciente de cela la CJUE, dans un arrêt du 5 mars 2015 a estimé que des amendes pouvaient être infligées à la suite d’une fusion absorption à la société absorbante. Pourquoi ? Parce que la cour de Luxembourg déclare que si on ne transmet pas les amendes contraventionnelles, la responsabilité est éteinte, et la fusion est un moyen d'échapper aux conséquences des infractions pénales (donc à la responsabilité pénale). La chambre criminelle a, par ailleurs, maintenu sa position dans une décision 25 octobre 2016 n°1680366, arrêt de cassation rendu au visa de l’art. 121-1 : « Un texte ne peut s’interpréter que comme interdisant que des poursuites pénales soient engagées à l’encontre de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée avant l’opération faisant perdre à la société absorbée son existence juridique ». Ainsi, la disparition de la personne morale est vue comme une extinction de la personne physique. Art 6 du CPP : « l’action publique s’éteint par la mort du prévenu ». Il serait pourtant important que la dissolution de la personne morale n’ait pas les même effets que le décès d’une personne physique. Section 2 : La signification du principe On détermine cette signification de deux façons : négativement car elle implique un certain nombre d’exclusion puis positivement pour connaître sa portée réelle Paragraphe 1 : La détermination négative Deux exclusions : Exclusion de l’idée d’une RP collective 2 Exclusion de l’idée d’une RP du fait d’autrui A. Exclusion de la responsabilité pénale collective La responsabilité pénale collective a pu exister de façon très ancienne, avant que la justice publique existe. Seulement, comme souvent, tout principe peut connaître des exceptions ou des limites a. Le principe : Le principe : il n’est pas possible de condamner tous les membres d’un groupe informel au motif qu’une infraction aurait été commise par l’un de des membres du groupes. C’est une exclusion de fond et de procédure. Ex : La chambre criminelle avait statuée par le passé en disant qu’il n’était pas possible de condamner pénalement quelqu’un dont le fait personnel n’était pas établit. De la même façon, au plan de la procédure, lors de manifestations, un certain nombre de manifestants peuvent être traduits en justice. b. Limite : prise en compte de la pluralité de participants : 1. par le législateur Néanmoins, ce principe peut connaître un certain nombre de limites : il est tout à fait possible que le législateur voir la jurisprudence prenne en compte le fait que l’infraction a été commise de façon collective. a. A titre de circonstances aggravante Concernant le législateur, en droit pénal spécial, peut très bien prendre en compte le fait qu’une infraction est mise en œuvre de façon collective ou qu’un uploads/S4/ droit-penal-s4.pdf
Documents similaires
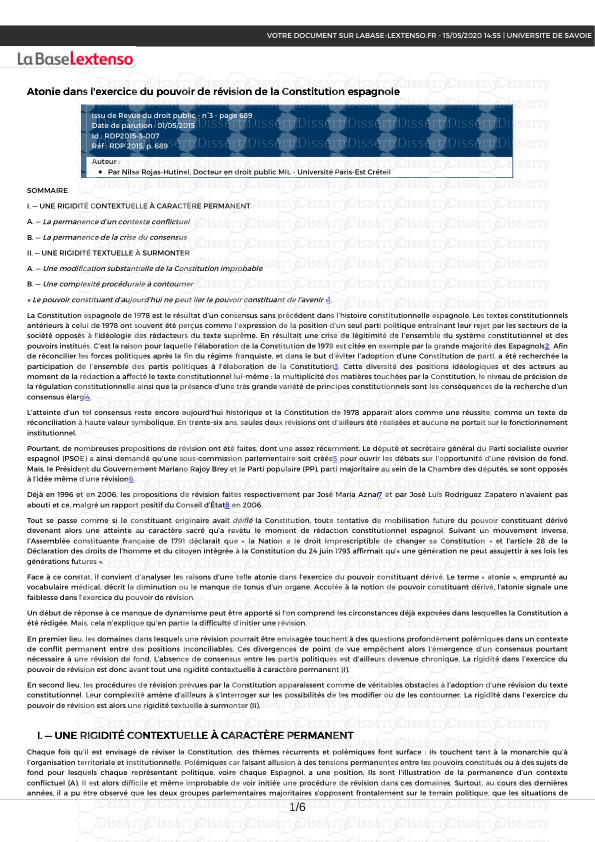









-
72
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 18, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.4882MB


