FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIOI.JE DAIX-MARSEILLE CENTRE D’ETUDES ET DE
FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIOI.JE DAIX-MARSEILLE CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES DHISTO!RE DES IDEES FT DES LNSTITUTIONS POLITIQUES Collection d’Histoire des Instiiutionx ci des Idécs Poliliques dirigéc par Michel G4NZIN Ca/hers Aiois &9lLctoire dks !Droits d (‘Outre-9vler Français N°J PRESSES UNIVERSITAIRES QAIX-MARSEILLE 2002 LA CONDITION JURIDIQUE DE LA FEMME EN NOUVELLE-FRANCE: ESSAI SUR L’APPLICATION DE LA COUTUME DE PARIS DANS UN CONTEXTE COLONIAL Par David GILLES A TE R a Ia Faculte de Droit de La Rochelle <<Ii n est pas etonnant qu en tout pays 1 homme se soft rendu le maitre de Ia femme tout etant fonde sur Ia force II a d ordinaire beaucoup de supriorite par celle du corps et meme de I esprit>> Telle est une pat-tie de I expose peu flatteur de Voltaire concernant Ia femme dans son Dictionnaire PhilosophzqueW A la meme epoque les juristes ne se trou ent pas en reste pour justifier Ia preponderance juridique de I homme sur celle-ca C est ainsi qu un peu plus tot Cardin Le Bret a propos de I exclusion des femmes a Ia couronne de France, ecrit <L exclusion des flues et des males issus des filles est conforme a la by de la nature laquelle ayant cree Ia femme imparfoite foible et debile tant du corps que de I esprit 1 a soubmise a Ia puissance de 1 homme x.m Si les junstes et Ia doctrine aux XVII et XVuIIe siecles ne se montrent guere en faveur de Ia femme et cela en ce qut concerne tant le droit public que le droit prive il n en reste pas moms que pour Ia femme la capacite demeure Ia regle >> et cela tout autant clans les pays de droit ecrit que les pays de coutumes meme si cette capacite est tres Voltaire Dicfwnnazre Philosophique Till (Euvres ed Gamier coil Ciassiques, Paris, 1879, art. e Femmes . (pp. 95-99). p. 96. (2) Cardin Le Bret De la couveraznete du roy Paris 1632 livre I ch 4 (3) Jean Portemer < Le statut de Ia femme en France depuis Ia reformation des coutumes jusqu a Ia redaction du Code civil>> Recueils de La Societe Jean Bodin pour i’Histoire comparative des institutions, T. XII, La femme, Deuxième partie, Bruxelles 1962 pp 447 497 p 453 Cahiers aixois d’histoire des droits de l’Outre-mer francais N° I David GILLES 79 78 fortement encadree L exemple de Ia Coutume de Paris 4 est interessant sur cc point puisque, tout en entravant fortement l’exercice des prerogatives juridiques de Ia femme mariée en Ia subordonnant a son man, elle lui laisse pourtant un certain nombre de portes de sortie pour échapper a cette emprise masculine. La Nouvel1e-France 5 , a partir de 1663 et de Ia dissolution de Ia Compagnie des Cent-Associés, passe véntablement sous le contrôle direct du pouvoir royal Ic territoire de Ia colonie étant mcorpore au domame royal Elle se trouve rapidement conflee aux soms de Ia Compagme des Indes Occidentales en 1664 et Ic restera jusqu’en 1674. La France gardera le contrôle de ses possessions d’Amérique dii nord jusqu’en 1760(6>, date a laquelle Ia Nouvelle France passe définitivement sous contrôle anglais. La Coutume de Paris fut introduite en Nouvelle-France par I article 33 de I edit d etabhssement de la Compagnie des Indes Occidentales du mois de mai 1664 Elle etait déjà presente dans le système jundique du Canada en 1627 par Ia fondation de Ia compagnie de Ia Nouvelle-France (Compagnie des Cent Associés) t7 . Cette application de Ia Coutume de Paris aux colonies d’Ancien Régime est Ia solution adoptée pour l’ensemble des colonies comme Ic remarque Denisart clans son article sir les colonies françaises t8 a l’exclusion de toute autre norme juridique, afin <<d eviter Ia diversite >> Unite juridique donc mats diversaté (4) Sur Ia Coutume de Pans voir notamment les ouvrages de François Olivier Martin, Histoire de Ia Coutume de la prévdté et vicomté de Paris, T. 1, Paris, Cujas, 1972, et de V-A. Poulenc, La Coutume de Paris, Paris, éd. F. Jourdan, 1900. (5) Le terme recouvre un espace géographiquement très vaste, puisqu’elie comprend, a son apogee, le Canada (1524-1763), l’Acadie (1604-1713), Terre Neuve (1627-1713), Ia Louisiane (1682-1763), et I’ile Royale (1717-1758). Ii sera ici essentiellement question des possessions septentrionales de Ia France. Voir Daniel Hickey art < Nouvelle France>> (sous Ia direction de Lucien BCly) Dictionnaire de l’Ancien Régime, PUF, coil. Quadrige, 2002, pp.907-911, p. 907. (6) A I exception de Louisbourg qut est perdue en 1745 et rendue a Ia France ainsi que 1’Iie dii Cap-Breton par Ia Paix d’Aix-la-Chapelie en 1748, et des possessions perdues iors du Traité d’Utrecht en 1713 : Terre-Neuve, l’Acadie et Ia Baie d’Hudson. (7) Scion I’étude du Professeur Jean-Marie Augustin, des < avant 1664, les colons, conseillCs par ies notaires, observaient déjà Ia Coutunie de Paris pour tout ce qui touche au droit familial >>, Jean-Marie Augustin, e Les premiers contrats de manage a Montréal de 1648 a 1664>> La Revue Juridique Themis Faculte de Droit de L Université de Montreal vol 30 n 1 1996 pp 1 21 p 18 e Ii eat certain que dans ies Indes en Aménque & par tout aiileurs ou lea francois ont des colonies, l’on suit Ia Coutume de Paris >>, Denisart, Collections de decisions Nouvelles a de Notions relatives a Ia jurisprudence actuelle. NeuviCme edition, Veuve Desaint 1775, 4 volumes, article Colonies Francaises, vol. 4, p. 389. (9) <<L’article 33 de Ia declaration du inois d’aoüt 1664 enregistrC au Parlement le premier septembre suivant, et constitutive de l’établissement de Ia compagnie des Indes orientaies, porte que les juges établis en toutes lea places des lIes que Ia compagme pourroit occuper comme abandonnees et desertes, seront tenus de institutionnelle°>, puisque la colonie des 1665 se trouve dirigée par une sorte de trzumvirat dont un gouvemement bicephale, Ic gouvemeur étant chargé des activités militaires et des relations extérieures et l’intendant étant chargé de la Justice, de Ia police et des finances. Troisième tête de I’hydre institutionnel, les Conseils Souverains de Québec et Louisbourg, sont charges de rendre Ia justice et d’appliquer les decisions du pouvoir royal et de ses représentants. La consequence de l’unité juridique souhaitée est que Ia femme canadienne se trouve pour une grande panic dans Ia méme situation juridique que Ia femme parisienne. Ce faisant, Ia comparaison entre Ies deux situations de part et d’autre de 1 ‘Atlantique devient alors particuliérement intéressante. Malgré cette unite normative, des particularismes se font rapidement jour lorsque I’on étudie attentivement Ia place des femmes dans le monde juridique de Ia Nouvelle-France. La Coutume de Paris evolue assez rapidement a tel point qu en 1760 on parlera des <<Lois du Canada>> Ia Coutume de Pans appliquée a Québec et Montréal, aprés des modifications en 1670, 1678 et 1685, se trouvant sir bien des points éloignée de celle appliquée au Châtelet 21 . Ce système juridique, examine par les auteurs anglo saxons Ia fin du XVIII siècle, lors de la conquëte definitive <<des quelques arpents de neiges>> tant négliges par Louis XV, trouve clans leur analyse des critiques mais également un respect pour I ‘ceuvre accomplie <<Cc systeme de lois>> ecrira plus turd Ic gouvemeur de Québec Guy Carleton en 1767, établissait, dii plus petit au plus grand, une subordination qui assurait l’harmonie intérieure dont Ic pays jouissait avant notre an-ivée, et pennettait au gouvernement supreme d’obtenir I’obéissance d’une province très éloignee. C’était en tous les cas cc but là que les législateurs avaient en tête en établissant les principes directeurs de Ia Coutume de Paris Cette condition jundique reste relativement favorable aux femmes La Coutume de Pans apphquee en Nouvelle-France, flit pourtant Juger, suivant les lois et ordonnances du royaume de France, & de suivre et se conformer a Ia Coutuine de Paris, suivant laquelle les habitants pourront contracter, sans que l’on puisse introduire aucune autre coutume pour éviter Ia diversité.u Denisart, article Colonies Françaises, ibid. p. 389. ((0) Voir notamment sur cc point l’ouvrage de Lionel Groulx, Hisroire du Canada Francais, Tome I Le Régime francais, Fidés, Montréal et Paris, 4 ème edition, 394 p., pp. 67-73. Sur Ia Coutume de Paris en Nouvelle-France, voir notamment l’article de Yves F. Zoltvany, <<Esquisse de Ia Coutume de Paris >, Revue dHistoire de 1 Amérique Française, décembre 1971, vol. 25, n° 3, pp. 365-384. ((2) Micheline 0 Johnson, <Histoire de Ia condition de Ia femme dens Ia province de Quebec u, Tradition culturelle a histoire polirique de la femme au Canada, éd. Labarge, 1975, p. 1. li> Carleton a Shelbume, 24 décembre 1767, dans WB Munro ed., Documents relating to the seignioral Tenure, p. 227 cite dens Micheiine D Johnson, op. cit. p. 1. 80 Cahiers aixois d’histoire des droits de l’Outre-mer francats N° I influencée par le renouveau du droit romain qui renforca, aux xvlrle et XVIIIe1 siècles, l’emprise de l’homme, et notamment chi man sun la femme. L’uvre du cénacle de Fontenay-le-Comte, discutant de Ia <querelle des femmes >>, et comptant parmi ses intervenants Tiraqueau, a largement uploads/S4/ gilles-quot-le-statut-juridique-de-la-femme-en-nouvelle-france-quot-cahiers-aixois-1.pdf
Documents similaires

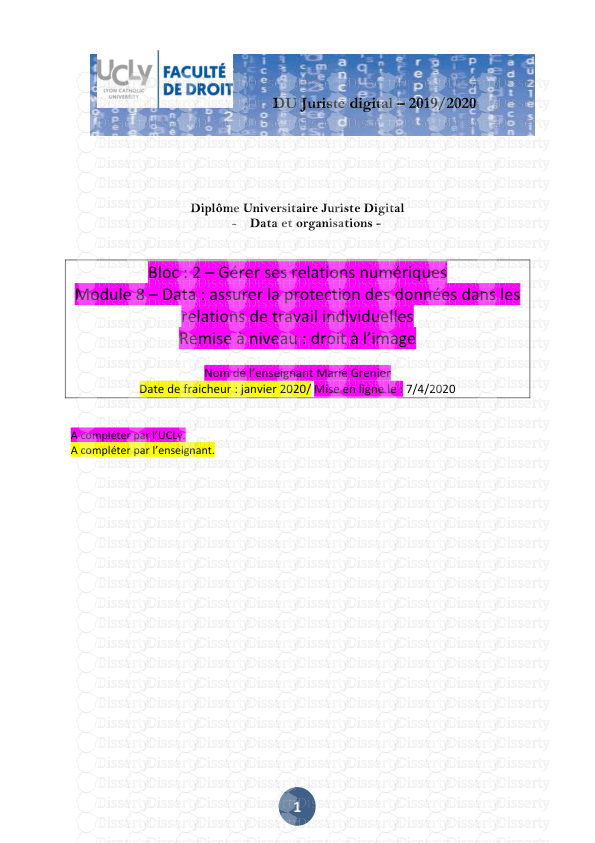








-
74
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 26, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 1.9531MB


