Pascal, Ordre et Justice Les 3 discours sur la condition des grands regroupent
Pascal, Ordre et Justice Les 3 discours sur la condition des grands regroupent des cours adressés aux fils du Duc de Luynes, qui demande à Pascal de leur donner une éducation morale. Ils développent la question des ordres qui coexistent comme représentation du réel. C’est une théorie sous-jacente à celle de la conscience Pensées : Il s’agit du brouillon d’un livre faisant l’apologie de la religion chrétienne, exprimant dans un premier temps la misère de l’homme sans dieu. Il existe plusieurs classements de ce livre, car les fragments ont été retrouvés éparses. Certains sont dédiées à la question de la justice. Tout d’abord, on distingue Pascal des « théoriciens de la justice », comme Hobbes, qui visent à légitimer le droit en repartant de sa source naturelle, donc en dressant comme une généalogie du droit. En effet, selon des penseurs comme Hobbes ou Rousseau, le droit positif, ou civique, tire sa légitimité du droit naturel (cf commentaire sur Hobbes). Au contraire, ce que nous raconte Pascal n’est pas une théorie mais plus une fable qui met en scène des entités comme la force et la justice pour faire apparaître une morale. Au contraire de Descartes, qui cherche un point d’origine pour retrouver la vérité, Pascal cherche à se retrouver à partir de là ou il est. I – Rapports entre justice et force Le premier discours sur la condition des grands relate l’histoire de l’usurpation de la justice par l’injustice. La vraie justice (immuable, rationnelle, indiscutable et manifeste) est différente de ce que nous appelons justice (L60-B204 « Plaisante justice qu’une rivière borne ! Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà.») « Comme on a pas pu faire en sorte que la justice juste soit forte, on a fait en sorte que la force soit juste » Socrate ironise, avec cynisme, que la justice s’oppose à la société humaine. La justice semble une pure hypocrisie. Platon disait que le tyran est un loup à visage humain. Cette thèse semble dénoncer les grandeurs de ce monde, qui ne sont que des illusions face au divin. Une lecture rapide de l’œuvre pourrait laisser croire à une vision cynique de Pascal sur la justice. Ce fragment s’apparente à une fable. (pas une histoire de lutte des classes) La « Justice Forte » et l’opposé de la « force juste », qui consiste simplement en une force qui s’impose et arrive à se faire reconnaître comme justice. On a ainsi renommé le « fort » en « juste ». « La vraie justice n’existe pas chez les hommes » Premièrement, la vraie justice n’a pas été reconnue par les hommes, ce qui impute aux hommes la responsabilité de l’absence de justice. De plus, nous appelé Justice l’inverse de la justice, ce qui double la responsabilité de l’homme. De la Justice, on ne garde qu’une image qui nous fait croire que la justice existe. (Pascal en rajoute pour désespérer le lecteur, afin qu’il se tourne vers Dieu). 1 Pascal est nominaliste, c'est-à-dire que le nom que l’on donne à une chose ne correspond pas forcément au concept recouvert par cette chose. Les êtres ne sont pas intrinsèquement porteurs des concepts par lesquels nous les appréhendons Cependant, malgré cette incapacité de la justice à se maintenir, elle garde cette faculté à être reconnaissable, et donc, d’une certaine manière, reste intacte. En effet, si elle était capable de se défendre, elle utiliserait la force et/ou la ruse, et donc perdrait son authenticité. En restant elle- même, et donc en cédant sa place à la force, elle se préserve. L’idée de la justice est ainsi préservée, ne serait-ce que parce qu’on arrive à reconnaitre l’injustice. II- Substituer le vrai par le faux « Cette maitresse d’erreur et de fausseté, d’autant plus fourbe qu’elle ne l’est pas toujours » (cf « l’imagination » Pensée B82-83 L44-45) L’imagination règle les rapports entre les hommes ainsi que le rapport à soi. Elle nous fournit l’image du bon fonctionnement, en produisant quasiment un tableau social. On juge ensuite les situations en fonction de ces tableaux. L’intégralité des rapports entres les hommes sont régis par les « cordes d’imagination », qui nous font respecter les autres. Un individu n’est investi d’autorité que grâce à ces cordes d’imagination. Ces « cordes d’imaginations » pourrait rappeler l’allégorie de la caverne de Platon. Les captifs sont captivés par les images, et sont d’autant moins libres qu’ils n’ont pas envie de se libérer. Cette critique intense qui est aussi un hommage, Pascal reconnaît le pouvoir de l’imagination ainsi que sa capacité d’être parfois la vérité. Le pouvoir de l’imagination serait aussi de pouvoir s’en servir pour être capable d’exprimer la vérité (La Fontaine). Il parle de personne « habile en imagination » pour celui qui arrive à s’auto-persuader. III – La théorie positive de la justice Platon, Rousseau et Pascal s’inscrivent dans la même ligne de continuité. Dans La République, Platon décrit une utopie avec un peuple dirigé par le philosophe-roi Si on donne le pouvoir à quelqu’un, il va être tout de suite corrompu et basculer dans le pire du régime, la tyrannie (Le tyran est celui qui est dirigé par ses passions) Churchill : « La démocratie est le pire des régimes à l’exception de tous les autres » 2 L’ordre social est défini par un ensemble de devoirs, d’obligation et de contraintes. Pascal ne croit pas au progrès. Pour lui, une révolution détruit la seule chose qui marche, à savoir les institutions. (Pascal a été plutôt marqué par la fronde, au début du règne de Louis XIV. Il distingue, dans le rapport des hommes à la justice les crédules, les demi-habiles et les habile.) 2 types de personne agissent de la même manière : celui qui obéit à la loi parce qu’il la croit juste (le crédule) et celui qui obéit parce que c’est la loi, sachant qu’elle ne vaut que parce qu’on lui obéit (l’habile) La solidarité mécanique, un groupe d’homme où chacun est défini par son unicité, s’oppose à la solidarité organique, chaque homme compte par la fonction qu’il occupe grâce à la division sociale du travail. En effet, la solidarité est plus grande au sein de la société, ce qui permet de gagner en moralité. Cependant, la mécanisation casse cette solidarité organique, et la solidarité mécanique n’est plus possible dans les grosses sociétés actuelles. IV – La conscience Morale Pascal décrit les 3 ordres, qui correspondent à 3 perspective sur le monde : - Ordre des grandeurs naturelles - Ordre de grandeur d’établissement - Ordre de grandeur de la charité Les 3 tableaux coexistent et sont invisibles les uns aux autres. Pascal explique qu’il existe une différence infinie entre l’ordre de la chaire et celui de l’intelligence, une différence encore infiniment plus grande entre celui de l’intelligence et celui de la charité. Les ordres coexistent sans être hiérarchisés, il n’y a pas de critère pour passer d’un ordre à un autre que la morale, la conscience, etc. Ex : rencontre entre un duc et un mathématicien Si le mathématicien refuse de s’agenouiller devant le duc, alors il est sot Si le duc se sent meilleur que le mathématicien en maths parce qu’il est duc, alors il est également sot. Pascal écrit en effet que ce qui fait que la loi est la loi, c’est qu’on y obéit. La vraie justice étant absente, la seule chose que l’on peut faire, c’est de faire en sorte de maintenir l’ordre en place afin de créer un cadre qui permet de chercher sa moralité. Comme la métaphore du tableau qui nous dit comment se placer face à lui, c’est à soi de trouver le passage pour découvrir une autre façade du réel, c’est à nous de juger. Jansénisme : Courant catholique qui a voulu tenir compte des objections exposées par le protestantisme en revenant à une pratique plus stricte de la religion. Ils ne pensent pas que l’être humain est assez méritant pour accéder par lui-même au paradis, mais croient que les élus ont déjà été choisis. Ainsi, les avantages matériels sont des signes de la bénédiction divine (ex : être riche, c’est avoir Dieu de son côté). Malgré son conservatisme, Pascal est très engagé en politique. 2e discours : rapports à soi et aux autres, avec fable de l’homme qui se fait reconnaître comme un roi par un peuple (cf doc de citations Pascal du prof). Vis-à-vis de soi, il doit continuer de 3 se voir comme un homme, sinon on devient fou (Si les personnes se croient vraiment de droit divin, alors se prennent pour des dieux). Face aux autres, il doit cependant jouer le rôle. Dans son traité sur le vide, il expose aussi qu’on ne doit pas tenir pour vrai ce qui nous fait plaisir (métaphore avec le coffre vide) Une des difficultés de Pascal est de poser le rapport entre unicité et multiplicité. La synthèse de quelque chose ne peut jamais être complète, il y a donc toujours de la diversité. (B871 L604) « La multitude qui ne se réduit point uploads/S4/ pascal 1 .pdf
Documents similaires


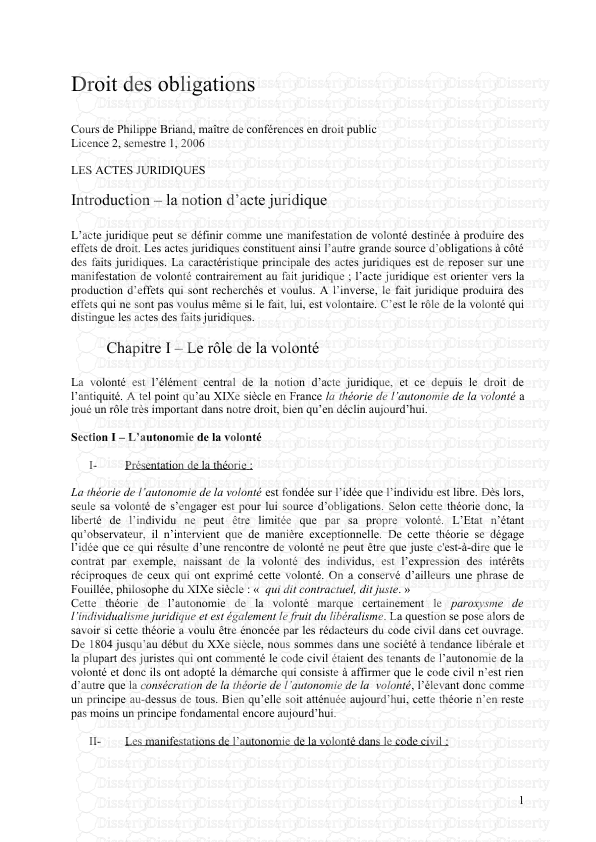







-
39
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 02, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.0848MB


