PROCEDURE PENALE Introduction La procédure pénale est souvent présenté sous une
PROCEDURE PENALE Introduction La procédure pénale est souvent présenté sous une connotation défavorable dans la mesure ou on assimile cette matière aux excès que peuvent commettre certains plaideurs que l’on qualifie volontiers de procéduriers. En fait, la procédure est au coeur des libertés individuelles, ce qui à fait dire à certains que la procédure pénale est le baromètre des libertés individuelles. En fait, la procédure pénale est la matière qui régit les droits fondamentaux du citoyen. Cette place conduit à s’interroger sur la définition et sur les caractère que revêt cette matière. 1) L’intérêt de la procédure pénale. A) La liberté d’aller et de venir. - Tout citoyen peut voir restreindre sa liberté d’aller et de venir. Ainsi, aux termes de l’article 61 du CPP « l’officier de police judiciaire agissant dans le cadre d’une enquête de flagrance, peut, défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ses opération ». - L’article 78-1 du CPP prévoie dans son alinéa 2 « toute personne se trouvant sur le territoire national, doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité effectué par les autorités de police ». Aucun textes n’impose à un citoyen français de posséder un document d’identité, pourtant, l’article 78-2-2 du CPP permet à l’officier de police judiciaire de retenir la personne contrôlée pendant une durée de 4h afin de lui permettre de justifier son identité. - Dans le cadre d’une enquête, une personne peut faire l’objet d’une garde à vue, en droit commun la garde à vue dure au maximum 24h, avec un renouvellement possible de 24h, et ce délai peut être allongé puisqu’en matière de criminalité organisée, ce délai peut être porté au total à 96h. - Lorsqu’une personne est mise en examen par un juge d’instruction, ce magistrat à le choix entre 3 possibilités: laisser l’individu en liberté, demander au juge des libertés et de la détention (JLD) de placer la personne mise en examen en détention, laisser la personne en liberté mais en lui imposant l’une des 17 obligations du contrôle judiciaire ou plusieurs de ces obligations cumulées. Or, l’article 138 précise parmi les obligations qui peuvent être mises à la charge du mis en examen: « ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction ou le JLD. Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d’instruction ou le JLD qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat. Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge. Informer le juge de touts déplacements au delà de limites déterminées ». - Le juge d’instruction peut décider de placer une personne en détention en demandant au JLD d’examiner la demande qu’il formule en ce sens. Le législateur à déterminé divers délais butoirs pour éviter des détentions abusives mais il n’en reste pas moins que certaines détentions antérieures aux jugements durent parfois plusieurs années. - Une fois le jugement prononcé, et la peine prévue par le jugement appliquée, plusieurs textes prévoient des aménagements possibles de la peine privative de liberté et, par exemple, lorsque la peine restant à accomplir est de moins d’une année, le détenu pourra former une demande de placement sous surveillance électronique « PSE ». Une loi du 25 février 2008 est venue prévoir, après l’accomplissement de la peine, une mesure de sûreté permettant de prolonger sous certaines conditions l’enfermement du délinquant, dans un établissement spécialisé afin de faire échec à la dangerosité présentée par ce délinquant. Ce même texte prévoie que le juge peut organiser le placement d’office en hôpital du délinquant atteint de troubles mental. B) Le droit au respect de la vie privée. L’article 9 du CC issue de la loi du 17 juillet 1970 (loi tendant à assurer la protection des droits individuels du citoyen), pose en principe que « chacun à droit au respect de sa vie privée ». La nécessité de parvenir à la manifestation de la vérité entre bien évidemment en conflit direct avec le principe posé par l’article 9 du CC. Toutefois, la CEDH et la Chambre Criminelle ont admis que l’on puisse faire échec au secret de la vie privée lorsque l’ingérence réalisée se justifie en raison des circonstances dans une société démocratique. Il y’a fort longtemps que le législateur et la jurisprudence, se sont penchés sur la question des ingérences possibles dans cette vie privée. On cite traditionnellement à cet égard le problème des écoutes téléphoniques. L’affaire Wilson, également connue sous le nom d’affaire du trafic des décorations et considérée comme l’une des premières à avoir mis l’accent sur les dangers que faisait encourir les écoutes téléphoniques dans le cadre de la vie privée et des droits de la défense. Un jeune juge d’instruction saisi d’une affaire de trafic de décorations acquis rapidement la conviction que l’auteur de ce trafic n’était autre que le gendre du président de la République (Jules Grévy). Appelé à entendre le secrétaire de Wilson, il imagina le stratagème suivant: à la fin de l’audition du témoin il invitât se dernier à déjeuner puis, au moment du dessert s’éclipsa avec ce dernier pour appeler le bureau de Wilson en imitant la voie du témoin qu’il venait d’entendre longuement. Le magistrat fit noter par son greffier la conversation qu’il eut avec Wilson. L’affaire fit scandale, le magistrat traduit devant le Conseil de la Magistrature, ou il lui fut reprocher son manque de dignité dans la recherche de la preuve. Il se vit dessaisir du dossier, lequel fut annuler, la presse prétendit que Jules Grévy avait fait pression en faveur de son gendre. Il fut alors contraint de démissionner. Cette première affaire d’écoutes téléphoniques fut suivie de toute une jurisprudence qui amena à une condamnation de la France par la CEDH et qui contraignit le législateur à intervenir par une loi du 10 juillet 1991 aujourd’hui insérée dans les articles 100 et suivants du CPP. Les moyens d’intrusions dans la vie privée se sont à un tel point perfectionnés que, désormais, dans le cadre d’une affaire de criminalité organisée, l’article 706-96 du CPP prévoie que l’on peut installer des appareils de sonorisation ou des caméras en tout lieux et véhicules au besoin en pénétrant de jour ou de nuit dans le domicile du citoyen pour y installer le matériel nécessaire. Toute enquête ou toute instruction conduit nécessairement à des intrusions dans la vie privée. Les perquisitions en sont un exemple, il pourra être saisi des correspondances privées voir même un carnet intime. C) Droit au respect de la personne. La question du respect de la personne ce pose de manière constante en procédure pénale et en science pénitentiaire. C’est la célèbre affaire du professeur Heuyer qui à marquée le premier point de la jurisprudence sur les atteintes corporelles destinées à parvenir à la manifestation de la vérité. En l’espèce, un jeune juge d’instruction qui avait assisté en Angleterre aux examens sous scopolamine des soldats américains prétextant la folie pour ne pas être associés au débarquement en France, eu l’idée d’appliquer cette méthode à l’une des affaires dont il était saisi en 1947. Dans le cadre d’une affaire de viol particulièrement grave, l’inculpé (mise en examen) prétendait être atteint de folie. Ce juge d’instruction désigne alors le professeur Heuyer pour procéder à une injonction de Pentothal afin de déterminer si l’inculpé simulait ou non la folie. L’examen révéla qu’il s’agissait d’un simulateur. Le professeur Heuyer fut alors poursuivi pour blessures volontaires devant le tribunal correctionnel de Paris. Il fut relaxé et la jurisprudence élabora à cette occasion une distinction entre l’utilisation du Penthotal pour parvenir à un diagnostic (le narco-diagnostique) et l’utilisation du penthotal pour procéder à l’interrogatoire de l’inculpé sur le fond de l’affaire en profitant de son état de veille (le narco-interrogatoire). La jurisprudence à admis le narco-diagnostic mais à condamnée clairement le narco- interrogatoire, dans la mesure ou cette méthode aboutie à un viol de conscience, ce que ne peut justifier la recherche de la vérité. A la suite de cet arrêt, de nombreux auteurs ont pensés que le viol de la conscience, prohibé par la jurisprudence, imposait également la prohibition du viol de la personne sur le plan purement physique. La question fut clairement posée à la Cour de Cassation dans un arrêt du 29 janvier 1997. En l’espèce, un sieur Gildas Gourvenec, soupçonné de trafic de stupéfiant, fit l’objet d’une expertise et d’un examen ordonné par un juge d’instruction visant à extraire tout corps étrangers de son système digestif. S’opposant au touché rectal que voulait lui imposer le médecin, il résista à un tel point que l’examen ne put avoir lieu qu’après avoir été contenu par plusieurs policiers. Celui ci, dans un premier temps souleva la nullité de la procédure, qui fut rejeté, puis il déposa à l’encontre du médecin, une plainte pour viol et, à l’encontre des policiers, une plainte pour complicité de viol. Cette seconde procédure échoua également. A la suite de cet arrêt, la doctrine soulignait que seul un juge pouvait uploads/S4/ procedure-penale 5 .pdf
Documents similaires



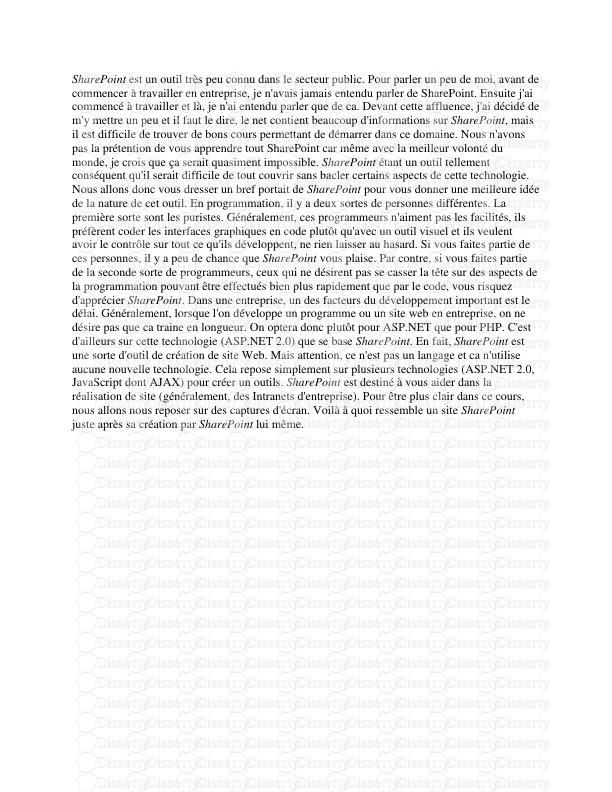






-
84
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 18, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1350MB


