QUE SAIS-JE ? Les 100 mots de la police et du crime ALAIN BAUER Professeur de c
QUE SAIS-JE ? Les 100 mots de la police et du crime ALAIN BAUER Professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers Président du Conseil d’orientation de l’Observatoire national de la délinquance EMILE PEREZ Inspecteur général de la police nationale Chef du Service de coopération technique internationale de police Introduction es activités criminelles et les actions des forces de sécurité alimentent au quotidien l’actualité présentée par les médias. Sans faits divers, sans actions criminelles, sans poursuites, recherches, interpellations, une partie importante de notre vie sociale n’existerait plus, pour le pire et pour le meilleur. De la cour de récréation au café, dans les transports en commun, au bureau ou en famille, les questions criminelles et l’activité policière sont des sujets communs, souvent au cœur des débats. Robin des Bois auréolés de leur statut de révoltés, justiciers, flibustiers, corsaires et pirates, inspecteurs Colombo, Morse ou Derrick (pour les importations), gendarmes et gendarmettes, comiques ou dramatiques ont permis à chacun de s’identifier ou s’attacher à des personnages emblématiques. « Les Cinq dernières minutes », « Vidocq », « Les Brigades du Tigre », « Maigret », « Navarro », « Les Cordier », « Julie Lescaut », « PJ » ou plus récemment « RIS » sont nos compagnons réguliers, introduisant l’expertise scientifique au cœur de nos foyers à la suite des « Experts » venus de « Las Vegas », « Miami » ou « New York ». Voilà pourquoi il nous a semblé utile d’insérer dans la série des « 100 mots » cet ouvrage permettant d’éclairer le vocabulaire employé et d’aider à une encore plus grande compréhension de cet univers si particulier qu’est celui du bien et du mal dans sa quotidienne complexité. On aurait pu en trouver 1 000 sans difficulté. Qu’on veuille bien excuser les omissions de notre sélection et nous pardonner pour nos arbitrages. L Chapitre I Les concepts et principes 1 ‒ Droits et loi es droits (du latin « ce qui est juste ») sont les libertés, prérogatives et pouvoirs que chaque individu possède par naissance et par nature, ou qu’il a acquis en conformité avec un texte juridique précisément établi (in le dictionnaire de l’Académie française). Parmi ces droits, le concept de sûreté (→ 2) apparaît comme l’un des principes fondateurs de la Révolution française. Il est cité dans l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Cette déclaration étant intégrée dans la Constitution, ce concept a donc valeur constitutionnelle. Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. [Cet article couvre à la fois un habeas corpus à la française – le droit de ne pas être poursuivi arbitrairement – et une garantie naturelle de protection par un service public.] Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui L sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance. Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. Art. 12. La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Les services de police tirent leur légitimité de cet article pour appliquer et faire appliquer l’ensemble des règles sur lesquelles repose une société : la loi. Dispositif établi par l’État, qui fixe notamment les infractions punissables et les peines (principe se substituant à l’arbitraire et à la lettre de cachet), la loi est votée par le Parlement, elle ne peut avoir de caractère rétroactif en matière pénale. Elle est déclinée en niveaux d’importance selon sa valeur : loi constitutionnelle, loi organique (portant sur l’organisation de l’État), loi de programmation (définissant des objectifs et des moyens sur une période donnée), loi simple (complétée par des décrets d’application permettant sa mise en œuvre). La loi définit et garantit en premier des libertés : La liberté individuelle désigne le droit de se déplacer à son gré de n’être ni arrêté, ni détenu arbitrairement. La Constitution de 1958 précise (art. 66) : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. » La liberté individuelle peut être limitée dans certaines circonstances (arrestations, détentions). Les restrictions aux libertés individuelles ne peuvent intervenir que dans le cadre d’une procédure visant à identifier et à rechercher l’auteur d’une infraction pénale ou si les nécessités de l’ordre public ou l’urgence l’exigent. La liberté d’aller et venir ne figure pas en tant que telle dans la Déclaration de 1789 mais elle découle naturellement de l’ensemble de ce texte et plus particulièrement de la sûreté dont elle est le complément. Celui qui a le droit de n’être ni arrêté ni détenu en dehors des cas prévus par la loi doit pouvoir circuler librement (valeur constitutionnelle confirmée en 1977). Cette liberté est limitée par les exigences de l’ordre public (circulation automobile, stationnement, commerçants ambulants, personnes non sédentaires ou étrangères...). 2 ‒ Sécurité et sûreté Ces concepts ont évolué au cours des siècles. D’abord élément majeur de protection de l’État et du Pouvoir central, établi pour la protection des institutions, la sécurité passe par la défense des frontières, la lutte contre la fausse monnaie, le contre-espionnage. Ultérieurement elle s’étend à la lutte contre le crime de sang et le duel (le souverain ayant seul le « droit de vie et de mort » sur ses sujets). Aujourd’hui, pour les professionnels, la sécurité définit le concept de protection contre les éléments naturels ou non intentionnels (catastrophes climatiques, incendies non criminels...), alors que la sûreté détermine les actions à mener contre les actions volontaires (agressions, vols...) : la direction de la sûreté générale devenue direction de la sécurité publique. Les thèmes de la sécurité et plus souvent de l’insécurité s’invitent souvent dans le débat public. Enjeu déterminant pour le citoyen, le maintien de la sécurité réclame des réponses immédiates et adaptées de la part des politiques. Enfin, la notion de sécurité intérieure développée au cours des dernières décennies vient compléter celle de police avec une approche à la fois plus globale et différemment orientée. La sécurité intérieure recouvre l’ensemble des instruments mis en œuvre par l’État pour garantir la sécurité de tous face à des menaces de nature criminelle. 3 ‒ Sentiment d’insécurité et victimation Traduction maladroite de l’expression anglaise fear of crime (peur du crime), le « sentiment d’insécurité » s’est médiatisé en perdant son sens premier. En France, les rapports Peyrefitte (1977) et Bonnemaison (1982) le développent. Individuel ou collectif, le sentiment d’insécurité combine le danger réel ou imaginé et la perception de sa gravité. La délinquance fait, en effet, partie de ces éléments perçus collectivement comme menaçants qui varient d’ailleurs selon le pays, le moment ou les individus. Dans certains cas, des autorités et des organisations sectaires peuvent d’ailleurs jouer sur les peurs collectives (terrorisme, agressions, drogues...) pour renforcer leur emprise sur des populations sensibles. Ainsi, le recours systématique à des termes comme « guerre contre » le terrorisme ou la drogue par exemple ne fait que renforcer une certaine psychose en évitant de se prononcer sur les causes réelles des phénomènes criminels. La victimation est le fait de subir une atteinte, matérielle, corporelle ou psychique (et d’en être conscient). En fait, la tendance est à l’augmentation du nombre de victimes d’une confrontation physique avec un agresseur depuis le milieu des années 1990. Les modifications des modes opératoires des agresseurs (cambriolages, vols de – et dans les – véhicules depuis les années 1950, puis transfert sur la voie publique depuis le milieu des années 1990, avec en particulier des agressions contre les porteurs de cartes de paiement ou les utilisateurs de téléphones portables) ont changé la nature des victimes : de passives (non présentes au moment de l’acte), elles sont devenues directes. De uploads/S4/les-100-mots-de-la-police-et-du-crime.pdf
Documents similaires


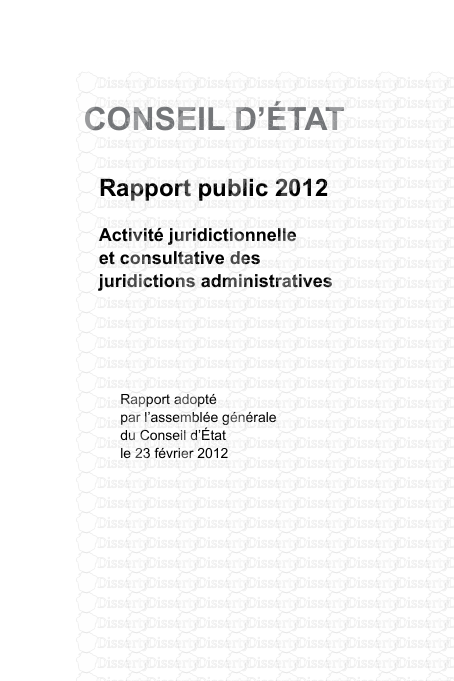







-
104
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 24, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.6815MB


