AGRI~ EXPO~ MAROC~ Les ruits roug s au Maroc Diversifier pour consolider le gra
AGRI~ EXPO~ MAROC~ Les ruits roug s au Maroc Diversifier pour consolider le grand potentiel de production et d'exportation Abdelmoumen Guennouni Depuis les années 1980 le secteur des fruits rouges n'a cessé de se développer et de se diversifier essentiellement dans la zone nord (Loukos, Gharb). Plusieurs éléments ont favorisé cette évolution dont la disponibilité de terres adaptées, d'eau et de main d'œuvre qualifiée, proximité de l'Europe encourageant l'export, incitations aux investissements, délocalisation de production européenne principalement espagnole, etc. Cette délocalisation a tiré la technicité du secteur vers le haut et a permis aux producteurs marocains d'atteindre un niveau élevé de maitrise du processus de produc- tion, conservation et transformation. En outre cette filière attire de nombreux investisseurs étran- gers dont des projets importants ont été annoncés dernièrement. 'appellation fruits rouge regroupe tous les "fruits" au sens courant et en termes de consommation appartenant à différentes familles de plantes (Rosacées, Erica- cées, ... ) et ayant en commun la couleur le plus souvent rouge. Sur le plan botanique on peut classer les fruits rouges en 3 catégories: - Lesbaies ou fruits à pépins: Myr- tilles (airelles), groseilles, cassis,etc. - Les drupes ou fruits à noyaux: cerises,framboises, merise, ... - Les faux fruits (fraises) et fruits composés (mûres) Au Maroc, la dénomination fruits rouges est réservée aux fraises (fra- garia), framboises (Rubusidaeus), · j .,--..-,- myrtilles (Vaccinumsp) et mûres (Rubusspp), les cerises étant consi- dérées parmi les produits de l'ar- boriculture fruitière. Une histoire riche en évolutions et diversifications Laculture du fraisier, premier et plus important desfruits rouges,a été in- troduite au Maroc au cours des an- nées 1930à 1950 (selon lessources) dans le cadre d'essaismenés en vue de diversifier la production natio- nale et les exportations par l'intro- duction de nouvelles espèces frui- tières à haute valeur ajoutée. Au début, les superficies de fraisier étaient très limitées puis ont aug- menté rapidement avec l'évolution de la maîtrise de la production, de la demande du marché européen ainsi que le développement des techniques de conservation. Ce- pendant, cette culture n'a démarré que vers la fin des années 70 dans deux périmètres irrigués: le Lou- kos et le Souss Massa et, dix ans plus tard, elle gagna le périmètre du Gharb. A partir de 1989 et jusqu'à 1999, le Maroc produisait des fraises dans ces trois régions agricoles, parmi les plus impor- tantes du pays. A noter que depuis Evolution des fruits rouges au cours des 5 dernières années u: u· 1 1 5 P 5 P 5 P Fraise 2.600 100.000 Framboise 150 949 178 879 235 1.010 Myrtille 15 139 95 623 155 1.250 , 2012 5 3.000 295 165 5 3.150 395 280 P 120.000 1.500 1.420 P 130.000 3.100 1.780 S= superficies en hectares, P = production en tonnes le lancement de cette culture, le périmètre du Loukos a toujours occupé la position de leader dans la production et l'exportation des fraises fraîches et surgelées, lea- dership qui s'estconfirmé de façon très nette à partir de 1999, lorsque les fraisiculteurs de la région du Souss-Massa ne pouvaient plus tenir tête à la compétition imposée par ceux de la région du Loukos et du Gharb. Ainsi, la ans après le lancement de la culture, la domi- nance du Loukos s'est confirmée, à en juger par les superficies consa- crées au fraisier et les rendements moyens à l'hectare qui affichaient toujours une supériorité de la à 25% par rapport à ceux du Souss- Massa. Le Gharb a émergé comme région potentielle pour la culture du fraisier à partir de 1989. Depuis lors, la région a enregistré une progression soutenue en termes de superficies et de rendement moyen à l'hectare. Ainsi, les superficies ont atteint, d'après les données de Faostat, 100 ha en 1986, 1.000 ha en 1995, 2.415 en 2000 et plus de 3.200 actuellement. Ces superficies sont actuellement réparties pour 81% au Loukos et 19% dans le Gharb. Diversification L'introduction des autres fruits rouges est plus récente. Ainsi, le myrtillier, inexistant avant 2008, connait une croissance accélérée passant de 15ha en 2008 à 350 en 2012. Le framboisier, a été intro- duit dans certaines régions maro- caines au début des années 1980, après quoi des essaisd'adaptation ont été menés entre 1990 et 1995 dans la région du Souss-Massa- Draa, mais sans grand succès. Dix ans plus tard, l'expérience a été relancée par les agriculteurs de la région du Loukos avec des variétés introduites d'Europe et connues pour leurs grands besoins en froid. Ce choix n'était cependant pas bien raisonné car la ré- gion ne dispose pas d'un cu- mul de froid susceptible de répondre aux exigences de ces variétés. Par conséquent, l'expérience des agriculteurs du nord comme ceux du sud n'a jamais abouti. A partir de 2004, certains horticulteurs installés dans le périmètre du Loukos ont introduit les premières variétés à faibles besoins en froid et qui offrent plus de chance d'adaptation aux conditions climatiques de la région. Cette troisième tentative a été couronnée de succès dans la mesure où les superficies plantées en framboisier sont passées de quelques hectares à plus de 30 ha en 2005 et les exporta- tions sont passées de 30 t à quelque 120 t entre 2003 et 2006. Depuis, le développement a été plus soutenu puisque de 150 ha en 2008, elle sont passéesà 500 ha en 2012. Rappelons qu'en 2005, le ministère de l'agriculture, en collaboration avec l'agence américaine de déve- loppement, avait lancé un pro- gramme de promotion de ces nou- velles espècesaxé sur trois actions: l'introduction de nouvelles varié- tés, la mise en place des essaisd'ob- servation et l'assistance technique. Par ailleurs, le contrat programme retenu pour les années 2015-2020 se propose d'atteindre 5.000 ha de fraisier (200.000 t export), 1.500 ha de framboisier (15.000 t export) et 3.000 ha de myrtillier (30.000 t export). Lechiffre d'affaires projeté devrait égaler 3 fois le chiffre d'af- faires de 2008, soit 3 milliards de dh à l'export. FRAISE Dynamisme d'une filière Difficultés du secteur Depuis 10 ans, la productivité est en diminution, les couts de production en augmentation continue (main d'œuvre, électricité, plastic, intrants ... ) et le mar- ché international de plus en plus concur- rentiel (nouveaux concurrents: Grèce, Egypte). Cependant, les prix de vente de la fraise n'ont pas suivi cette évolution, ce qui se traduit par une nette diminution des marges des producteurs (A peine 2S.000dh/ha actuellement contre près de 100.000 dh/ha il y a une dizaine d'an- nées). Différentes raisons peuvent être avancées, mais les principales sont: Diminution de la productivité Parmi les raisons la désinfection du sol. Selon les producteurs, après l'interdic- tion du bromure de méthyle et en l'ab- sence d'alternatives efficaces, le sol est de plus en plus fatigué et les rendements chutent progressivement. Par ailleurs, la variété Camarosa qui permettait il y a quelques années de produire 800 gr à 1kg par plant, couvrant frais et surgelé, commence à vieillir (seulement 400 gr actuellement) et de plus n'est plus très demandée par le marché du frais. Augmentation des charges D'année en année, l'avantage de la main d'œuvre dont bénéficiait la Maroc par rapport à l'Espagne s'estompe. Il y a quelques années seulement un ouvrier était payé 40dh/jour, alors qu'actuel- lement il touche 60dh/jour, auxquels s'ajoutent les frais de la sécurité sociale et de transport puisqu'il faut aller chercher les ouvrier à 40-S0km à la ronde (voire jusqu'à 80km en mars-avril), ce qui fait grimper le coût à 100 dh/jour/ouvrier. De ce fait, ces derniers temps, ce sont plutôt les petits producteurs qui s'en sortent le mieux. En effet, les petites exploitations qui bénéficient d'une main d'œuvre familiale, disposent généralement d'une matière organique issue de leur élevage, pratiquent plusieurs cultures pour limiter le risque (PDT,arachide, fourrage ... ), sont apporteurs dans des stations en période d'export frais et surgelé, et livrent égaIe- ment le marché local qui est de plus en plus demandeur. D'ailleurs, ces dernières années on constate une augmentation du nombre de petites exploitations par rapport à celles de taille moyenne. Choix variétal L'offre est longtemps restée dominée par une seule variété: Camarosa. Mais avec la mondialisation des échanges et le risque de perte de parts de marché, les professionnels ont senti la nécessité de diversifier la gamme variétale destinée à l'export. Ils ont ainsi opté pour de nou- velles variétés dotées de performances supérieures, notamment en termes de précocité, de qualités organoleptiques et de conservation. En général, les pro- ducteurs avertis optent pour une combi- naison de plusieurs variétés pour couvrir l'ensemble du cycle et mieux répondre aux impératifs des débouchés (précocité, frais, surgelé). Aujourd'hui, les fraisicul- te urs sont devant un dilemme, puisque la Camarosa (40% des surfaces) n'est plus demandée en frais, mais reste très appré- ciée par l'industrie du surgelé (structure du fruit). Or, les grands supermarchés européens demandent des variétés pré- cises qui sont adaptées au frais mais pas à la surgélation. Par ailleurs, chaque variété requiert une conduite adéquate qui lui permette de ré- véler pleinement ses potentialités géné- tiques. Par conséquent, l'agriculteur devra maîtriser les techniques uploads/Geographie/ agriculture-du-maghreb-fruits-rouges.pdf
Documents similaires









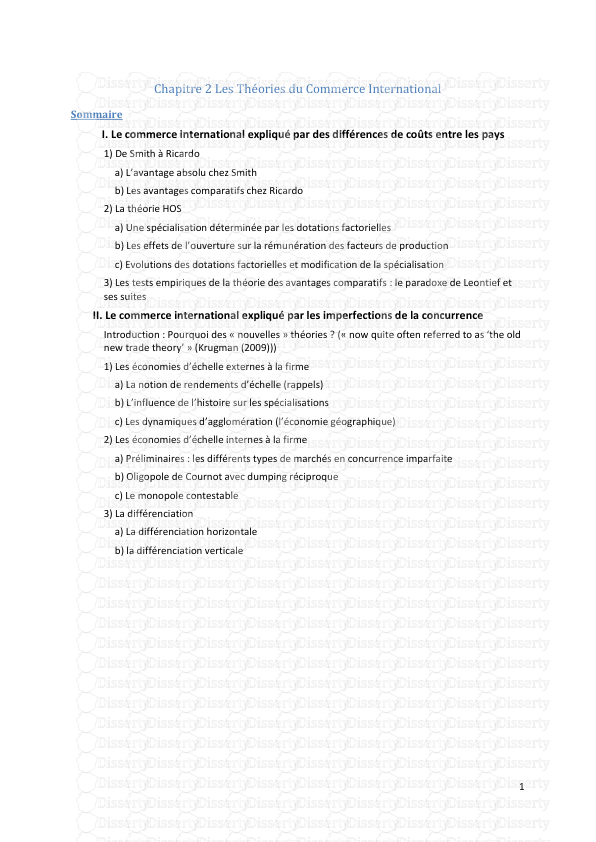
-
57
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 05, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 3.6034MB


