But de TP : La classification phénétique de nos bactéries isolées Introduction
But de TP : La classification phénétique de nos bactéries isolées Introduction : La science des règles de la classification s’appelle taxinomie. La taxinomie permet de nommer les organismes vivants (la nomenclature) et de les classer en unités (taxons), au sein desquels, ils partagent un grand nombre de caractéristiques communes. En microbiologie, cela nous permet d’identifier (l’identification) les microorganismes pour mieux les utiliser ou les exploiter (ceux qui sont bénéfiques) ou bien pour mieux s’en protéger et de les contrôler (ceux qui sont pathogènes). Le matériel utilisé : a) Echantillon étudié : les colonies apparaissent dans les milieux de culture. b) Petit matériel : anse de platine, pipette pasteur, la boite contenant les cultures, tubes à essai, lames, papier filtre stérile, les disques, c) Gros matériels : bec de bunsen, bain-marie, étuve d) Produits : l'eau oxygénée, d'eau distillée stérile, les différents réactifs Classification phénotypique : Depuis la classification proposée par Cohn en 1872 et jusqu'au début des années soixante, toute la taxonomie bactérienne reposait sur une classification phénétique. La classification phénétique (ou phénotypique) utilise un nombre de caractères considérés comme importants : - Observations macroscopiques, microscopiques: - Descriptions des colonies (forme, taille, couleur, odeur) - la morphologie des cellules (bacille, coque) . - leurs arrangements. - Les colorations (Gram, bleu méthylène, acido-alcool- résistante). - Observation de la mobilité à l’état frais. - On peut également rechercher la présence d’endospores, la croissance aérobie, anaérobie. Les caractères morphologiques sont utiles pour l’identification, mais ne peuvent pas démontrer à eux seuls les relations phylogénétiques. Les Tests métaboliques : Très importants, ils peuvent distinguer des bactéries très apparentées. On recherche la présence d’enzymes (oxydase, catalase), la dégradation de l’urée, de l’esculine. La transformation du lactose et la production de gaz, l’utilisation de différents sucres comme source de carbone, l’utilisation du citrate, la production d’acétoïne. Méthode de travail : Etude des enzymes respiratoires terminales : 1- Recherche de la catalase : Principe: La catalase est un enzyme ayant la propriété de décomposer le peroxyde d'hydrogène (H2O2) avec dégagement d'oxygène. Technique: Sur une lame et à l’aide d’une pipette Pasteur, on dépose une colonie bactérienne à laquelle on ajoute de l'eau oxygénée Lecture: Catalase + : effervescence. Catalase - : pas d'effervescence. 2- Recherche d’un cytochrome oxydase : Principe : Ce test permet la détection de la phénylène-diamine-oxydase ou le cytochrome oxydase; enzyme entrant dans divers couples d'oxydoréduction. Agissant sur un substrat incolore, cet enzyme entraîne la formation d'une semi-quinone rouge. Cette dernière, très instable, s'oxyde rapidement pour donner un composé noirâtre. La technique : Sur un papier filtre stérile, déposer un disque d'oxydase imprégné de diméthyl-para-phénylène diamine. Humidifier le disque avec quelques gouttes d'eau distillée stérile. Un excès d'eau peut nuire à la lecture. À l'aide d'anse de platine stérile prendre la bactérie à identifier (culture de 18-24heures) et la déposer sur le disque. Lecture: Apparition d'une coloration violette immédiatement : la souche est dite oxydase positive. Métabolisme des composés azotés : 3-Recherche de nitrate réductase : Principe: L'étude de la réduction des nitrates se fait par la mise en évidence des nitrites formés. Ces derniers en milieu acétique ou sulfurique, donnent une coloration rose. L’enzyme nitrate réductase B catalyse la réaction des nitrates en nitrites (réduction assimilatrice) (Marchal et Bourdon, 1982). Les nitrates peuvent aller également jusqu’au stade azote (N2). Dans ce cas, on doit compléter par l'épreuve de Zoo Bell, épreuve qui consiste à ajouter de la poudre de zinc au milieu: - si le zinc réduit les nitrates encore présents en nitrites, la coloration rose apparaît et la réaction est négative (bactéries sans nitrate réductase). - si au contraire, la teinte du milieu reste inchangée, le stade nitrite a été dépassé donc les bactéries possédant un nitrate réductase très active (Marchal et Bourdon, 1982). Technique: A une culture en bouillon nitraté de 24 à 48h d'incubation à 30°C, on ajoute cinq gouttes de réactif de Griess. Après agitation, la lecture est immédiate. Lecture: coloration rose ou rouge: nitrates réduits en nitrites (nitrate réductase positive NR+). milieu restant incolore: ajouter un peu de poudre de zinc (réducteurs des nitrates) ; agitation, inclinaison du tube de culture en position presque à l'horizontale et attendre cinq minutes avant la lecture: si le milieu devient alors rose ou rouge, il reste des nitrates, donc ces derniers n'ont pas été réduits par la bactérie: nitrate réductase négative NR- . si le milieu reste incolore, il ne reste plus de nitrates, les bactéries les ont réduit au-delà du stade nitrites: nitrate réductase positive NR+. 4-Recherche de β-galactosidase Principe: Pour dégrader activement le lactose, les microorganismes doivent posséder deux enzymes : la perméase et β-galactosidase. L’épreuve ONPG permet de mettre en évidence la β-galactosidase qui dégrade l’ONPG soit l’orthonitrophényl- β-D- galactopyranoside qui possède une structure analogue au lactose. Le lactose est formé de deux molécules de glucose et de galactose, tandis que l’ONPG est composé d’une molécule d’orthonitrophényl liée à un galactose. L’hydrolyse de l’ONPG (composé incolore) libère l’orthonitrophényl qui est responsable de la coloration jaunâtre de milieu, Ce processus se fait selon la réaction illustrée dans la figure 7. Fig. 7 : Réaction d’hydrolyse de l’ONPG (Marchal et Bourdon, 1982) Technique: - Préparer une suspension dense d'une culture bactérienne à étudier dans un tube à essai stérile contenant 0.5ml d'eau physiologique, puis y ajouter un disque ONPG. - incuber au bain Marie à 37°C pendant 24 heures. Lecture: La lecture se fait à des intervalles de temps différents : après 15mn, 30mn, 1 heure, 6 heures et 24 heures. Le test ONPG est positif lorsque la suspension bactérienne se colore en jaune citron. 5-Production d’indole : Le test indole sert à déterminer si la bactérie produit de l’indole à partir du tryptophane (acide aminé). Technique: À l’aide d’une anse à inoculer stérile, inoculer le milieu de culture liquide indole avec la bactérie à identifier (culture de 18-24heures). Incuber à 26o C pour 48 heures. À la suite de l’incubation, ajouter 3 gouttes du réactif de Kovac (bioMérieux) sous la hotte chimique. Lecture: Après agitation: - Anneau rouge vermillon en surface : indole positif. - Anneau brunâtre (couleur du réactif): indole négatif. Etude des types respiratoires : Technique: Régénérer le milieu (Viande-foie) pendant 20 min au bain-marie bouillant (bouchon légèrement dévissé). Laisser refroidir aux environ de 45°C (milieu en surfusion). Ensemencer dans la masse en spirales à l’aide d’une pipette Pasteur longue, fermée et chargée de la suspension à étudier. Laisser solidifier. Etuver 24h à 37°C, bouchon dévissé. Lecture: croissance sur toute la hauteur du tube aéro-anaérobie Croissance dans la zone supérieur de tube aérobie strict Croissance dans la zone profonde de tube anaérobie strict Croissance dans la zone intermédiairede tube microaérophile 6- Recherche de citrate : Principe : Le milieu utilisé est le citrate de Simmons , qui ne contient que le citrate comme seule source de carbone. Seules les bactéries possédant une enzyme citrate perméase seront donc capables de se développer sur ce milieu. L'utilisation de citrate provoque l'alcalinisation du milieu (Marchal et Bourdon, 1982). Technique : La pente du milieu est ensemencée d'une suspension bactérienne, par stries longitudinales au moyen d'une anse. Les tubes sont légèrement fermés. L'incubation se fait à 30°C pendant 3 à 5 jours. Lecture: La croissance de la bactérie sur le milieu indique que cette dernière possède du citrate perméase. Cependant s’il n’y a pas de développement, la bactérie ne possède pas cette enzyme. 7- Utilisation du mannitol : Un tube contient le milieu bouillon du mannitol avec le rouge de phénol (annexe 2) est inoculer avec la souche bactérienne et est incuber pendant 24h à 30°C. Lorsque le milieu vire en jaune, on dit que la bactérie est mannitol positif En définit la mobilité de bactérie par une piqure centrale : - Développement sur le long de piqure seulement immobile - Développement même sur la largeur de tube mobile 8- Utilisation des sucres TSI (gélose au glucose, lactose, saccharose): Principe: Cette méthode permet de mettre en évidence d’une part, la fermentation du glucose (avec ou sans dégagement de gaz), du lactose, du saccharose et d’autre part, la production d'hydrogène de sulfate (H2S). C'est un milieu incliné dont le glucose présent dan le culot, est attaqué par voie fermentative entraînant une acidification du milieu avec production ou non de gaz. Sur la pente, le lactose et le saccharose seront alors oxydés et fermentés. La production du H2S se manifeste par un noircissement du culot (Marchal et Bourdon, 1982). Technique: Une colonie est ensemencée en réalisant une piqûre centrale dans le culot et des stries serrés sur la pente. Remettre le bouchon du tube sans le revisser. Incubation à 30°C pendant 24 heures. Lecture: Lactose-saccharose positif : pente virant au jaune; Glucose positif: culot jaune; H2S positive: noircissement du milieu dans la zone joignant la pente et le culot. Production de gaz : présence de bulles de gaz dans le culot. Résultat : La lecture : catalase + - oxysade - - citrate + couleur bleu - ONPG - - VF : croissance dans la zone intermédiaire aéro- anaérobie uploads/Geographie/ tp-num-4-systematique.pdf
Documents similaires




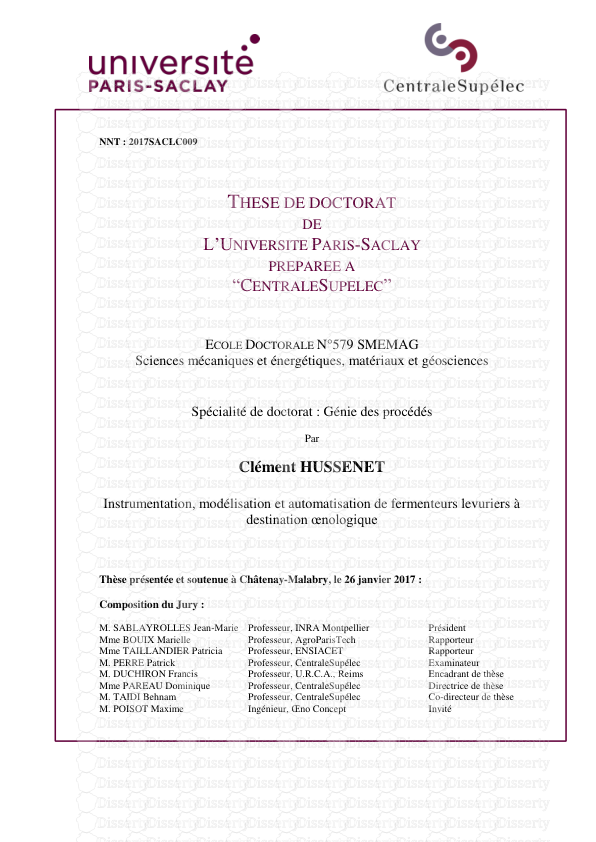





-
32
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 20, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.4785MB


