1 1 Introduction...............................................................
1 1 Introduction...................................................................................................................................3 1.1 Définition de la maintenance.................................................................................................4 1.2 Notion de la défaillance.........................................................................................................4 1.2.1 Fonction requise............................................................................................................5 1.2.2 Dégradation État............................................................................................................5 1.2.3 Triptyque « faute-défaut-défaillance »..........................................................................5 1.2.3.1 Faute :........................................................................................................................5 1.2.3.2 Défaut :......................................................................................................................5 1.2.4 Pannes...........................................................................................................................6 1.3 Service maintenance..............................................................................................................6 1.3.1 Situation dans l’entreprise.............................................................................................6 1.3.1.1 Tendance 1.................................................................................................................6 1.3.1.2 Tendance 2.................................................................................................................7 1.4 Organigramme du service maintenance................................................................................7 1.5 Mission du service maintenance............................................................................................7 1.6 Méthodes de la maintenance................................................................................................8 2 Introduction...................................................................................................................................9 2.1 Fiabilité..................................................................................................................................9 2.1.1 Définition.......................................................................................................................9 2.1.2 . Application de la fiabilité............................................................................................10 2.2 Différentes lois de la fiabilité...............................................................................................10 2.2.1 Loi Binomiale...............................................................................................................10 2.2.2 Loi de Poisson..............................................................................................................11 2.2.3 Loi normale..................................................................................................................11 2.2.4 Loi exponentielle..........................................................................................................11 2.2.5 Loi de Weibull..............................................................................................................12 2.3 Types de défaillance............................................................................................................12 2.3.1 Manifestations.............................................................................................................12 2.3.2 Degré d’importance.....................................................................................................12 2.3.3 Causes..........................................................................................................................12 2.3.4 . Conséquences............................................................................................................13 2.4 Paramètres de la fiabilité MTBF, MTTR, MTTA....................................................................13 2.4.1 Moyenne des temps de bon fonctionnement « MTBF »..............................................13 2.4.2 Moyenne des temps techniques de réparation « MTTR »...........................................13 2 2.4.3 Moyenne des temps techniques d’arrêt « MTTA »......................................................13 2.5 Choix de la forme de maintenance......................................................................................14 2.5.1 Abaque de Noiret :.......................................................................................................14 2.5.1.1 principe L'abaque de Noiret.....................................................................................14 3 Taux de defaillance :....................................................................................................................15 Conclusion ………………...…………………………………………………………15 BIBLIOGRAPHIE....................................................................................................................................16 3 1 Introduction Au moment de la détermination de la politique de maintenance qui va être mise en œuvre pour un équipement ou une installation, l’homme de maintenance se trouve devant une alternative classique : doit-il attendre la défaillance du matériel et donc être amené à intervenir sur ce matériel qui n’assure plus tout ou partie de sa fonction requise ? ou bien doit-il faire l’impossible pour éviter que cette défaillance ne se développe et entraîne la « panne » du matériel ? Dans le premier cas, on mettra en place une stratégie de maintenance corrective telle qu’elle est définie dans la norme NF EN 13306, alors que dans le second, on s’orientera vers une stratégie de maintenance préventive. Il peut paraître simple de répondre à cette question et une première analyse sommaire conduirait à privilégier la maintenance préventive en croyant, à tort, que cette maintenance préventive va supprimer totalement le risque de panne. De ce fait, la maintenance préventive ne fait que « réduire la probabilité d’apparition d’une défaillance » (NF EN 13306). Une analyse plus approfondie montre que le choix entre la maintenance corrective et la maintenance préventive demande la connaissance et l’examen d’un certain nombre de critères qui, selon le contexte, auront plus ou moins d’importance. Ces critères relèvent des aspects : - Techniques : fiabilité, maintenabilité, etc. -Economiques : coûts de maintenance, d’indisponibilité, etc. -De sécurité : des biens et des personnes. -Environnementaux. -De qualité. L’ensemble de ces critères constitue l’essentiel du concept plus global de criticité du bien dans le processus. Les thèmes abordés ont pour finalité d’examiner tour à tour les deux 4 stratégies de maintenance précitées, les méthodologies mises en œuvre, ainsi que les méthodes et les outils techniques disponibles à ce jour pour la mise en place concrète de la maintenance préventive et la maîtrise de la maintenance corrective. 1.1 Définition de la maintenance D’après l’AFNOR(NF X 60-010) (Agence Française de Normalisation) : La maintenance est un ensemble des actions permettant de maintenir ou et de rétablir un bien dans un état spécifié ou en mesure d’assurer un service déterminé. Bien maintenir, c’est assurer ces opérations au coût optimal. -Maintenir : contient la notion de «prévention» sur un système en fonctionnement. - Rétablir : contient la notion de «correction» consécutive à une perte de fonction. État spécifié ou service déterminé: implique la prédétermination d’objectif à atteindre, avec quantification des niveaux caractéristiques. -Coût optimal qui conditionne l’ensemble des opérations dans un souci d’efficacité. -Entretenir, c’est dépanner et réparer un parc matériel, afin d’assurer la continuité de la production. entretenir, c’est subir le matériel . -Maintenir, c’est choisir les moyens de prévenir, de corriger ou de rénover suivant l’usage du matériel, suivant sa criticité économique, afin d’optimiser le coût global de possession maintenir, c’est maîtriser. En fait, la plupart des services « entretien traditionnel » sont en mutation vers la maintenance. 1.2 Notion de la défaillance Définition de la défaillance selon la norme NF X 60 – 011 : « altération ou cessation d’un bien à accomplir sa fonction requise ». Synonymes usuels non normalisés : « failure » (anglais), dysfonctionnement, dommages, dégâts, anomalies, avaries, incidents, défauts, pannes, détériorations. Une défaillance peut être : * Partielle : s’il y a altération d’aptitude du bien à accomplir sa fonction requise. * Complète : s’il y a cessation d’aptitude du bien à accomplir sa fonction requise. * Intermittente : si le bien retrouve son aptitude au bout d’un temps limité sans avoir subi d’action corrective externe. 5 1.2.1 Fonction requise Fonction d’un produit dont l’accomplissement est nécessaire pour la fourniture d’un service donné. Une fonction requise pourra être une fonction seule ou un ensemble de fonctions. La notion du service pourra recouvrir une mission, c’est à dire une succession de phases par lesquelles doit passer le produit sur un intervalle du temps donné [1]. 1.2.2 Dégradation État d’une entité présentant une perte de performances d’une de ses fonctions assurées ou alors un sous-ensemble lui-même dégradé, voire défaillant, sans conséquence fonctionnelle sur l’ensemble. On peut aussi parler de dérive [1]. 1.2.3 Triptyque « faute-défaut-défaillance » La défaillance est la conséquence d’un défaut, dont la cause est une faute [3].Voir figure 1 Figure 1 Triptyque « faute - défaut – défaillance » [1] 1.2.3.1 Faute : elle peut être physique (interne ou externe) ou due à l’utilisateur. C’est la notion de 5M : Matières, Matériel, Milieu, Moyens et Main d’œuvre. Elle entraîne une erreur. 1.2.3.2 Défaut : au départ, il est latent, car on ne s’en aperçoit pas tout de suite. Il devient ensuite effectif. Le défaut peut être : Soudain : s’il était imprévisible. Catalectique: s’il est soudain et irréversible. Progressif : s’il était prévisible et éventuellement réversible (exemples : organe qui rouille, fuite sur une soupape). Précoce: s’il se manifeste en début de vie de l’équipement. D’usure: s’il se manifeste en fin de vie de l’équipement. 6 1.2.4 Pannes État d’un produit le rendant inapte à accomplir une fonction requise dans des conditions données d’utilisation. Elle résulte toujours d’une défaillance [1] 1.3 Service maintenance 1.3.1 Situation dans l’entreprise Il existe deux tendances quant au positionnement de la maintenance dans l’entreprise [2]. 1.3.1.1 Tendance 1 La centralisation où toute la maintenance est assurée par un service. Voir figure 2. D’où les avantages sont : Standardisation des méthodes, des procédures et des moyens de communication. Possibilité d’investir dans du matériel onéreux grâce au regroupement. Vision globale de l’état du parc du matériel à gérer. Gestion plus aisée et plus souple. Rationalisation des moyens matériels et optimisation de leur usage Diminution des quantités de pièces de rechange disponibles. Communication simplifiée avec les autres services grâce à sa situation centralisée. Figure 2 Relations possibles entre le service maintenance et les autres services[2] 7 1.3.1.2 Tendance 2 La décentralisation, où la maintenance est confiée à plusieurs services, de dimension proportionnellement plus modeste, et liés à chacun des services de l’entreprise [2]. D’où les avantages sont : Meilleures communications et relations avec le service responsable et l’utilisateur du parc à maintenir. Effectifs moins importants dans les différentes antennes. Réactivité accrue face à un problème. Meilleure connaissance du matériel. Gestion administrative allégée. 1.4 Organigramme du service maintenance Il s’agit d’une représentation schématique de la structure d’une entreprise (d’un service) mettant en évidence les domaines de responsabilité de chaque élément composant [2].Voir figure 3 Figure 3 Exemple de structure d'une entreprise [2] 1.5 Mission du service maintenance Les différentes tâches d’un service maintenance sont : La maintenance des équipements : actions correctives et préventives, dépannages, réparations et révisions. 8 L’amélioration du matériel, dans l’optique de la qualité, de la productivité ou de la sécurité. Les travaux neufs : participation au choix, à l’installation et au démarrage des équipements nouveaux. Les travaux concernant l’hygiène, la sécurité, l’environnement et la pollution, les conditions de travail, la gestion de l’énergie... L’exécution et la réparation des pièces de rechanges. L’approvisionnement et la gestion des outillages, des rechanges... Des prestations diverses, pour la production (réalisation de montages, par exemple) ou pour tout autre service. L’entretien général des bâtiments administratifs ou industriels, des espaces verts, des véhicules... [2] 1.6 Méthodes de la maintenance Le choix entre les méthodes de maintenance s’effectue dans le cadre de la politique de la maintenance et doit s’opérer en accord avec la direction de l’entreprise. Voir figure 4 Pour choisir, il faut donc connaitre : Les objectifs de la direction. Les directions politiques de maintenance. Le fonctionnement et les caractéristiques du matériel. Le comportement du matériel en exploitation. Les conditions d’application de chaque méthode. Les coûts de maintenance et les coûts de perte de production. Figure 4 Méthodes de la maintenance 9 2 Introduction On sait que l’analyse de la fiabilité constitue une phase indispensable dans toute étude de sûreté de fonctionnement. A l'origine, la fiabilité concernait les systèmes à haute technologie (centrales nucléaires, uploads/Industriel/ benaleur.pdf
Documents similaires



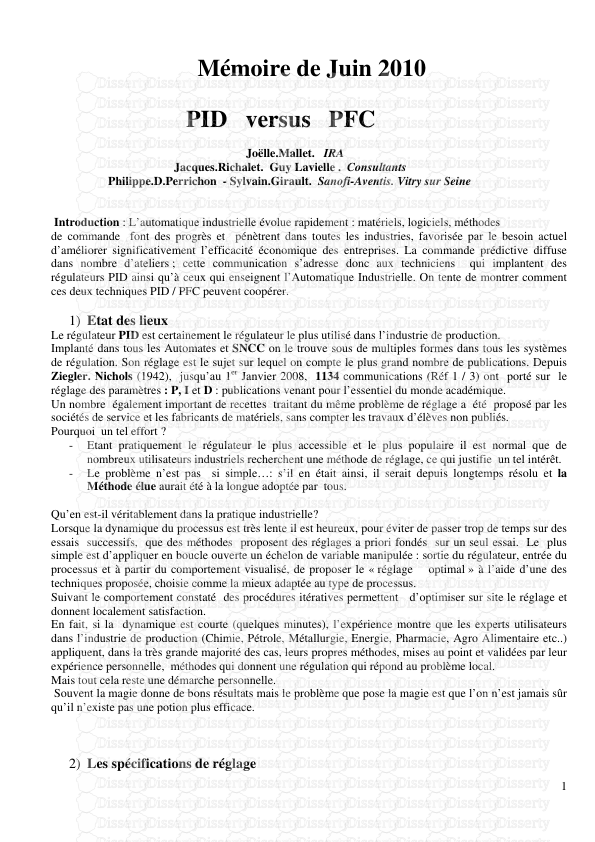






-
88
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 25, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2885MB


