A. Beitone, L. Lorrain, C. Rodrigues, La dissertation de science économique © D
A. Beitone, L. Lorrain, C. Rodrigues, La dissertation de science économique © Dunod, 2019. 1 Entraînement à la dissertation de science économique Sujet 16 Les crises monétaires et financières suffisent-elles toujours à expliquer les crises économiques ? 1. Se préparer à la rédaction 1.1. L’enjeu du sujet Depuis le début des années 1980, les crises financières se sont multipliées : krach boursier de 1987, crise asiatique de 1997, crise des subprimes de 2007-2008. Il s’agit là des événements principaux mais il y a bien d’autres : crise de la dette du Tiers-Monde à partir de 1982-1983, crise Russe (1998), crise argentine (1998), crise Turque (2000-2001), etc. L’idée s’est assez largement imposée dans le grand public comme chez les responsables politiques d’assimiler les crises monétaires et financières aux crises économiques. Les économistes, ont eu, eux aussi, tendance à s’intéresser davantage à ces crises monétaires et financières. Il s’agit donc de savoir si les facteurs monétaires et financiers suffisent toujours à expliquer les crises économiques. S’ils ne suffisent pas, il faudra donc dire quelles sont les autres variables qui interviennent pour rendre compte des crises économiques. Le mot « toujours » est lui aussi important. Il suggère que dans certains cas les variables monétaires et financières suffisent à expliquer les crises, mais pas dans tous les cas. Ces réflexions sur les causes des crises économiques sont évidemment importantes du point de vue de la politique économique. Si les causes des crises économiques étaient toujours et uniquement les crises monétaires et financières, il suffirait de prévenir ce dernier type de crise pour empêcher la survenance des crises économiques. Si d’autres variables sont à l’œuvre, alors la politique économique doit agir sur diverses variables et surtout de façon différenciée selon le contexte macroéconomique. 1.2. Le cadrage et les concepts clés Dans la mesure où le sujet ne comporte pas d’indication chronologique, on adoptera une perspective large allant des crises d’Ancien Régime (ou crises préindustrielles) aux crises contemporaines. Il importe, dans la dissertation, de bien préciser le sens des termes « crises économiques », « crises monétaires », « crises financières ». S’agissant des deux derniers termes, le sens n’en est pas stabilisé. Le candidat devra donc préciser ses choix en matière de définition. L’important est de ne pas oublier que le mot « crise » vient du vocabulaire médical et désigne une période brève et intense au cours de laquelle se manifestent des effets pathologiques (crise d’appendicite, crise cardiaque). Il ne faut donc pas confondre en science économique la crise (période de retournement) et la dépression ou la récession (qui s’étend sur une plus longue période). Par exemple on ne confondra pas la « crise de 1929 » et la « dépression des années 1930 ». A. Beitone, L. Lorrain, C. Rodrigues, La dissertation de science économique © Dunod, 2019. 2 1.3. La construction d’une problématique La problématique découle logiquement de notre analyse des enjeux du sujet. Nous nous proposons de montrer que certaines crises économiques ne sont pas liées principalement à des facteurs monétaires et financiers, même si ces facteurs interviennent cependant dans certains cas (mais pas toujours). Cependant, dans les périodes où l’activité économique est fortement financiarisée, les crises monétaires et financières sont souvent la cause principale (mais pas exclusive) des crises économiques. A. Beitone, L. Lorrain, C. Rodrigues, La dissertation de science économique © Dunod, 2019. 3 2. Rédiger le devoir : une proposition Introduction Pour l’historien de l’économie E. Labrousse, « chaque société a les crises de sa structure ». Il souligne que ce sont les caractéristiques de longue période des économies qui permettent de rendre compte des crises économiques. Les économies préindustrielles, par exemple, ne connaissent pas le même type de crise que les économies industrielles. Les variables explicatives des crises économiques dépendent donc du contexte économique global et en particulier, le rôle des variables monétaires et financières, qui peut être décisif dans certains cas, peut n’être que secondaire dans d’autres cas. Par crise économique on entend une période relativement brève au cours de laquelle on assiste à une dégradation sensible de la situation macroéconomique (stagnation ou baisse de la production, baisse de l’investissement et du commerce international, hausse du chômage, etc.). La crise économique concerne donc plutôt les variables dites « réelles » de l’activité économique. Le terme crise monétaire est souvent utilisé comme synonyme de crise de change : on peut parler par exemple de la crise de la livre sterling en 1967 ou de la crise du franc en 1969. En changes fixes cela se traduit par des dévaluations ou des réévaluations, en changes flottant par des variations importantes et brutales des taux de change. Une crise financière est une crise qui affecte à la fois le système bancaire et les marchés financiers ce qui remet en cause le financement de l’économie. La crise de 1929 et la crise des subprimes sont incontestablement des crises financières. Peut-on dire que les crises monétaires et financières expliquent toujours les crises économiques ? Sans doute pas, car il existe des exemples de crises économiques qui n’ont pas des causes financières (même si elles ont souvent des conséquences monétaires et financières). Peut-on dire que les crises monétaires et financières suffisent à expliquer les crises économiques ? Non plus, car même dans les cas où les variables monétaires et financières jouent un rôle décisif dans le déclenchement de la crise, cela se produit dans un contexte macroéconomique plus large qu’il faut prendre en compte. Après avoir montré (I) que les crises économiques peuvent être liées à des chocs exogènes ou aux caractéristiques structurelles des économies, nous montrerons (II) que dans les économies financiarisées, les crises monétaires et financières expliquent très largement les crises économiques, mais qu’il ne faut pas négliger d’autres facteurs qui interviennent en interaction avec les facteurs monétaires et financiers. * I. Chocs exogènes et crises de structure Les crises économiques ne sont pas toujours explicables par des crises monétaires et financières. En effet, qu’il s’agisse des crises préindustrielles ou de crises contemporaines, des chocs réels exogènes peuvent être à l’origine des crises économiques (I.A). Par ailleurs, de nombreux économistes se sont efforcés de rendre compte des crises industrielles en parlant de cycle des affaires, de cycles longs, d’ondes longues, etc. Pour tous ces auteurs, les crises sont l’expression des contradictions internes inhérentes aux systèmes économiques au sein desquels elles se produisent (I.B). A. Les chocs exogènes : des crises préindustrielles à l’époque contemporaine A. Beitone, L. Lorrain, C. Rodrigues, La dissertation de science économique © Dunod, 2019. 4 Dans la période préindustrielle, les crises économiques sont principalement des crises de sous- production agricole. Compte tenu des techniques de culture en vigueur, les productions sont particulièrement vulnérables aux phénomènes climatiques. Gel, sècheresse, inondation conduisent à une chute des récoltes ce qui se traduit par une hausse des prix des denrées agricoles (il s’agit donc de crises inflationnistes). Si certains paysans tirent profit de la hausse des prix, ce n’est pas le cas de la majorité des travailleurs des champs (serfs, métayers, etc.) qui voient les possibilités de se nourrir remises en cause et qui surtout ne sont pas en mesure de mettre en réserve les semences de la prochaine période de production. Dans les villes, la hausse des prix a des effets sur la population qui souffre de pénurie alimentaire, ce qui affecte les débouchés des artisans et des commerçants. Ce contexte est favorable au développement des épidémies, qui réduisent l’effectif de la population en état de produire. La situation économique est aussi fortement affectée par les guerres et par les troubles divers (bandes de pillards qui écument les campagnes quand le pouvoir royal et seigneurial est affaibli). On assiste à des émeutes de la faim, les bourgeois ou intendants suspectés de favoriser la hausse des prix sont mis à mal et leurs entrepôts pillés (lutte contre les « accapareurs »). Quand A. R. Turgot, en 1774, libéralise le commerce des grains afin de permettre un meilleur approvisionnement des régions les plus touchées par de mauvaises récoltes, on voit se déclencher une « guerre des farines » en réaction à la hausse du prix du pain. Il existe une forme d’autorégulation de ces crises : la baisse de la population sous l’effet des famines, des épidémies et des guerres réduit la demande de grain et favorise la hausse des salaires, dans le même temps, si les conditions climatiques s’améliorent, la production augmente, conduisant à une nouvelle période de prospérité… avant que ne se déclenche une nouvelle « crise frumentaire ». Même s’il écrit au début de la période industrielle en Grande Bretagne, Th. Malthus a sans doute été influencé par l’histoire de ces « crises de cherté » quand il formule sa loi de population. Par la suite, au moins jusqu’en 1870 en France, vont se dérouler des crises mixtes c’est-à-dire des crises qui présentent encore des traits des crises d’Ancien Régime (mauvaises récoltes) et des traits des crises industrielles (crises de surproduction). Dans tous ces processus on le voit, les facteurs monétaires et financiers ne jouent pas. L’existence uploads/Industriel/ sujet-16-corrige-complet 1 .pdf
Documents similaires






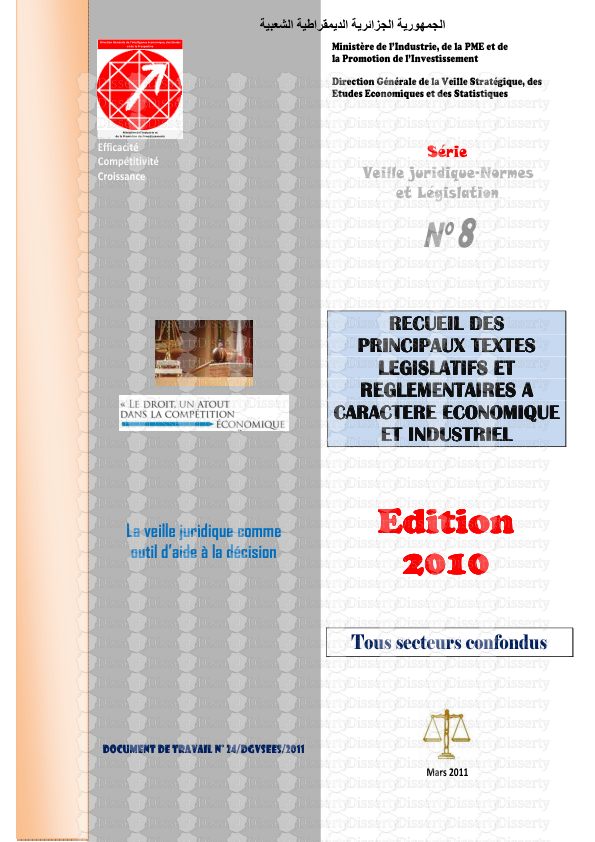



-
48
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 24, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3320MB


