République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l’Enseignement Sup
République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université -20 Août 1955-Skikda Faculté de Technologie Département de pétrochimie Master 2 Génie Pétrochimique Traitement Des Effluents Industriel Représenté par : Encadré par : Gueniche Sabri Nour El Isslem Boulahnache Samia Hasrouri Mohamed Elmadani Hadji Asma 2022/2023 1 Traitement des Composés Organiques Volatiles Sommaire : I. Historique……………………………………………………………………………….……3 II. Introduction ……………………………………………………………………………...…3 III. Les principaux caractéristiques des COV…………………………….………………...…3 IV. Sources d’émission …………………………………………………………………..……4 V. Activités liées à l’émission de COV……………………………………………………..…4 VI. L’Ile-de-France, une région fortement émettrice de COV ………………………..……….5 VII. Méthodes de Mesure …………………………………………………………………...…6 VIII. Encadrement réglementaire pour les COV ………………………………………………7 1. La réglementation internationale ………………………………………………...……7 2. La réglementation nationale…………………………………………………………..7 3. La réglementation européenne …………………………………………………….…8 IX. Techniques de traitement disponibles…………………………………………………...…9 1.Techniques de récupération………………………………………………………..…9 1.1 Condensation………………………………………………………………..…9 La condensation dite mécanique……………………………………...…9 La condensation cryogénique………………………………………….10 1.2 Adsorption……………………………………………………………………10 Les techniques d’adsorptions ……………………………………….…10 1. 3Absorption…………………………………………………………………...10 X. Les effets ………………………………………………………………………………..10 1. La santé ……………………………………………………………………………10 2. Environnement ………………………………………………………………….…11 XI. Conclusion…………………………………………………………………………….13 2 I. Historique On l’a reconnu depuis longtemps, les COV sont l’une des principales causes de la formation de l’ozone troposphérique. Dans les années 1970, les programmes de gestion de l’ozone aux États-Unis ont surtout mis l’accent sur les composés organiques volatils (COV), tenant peu compte des oxydes d’azote (NOx), l’autre principal polluant à l’origine de la formation de l’ozone. De nos jours, il est généralement admis qu’il faut limiter les émissions de NOx aussi bien que de COV si l’on veut réduire la concentration d’ozone troposphérique dans l’air ambiant. Nombre des initiatives mises en œuvre au cours des années 1990 dans le cadre de la phaseI du Plan de gestion des NOx et des COV avalisé par le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) en 1990 privilégiaient la réduction des émissions de COV. Plus près de nous, dans l’Annexe sur l’ozone de l’Accord Canada-États-Unis sur la qualité de l’air que le Canada a signé en 2000, on s’engage à réduire les émissions de COV aussi bien que de NOx. Dans les normes pancanadiennes relatives aux particules et à l’ozone qui ont été avalisées par le CCME en 2000, les COV sont reconnus comme des polluants précurseurs à la fois de l’ozone troposphérique et des P2,5. Tous les COV figurent maintenant à l’annexe1, Liste des substances toxiques, de la LCPE en raison de leur rôle dans la formation de l’ozone et des P2,5. De plus, certains COV ont été évalués et déclarés toxiques aux termes de la LCPE en raison de leurs effets toxiques directs ou de leur rôle dans la formation de l’ozone, et on les a inscrits à l’annexe 1 II. Introduction Une molécule est dite « volatile » lorsqu’elle se déplace facilement en raison de ses passages fréquents de l’état liquide à l’état gazeux et inversement. Un Composé organique volatil (COV) est le nom générique donné à l’ensemble des molécules contenant un atome de carbone et caractérisées par une grande volatilité. Il se trouvent principalement dans l’air mais aussi dans l’eau et le sol. III. Les principaux caractéristiques des C.O.V - ● Sont présents dans de nombreux produits courants : matériaux de finition et d’aménagement, peintures, encres, colles, vernis, détachants, cosmétiques, solvants 3 ● Ont des effets très variables selon le polluant concerné: irritations des muqueuses, céphalées, nausées, vomissements, troubles cardiaques, de la mémoire, de l’attention, substances toxiques pour foie, voies respiratoires, reins, système nerveux,... ● Certains C.O.V. (notamment benzène, formaldéhyde) sont reconnus comme cancérigènes par l’O.M.S. ● De plus, les C.O.V. interviennent dans le processus de formation d’ozone dans la basse atmosphère, participant aux épisodes de « pics de pollution » estivaux qui ont des effets négatifs importants sur la santé humaine (problèmes respiratoires) et la végétation (diminution de croissance). IV. Sources d’émission : Les composés organiques volatils sont utilisés dans de nombreux procédés, peuvent donc provenir d'émissions naturelles ou humaines. Sur le plan naturel, la diffusion et les émissions de molécules COV peuvent être liées à la végétation et ses réactions chimiques, ou encore aux feux de forêt, aux nuages provoqués par les éruptions volcaniques... Du côté des émissions liées à l'activité humaine, celles-ci proviennent dans la très grande majorité des cas de l'activité industrielle et en particulier de l'omniprésente combustion ou d’évaporation de solvants présents dans les peintures, encres, colles, cosmétiques ou détachants. Ils peuvent également être émis lors de la manipulation de produits pétroliers. V. Activités liées à l’émission de COV Elles sont très nombreuses, elles appartiennent généralement aux secteurs industriels suivants: • Industrie sidérurgique. • Industrie plastique. • Industrie alimentaire. • Industrie du bois. • Industrie des peintures, des vernis et des laques. • Industrie bovine. 4 • Industrie pharmaceutique. • Industrie cosmétique. VI. L’Ile-de-France, une région fortement émettrice de COV Les données du CITEPA montrent qu’en 2004, les émissions nationales de COV représentaient 1 367 kt (CITEPAa, 2006). La région Ile-de-France contribue à environ 5 % des émissions nationales de COV. En 2000, elle se trouvait en troisième position des régions les plus émettrices de COV, derrière les régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur (cf. Annexe 1). Parmi les COV émise Ile-de-France, les trois quarts sont émis par l’agglomération parisienne et près de la moitié par les quatre départements du cœur de l’agglomération : Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Le poids de l’agglomération parisienne en termes d’émissions de polluants s’explique par la densité de ses émissions, concentrées sur une surface relativement restreinte, plus que par la quantité de polluants émis par habitant (Airparif, 2005). Dans le cadre de son inventaire des émissions, Airparif a quantifié les contributions des différents secteurs d’activités aux émissions de COV en Ile-de-France en 2000. Six catégories d’activités ont alors été utilisées afin de rendre compte des grandes caractéristiques de la région Ile-de-France. Ils s’agit : - du trafic routier (incluant les émissions de COV par évaporation au sein des stations-service) ; - des autres transports (ferroviaire, fluvial, maritime, aérien) ; - des industries (centrales thermiques, chauffage urbain, procédés de production, utilisation industrielle de solvants, traitement et élimination des déchets…) ; - du secteur résidentiel, tertiaire et artisanal (combustion liée au chauffage, utilisation des solvants dans les secteurs domestiques et de service) ; - des sources biogéniques (forêts et prairies) ; - de l’agriculture et la sylviculture (usage d’engrais azotés, combustions dans le secteur agricole). Les résultats sont présentés dans le Tableau2. Ainsi, le trafic routier et l’industrie sont les principales sources de COV en Ile-de-France, contribuant respectivement à 33 % et 31,4 % des émissions franciliennes de COV en 2000. Le secteur résidentiel, tertiaire et artisanal représentait 18,6 % des émissions en 2000. Enfin, les sources biogéniques ne sont pas négligeables, elles représentaient13,4 % des émissions en 2000. La Figure 1 représente la répartition des émissions de COV en Ile-de-France en 2000 selon les secteurs d’activités. Toutefois, il faut noter que les inventaires d’émissions comportent des incertitudes importantes, de l’ordre de 50 % pour les COV. En effet, il s’agit d’estimations qui reposent souvent sur des appréciations d’experts. 5 Tableau 1. Emissions de COV en Ile-de-France en 2000 selon les secteurs d'activités Figure 1. Répartition des émissions de COV en Ile-de-France en 2000 selon les secteurs d'activités VII. Méthodes de mesures : La France et d’autres pays disposent d’analyseurs en mesure continu pour mesurer hebdomadairement l'émission de COV. Ils sont munis d'un Détecteur à Ionisation de Flamme (FID). Deux types sont notamment employés : L'analyseur d'hydrocarbure totaux (HCT) L'analyseur d'hydrocarbures totaux non-méthaniques (HCT/HCTNM). Celui-ci permet de transmettre des mesures d'hydrocarbures totaux, de méthane et d'hydrocarbures totaux non_méthaniques en alternance (ou simultanément par soustraction pour les appareils munis de deux détecteurs). Il est pourvu d’un four catalytique (faisant la combustion des hydrocarbures autres que le méthane) ou un adsorbant (telque le charbon actif) permettant la séparation. 6 Il existe également une technique portant sur l'analyse par µGC/MS (micro-chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse). Celle-ci assure toutes les deux minutes une analyse en semi-continu et permet surtout l’identification et la quantification en temps réel de tout COV dont la concentration est supérieure à 1 ppm. La technique est appropriée pour le suivi des processus ou des rejets atmosphériques dont la composition peut évoluer dans le temps. VIII. Encadrement réglementaire pour les COV Il existe 3 types de réglementation, à savoir : 1.La réglementation internationale : Concernant les COV, il y a 2 protocoles référents : • Le protocole de Göteborg - Réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique en 1999. Il a une double fonction « multi-effet et multi-polluant » car il vise les polluants (oxydes d’azote, dioxyde de soufre, ammoniac) qui sont responsables de l’acidification et de l’eutrophisation. Dans la basse atmosphère, un constat est l’accumulation d’ozone qui est due aux Nox et aux émissions de COV (composés organiques volatils). • Le protocole de Genève - Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance en 1991. Il vise à lutter contre les émissions de plusieurs polluants atmosphériques dont les COV et leurs flux transfrontières, issus des produits à usage industriel et domestique, ainsi que les oxydants photochimiques secondaires qui en résultent. uploads/Industriel/ traitement-des-composes-organiques-volatiles.pdf
Documents similaires






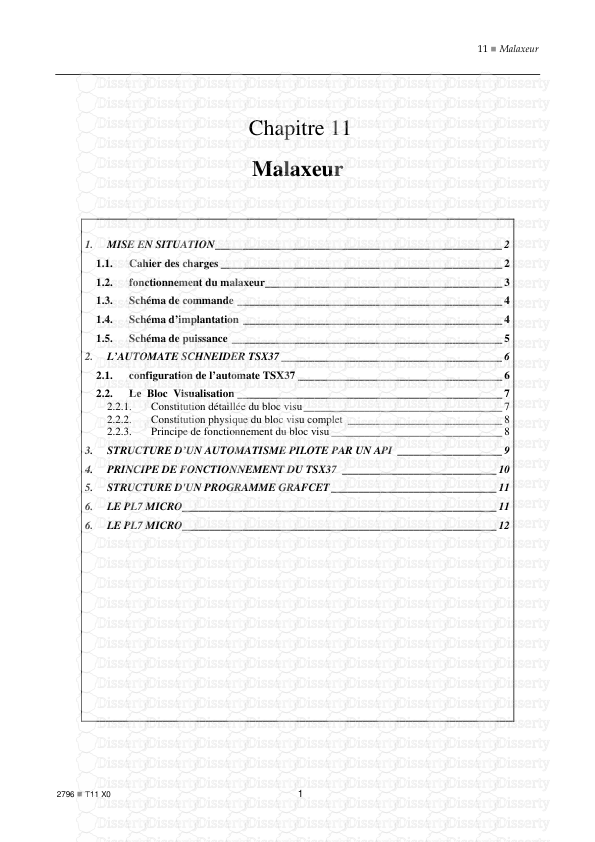



-
43
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 24, 2021
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3826MB


