UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA UFR- COMMUNICATION, MILIEU ET SOCIETE DÉPARTEMENT
UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA UFR- COMMUNICATION, MILIEU ET SOCIETE DÉPARTEMENT D’ESPAGNOL Année universitaire : 2020-2021 Doctorat 1 Syllabus de cours INTITULÉ DU COURS : Méthodologie de la recherche et validation des acquis Nom de l’enseignant : M. KOFFI EHOUMAN RENE Grade : Maître de Conférences 1 Plan du cours I. La compréhension du sujet II. La présentation matérielle du travail III. La rédaction de la thèse 2 1 La compréhension du sujet Toute recherche scientifique porte sur un objet, un thème ou un sujet donné. Ainsi, pour mieux mener des démarches, il importe d’abord de procéder à la compréhension de l’objet, du thème ou du sujet donné. La compréhension de l’objet, du thème ou du sujet passe par plusieurs étapes. Dans le cadre de ce cours, Préambule Que faut-il entendre par « sujet » dans le contexte de ce cours ? Quelle est la différence entre un « sujet » et un « thème » ? Un « sujet » est ce qui est soumis à l’esprit, à la pensée ; ce sur quoi s’exerce la réflexion. Il est, en général, limité de par sa formulation. Le « thème » est, quant à lui, un sujet, une idée, une notion, une proposition qu’on développe. Il est sans limite. Exemples de sujet et de thème : - Sujet : « La place de la femme dans Une Si Longue Lettre (Mariama Ba) » - Thème : « La place de la femme dans la société » 1.1 Situation du sujet dans un contexte général Aucun sujet de recherche ne naît ex nihilo et rares sont les sujets ou domaines de recherches qui n’ont jamais été abordés, d’une manière ou d’une autre, par un chercheur ou un autre. Par ailleurs, tout sujet s’inscrit dans un domaine donné, domaine qui, lui-même a une histoire évoluant au gré des événements et des discours qui s’y rapportent. Le bon sujet a une pertinence scientifique et/ou sociale. Pour toutes ces raisons, le chercheur doit situer son sujet dans un contexte qui, bien que général, doit être en rapport plus ou moins direct avec le sujet. Ce contexte général peut être de plusieurs ordres : théorique, critique, conceptuel, historique, culturel, littéraire, social, etc. Le plus important, c’est de choisir le contexte approprié, celui qui convient le mieux au sujet à traiter. Il faut alors éviter une contextualisation « passe partout » pouvant se prêter à tous les sujets s’inscrivant dans le domaine concerné. Il ne doit pas y avoir de hiatus ou d’écart entre le contexte choisi et le sujet ou le problème à traiter. Dans le domaine littéraire qui nous concerne, particulièrement, le sujet de recherche peut être situé à partir des points d’ancrage suivants : La littérature en général La littérature française La littérature négro-africaine 3 L’univers socio-culturel Une approche genrologique (poésie, roman, nouvelle, théâtre, etc.) Une forme littéraire spécifique (autobiographie, autofiction, roman épistolaire, roman policier, paralittérature, roman de science-fiction, essai littéraire, etc.) Un courant de pensée ou une école littéraire (le baroque, le classicisme, le réalisme, le postmodernisme, etc.) Une méthode critique d’analyse (le structuralisme, la narratologie, la sémiotique, la sociocritique, la mythocritique, la génétique, etc.) Une étude antérieure (à prolonger, à approfondir ou à dépasser) Quel que soit le contexte situationnel arrêté, le chercheur doit s’assurer qu’il a choisi l’angle d’approche qui convient, « le contexte adéquat permettant une bonne visibilité, une appréhension correcte et un traitement conséquent et efficace »1 du sujet. 1.2 Définitions des termes, notions et concepts clés La précision des données et/ou la définition des termes clés, des notions et des concepts déterminants répond(ent) à un souci de clarté. Des données ou termes du sujet peuvent, en effet, faire l’objet de lectures, d’interprétations diverses. Le chercheur doit alors « élaguer » le sujet en passant en revue et en excluant les interprétations non désirées. Par exemple, un étudiant qui travaille sur « La poétique du chant dans le roman africain » doit pouvoir préciser son acception du terme « chant » en le distinguant de « chanson » et de « musique » ou, pourquoi pas, en étendant plutôt sa notion de « chant » aux notions connexes que sont « chanson », « chansonnette », « musique » et autres. Le plus important est d’éviter à soi-même d’aller dans tous les sens (qui trop embrasse mal étreint !) et d’éviter aux lecteurs d’aller de conjectures et conjectures dès l’entame de l’introduction qui devait pourtant fournir les repères nécessaires. 1.3 Délimitation du sujet 1Pierre N’DA, Manuel de méthodologie et de rédaction de la thèse de doctorat et du mémoire de master en lettres, langues et sciences humaines, Paris, L’Harmattan, 2015, p. 87. 4 Le sujet, formulé sous la forme de titre du mémoire ou de thèse, reste elliptique. Il ne dévoile pas assez sa pensée. Le chercheur gagnera alors, toujours dans un élan de précision, d’établir les frontières de son sujet, de le « délimiter ». L’opération consiste, concrètement, « à baliser son champ d’intérêt en circonscrivant son étude dans une période donnée, dans un espace déterminé, ou dans un domaine clairement défini. »2 Ainsi, pour un sujet comme « Onomastique et création romanesque africaine », bien formulé mais très elliptique, on peut être amené à le délimiter en précisant, d’une part, que l’analyse onomastique ne s’intéressera qu’aux anthroponymes (plus significatifs) et, d’autre part, que l’étude portera essentiellement sur les romans négro-africains de la nouvelle génération. 1.4 Reformulation du sujet Après avoir précisé et délimité le sujet, de sorte à éviter toute ambiguïté et tout malentendu, le chercheur doit le reformuler. Il s’agit, à cette étape, de proposer une autre version du sujet qui en explicite le sens et l’orientation définitive. La reformulation doit pouvoir mettre en évidence l’aspect particulier choisi, l’approche spécifique retenue. Le libellé définitif du sujet ou le titre exact du mémoire ou de la thèse doit être mis en exergue par une typographie particulière. Par ailleurs, le titre définitif du mémoire doit être en adéquation avec les principales articulations du travail. Il faut donc éviter les reformulations fantaisistes dont les termes n’apportent pas d’informations précises. S’il le juge nécessaire, le chercheur peut, toujours par souci de précision, adjoindre un sous-titre au titre principal. Ex : « L’ (in)forme dans le roman africain : formes, stratégies et significations ». 1.5 Présentation matérielle du travail Un travail d’étude et de recherche ne se réduit pas seulement à la connaissance du thème et du sujet de recherche. Sa bonne présentation matérielle participe à / de la qualité de son contenu. Cette section traitera donc des conventions relatives à la présentation du mémoire ou de la thèse. Seront successivement aborder la présentation des parties et chapitres, les titres et sous-titres, le l’après titre/chapeau, la transition, le paragraphe, les caractères, interlignes et lignes, la pagination, le cadrage la reliure, le traitement des citations, les notes au bas de la page, la présentation des chiffres, etc. 2 Pierre N’DA, Op. cit., p. 192. 5 1.6 La présentation des parties et / ou chapitres En principe, le mot « partie » et son intitulé qui suit doivent tenir sur une page entière et être centrés. Cette page n’est pas numérotée, mais elle est prise en compte dans le décompte des pages du document. De même, le mot chapitre et ses numérotations doivent être centré, mais pas sur page entière. L’intitulé du chapitre doit être également centré en dessous. C’est dans le sommaire et la table des matières que l’intitulé du chapitre suit directement l’indication de division. Un chapitre, sans sections ou divisions, est correct dans les travaux de littérature, mais inacceptable dans les domaines scientifiques et techniques. 1.7 L’après titre et le chapeau Les titres (et sous titres) des parties, chapitres et subdivisions ne font pas partie du texte en tant que telle. Les normes rédactionnelles recommandent qu’ils soient repris dans la phrase qui débute. L’apprenti chercheur peut saisir cette occasion pour les définir afin que lui-même et le lecteur en aient une claire vision et sache exactement leur sens. Ce préambule s’appelle « chapeau ». Celui-ci est un paragraphe qui se situe au début d’une division (partie et chapitre par exemple) après le titre. Il vient avant le titre de la première section. Entre ces deux titres, il expose schématiquement les principaux thèmes qui seront abordés. Il est un texte court qui surmonte et présente le titre et le texte de la section à venir. Il met en exergue la trame qui va fonder les analyses d’une division à venir. Il est en quelque sorte une introduction partielle à la section qu’il ouvre. Il faut éviter de donner des conclusions des analyses dans le chapeau. On ne retiendra pas les énoncés qui ne mettent pas en valeur ce qui va suivre. Un énoncé banal n’est pas un chapeau. 1.7.1 Les transitions L’étudiant veillera à ménager des transitions entre les différentes parties, sections et sous sections. La transition est un passage à ménager pour un changement souple. Il évitera donc de passer d’une section uploads/Litterature/ doctorat-1-espagnol.pdf
Documents similaires








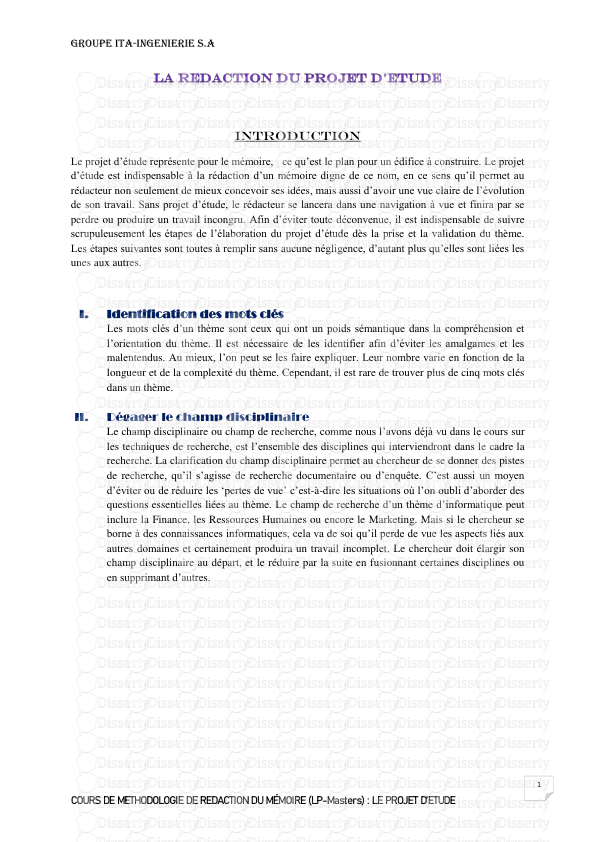

-
28
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 31, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1621MB


