J. DUSSOUCHET Professeur de grammaire au lycée Henri IV. COURS PRIMAIRE DE Gram
J. DUSSOUCHET Professeur de grammaire au lycée Henri IV. COURS PRIMAIRE DE Grammaire Française Théorie 1134 Exercices 133 Rédactions RÉDIGÉ CONFORMÉMENT AUX PROGRAMMES OFFICIELS ET COMPLÉTÉ PAR DES NOTIONS DE COMPOSITION ET DE VERSIFICATION UNE HISTOIRE DES LITTÉRATURES ANCIENNES ET MODERNES AVEC DES EXTRAITS DES PRINCIPAUX ÉCRIVAINS COURS SUPÉRIEUR ET COMPLÉMENTAIRE BREVET ÉLÉMENTAIRE A V E R T I S S E M E N T Ce livre, destiné au Cours supérieur et au Cours complémen- taire de nos écoles, s'inspire de la même méthode que les cours précédents. La Partie théorique, très courte (135 pages à peine sur 448), est pourtant très complète. Les règles, toujours déduites des exemples, sont condensées dans une formule claire et facile à rete- nir, et suivies, lorsqu'il y a lieu, d'un Commentaire en petit texte. Une histoire résumée de la langue française, des notions d'étymolo nymes, des synonymes, des gallicismes, etc., précèdent la grammaire proprement dite. Cette disposition permet de rendre dès le début plus intéressants et plus variés les exercices sur chaque partie du discours. Nous avons particulièrement insisté sur l'étude de la proposition: nous avons passé en revue et résolu maints petits problèmes d'ana- lyse des mots, et notre théorie de l'analyse des propositions est conforme, en tous points, aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 25 juillet 1910 concernant, la nomenclature grammaticale. Les Exercices, au nombre de 1 134, comprennent : 292 Groupes de mots ou de phrases détachées pour l'application immédiate de la règle. 232 Textes suivis sur l'orthographe de règles et l'orthographe d'usage. Ces morceaux, empruntés pour la plupart aux Comptes rendus des examens du brevet élémentaire, sont accompagnés de nombreuses questions d'intelligence et de grammaire, conformé- ment à l'arrêté ministériel du 8 août 1903. 402 Exercices de grammaire et de vocabulaire sur les familles de mots, sur le sens propre et le sens figuré, les homonymes, les synonymes, sur l'analyse, etc. 75 Exercices d'élocution pour l'explication des idées et des mots, pour la construction des phrases, etc. 133 Rédactions, lettres, récits, descriptions, questions de morale, petites analyses littéraires, etc. Tous ces exercices sont divisés en deux séries. Nous comprenons sous le nom d'Exercices complémentaires ceux qui visent à la fois plusieurs points de la grammaire et demandent des connaissances plus étendues. Enfin nous avons donné dans la dernière partie : 1° Des Notions de composition, de versification et de littérature; 2° Un Abrégé d'histoire littéraire avec extraits des auteurs cités ; 3° Une liste complète des homonymes, une liste de paronymes, de synonymes et de familles de mots. Nous avons à remercier, en finissant, M. Roy, directeur de l'École communale et du Cours complémentaire de Saint-Maur-des-Fossés (Seine), qui nous a prêté, pour l'ensemble de ce travail et surtout pour le choix et la composition des Exercices, le précieux concours d'un sens pédagogique très éclairé et d'un labeur infatigable. GRAMMAIRE FRANÇAISE COURS SUPÉRIEUR INTRODUCTION HISTOIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE I. Géographie. — La langue française comprend tout le domaine de la France actuelle, à l'exception d'une seule province, la Bretagne, où plus d'un million d'habitants parlent une langue connue sous le nom de bas breton et qui est d'origine celtique. A cette exception importante on peut en ajouter quelques autres : 1° dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, 1100 000 habitants parlent l'alsacien, d'origine germanique; 2° dans le département du Nord, 175000 habitants parlent le flamand, également d'origine germanique; 3° dans le départe- ment des Basses-Pyrénées, 140 000 habitants parlent le basque, idiome fort ancien dont l'origine est inconnue; 4° dans le dépar- tement des Pyrénées-Orientales (ancienne province du Roussillon), plus de 270 000 habitants parlent le catalan, dérivé du latin; 5° enfin, dans l'île de Corse, plus de 200 000 habitants parlent un dialecte très voisin du génois. Ajoutons que la plupart des habitants des régions que nous venons de citer sont aujourd'hui bilingues et qu'à côté de leur langue régionale, ils parlent le français. 2. Si le domaine de la langue française ne s'étend pas sur tout le territoire actuel de la France, en revanche il comprend à l'étranger plusieurs territoires importants : une partie de la Belgique, le Luxembourg, la Suisse romande, les hautes vallées du Piémont et les îles Normandes qui appartiennent à l'Angleterre. Il faut y ajouter, hors d'Europe, les colonies anglaises du Canada et de l'île Maurice, la république d'Haïti, qui ont conservé l'usage du français; sans parler de nos propres colonies (Antilles françaises, Algérie, Tunisie, Guyane, Sénégal, Cochinchine, Madagascar, Congo, etc.). En résumé, la langue française est parlée par 60 000 000 d'hommes environ. 3. Dans toute l'étendue de notre territoire, tous les gens cul- tivés parlent le français; tous les paysans comprennent le fran- çais, mais parlent des patois assez différents les uns des autres et même du français. A ce point de vue on peut diviser la France en deux grandes régions, à peu près limitées par une ligne qui irait de l'embou- chure de la Gironde au cours de l'Ain. Au nord de cette ligne six groupes de patois : le normand, le poitevin, le picard, le wallon, le lorrain, le bourguignon-champenois. Ce sont les patois français. Au sud de cette ligne, les patois sont plus vivants et plus répan- dus; ce sont : le gascon, le limousin, l'auvergnat, le languedocien et le provençal. On a donné à ces patois le nom commun de putois provençaux. 4. Introduction du latin en Gaule. — Chacun sait que les premiers habitants de la Gaule, à notre connaissance, furent les Gaulois, qui parlaient une langue de la famille celtique, c'est-à-dire parente des idiomes que nous entendons aujourd'hui, en France, dans la bouche des Bas-Bretons, — et, en Angleterre, dans l'Ecosse, l'Irlande et le pays de Galles. Dans le premier siècle avant l'ère chrétienne, les Romains, sous la conduite de César, conquirent la Gaule et la réduisirent en pro- vince romaine. Bien supérieurs aux Gaulois par la science et la civilisation, les Romains, quoique moins nombreux, imposèrent aux vaincus la langue latine avec le joug romain, de même que nous imposons peu à peu le français aux Arabes d'Algérie. 5. Mais à Rome, comme en France aujourd'hui, il y avait deux langues en présence : 1° celle du peuple et des paysans, le latin vulgaire, en un mot; — 2° celle des savants, des écrivains et des lettrés, que l'on désigne sous le nom de latin classique ou latin littéraire. Toutes deux employaient souvent des mots différents pour exprimer la même idée : tandis que le latin classique, par exemple, disait equus, pour signifier un cheval, le latin vulgaire disait caballus, d'où nous avons fait le français cheval; tandis que le latin classique disait via, le latin vulgaire disait camminus, d'où nous avons fait chemin C'est naturellement le latin vulgaire que les soldats romains, apportèrent aux paysans gaulois; et, dès les premiers siècles de notre ère, il avait supplanté le celtique par toute la Gaule, à l'ex- ception de l'Armorique et de quelques points isolés. Celui-ci disparut donc de la Gaule en laissant cependant quel- ques faibles traces de son passage. On peut citer comme emprunts au celtique : alouette, bec, bouleau, bruyère, claie, dune, grève, jarret, lande, lieue, quai, etc. C'est un total d'un peu plus de trente mots. Nous devons aussi au celtique notre ancien mode de numération par 20 (six-vingts, quinze-vingts, quatre-vingts, etc.). 6. Langue romane. — Dès le cinquième siècle, le latin vul- gaire transformé par la prononciation gauloise, renforcé par une foule de mots germaniques, commence à apparaître comme une langue distincte, que les savants du temps appellent dédaigneu- sement lingua romana rustica (c'est-à-dire le latin rustique, celui des paysans), d'où nous avons fait la langue romane pour désigner ce nouvel idiome. Quant aux Barbares germains qui envahirent la Gaule, ils aban- donnèrent l'allemand pour adopter la langue des Gallo-Romains qu'ils avaient vaincus. Bien des motifs expliquent comment les Franks abandonnèrent le francique pour le latin : en premier lieu, le petit nombre des vainqueurs, la grande supériorité intellectuelle des vaincus, enfin la conversion des Franks au christianisme. 7. Mais si le germanique ne parvint pas à supplanter la langue romane, il la força à adopter un grand nombre de mots germa- niques. Ces mots représentent les catégories d'idées les plus diverses : cependant la guerre, la navigation, la chasse y prennent la part la plus considérable. 8. Langue d'oïl et langue d'oc. — De même que le latin vulgaire donna en Gaule le français, en Italie il devint l'italien, en Espagne l'espagnol. En France même, le latin vulgaire, la langue romane, se partagea en deux grands groupes séparés par une ligne imaginaire qui irait de la Gironde à Lyon. Au nord de cette ligne il donna la langue d'oïl ou français; au sud, il donna la langue d'oc ou provençal. Ces noms proviennent de l'habitude, fréquente au moyen âge, de dési- gner les langues par le signe d'affirmation oui : les termes de langue d'oïl et de langue d'oc viennent de ce que oui se disait oïl au nord, oc au midi, Le poète italien uploads/Litterature/ grammaire-francaise-dussouchet-ocr.pdf
Documents similaires









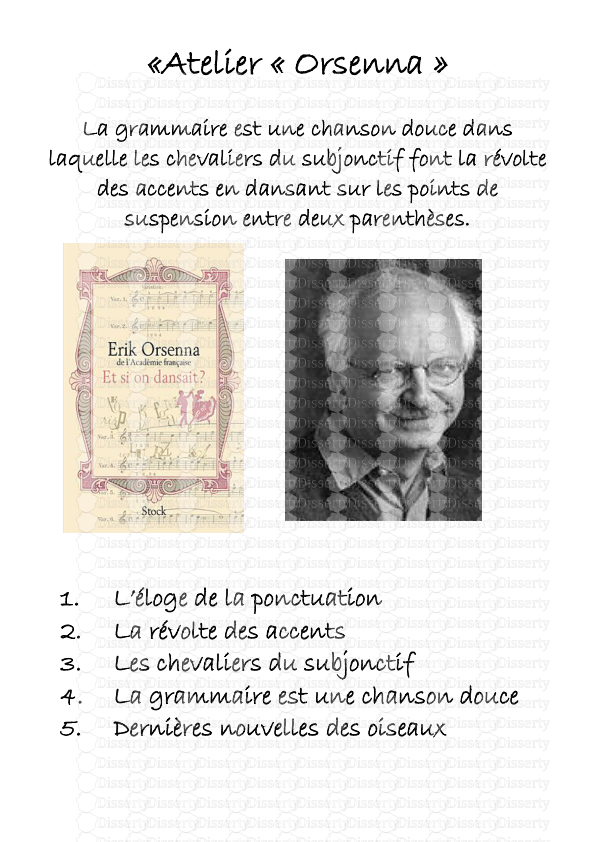
-
62
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 12, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 30.9016MB


