Tous droits réservés © Faculté de théologie et de sciences des religions, Unive
Tous droits réservés © Faculté de théologie et de sciences des religions, Université de Montréal, 2005 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research. https://www.erudit.org/en/ Document generated on 06/21/2022 10:38 a.m. Théologiques De l’ intentio operis à l’ intentio lectoris Essai herméneutique à partir de l’épisode du démoniaque de Gérasa (Mc 5,1-20) André Gagné Le Soi dans tous ses états Volume 12, Number 1-2, 2004 URI: https://id.erudit.org/iderudit/011563ar DOI: https://doi.org/10.7202/011563ar See table of contents Publisher(s) Faculté de théologie et de sciences des religions, Université de Montréal ISSN 1188-7109 (print) 1492-1413 (digital) Explore this journal Cite this article Gagné, A. (2004). De l’ intentio operis à l’ intentio lectoris : essai herméneutique à partir de l’épisode du démoniaque de Gérasa (Mc 5,1-20). Théologiques, 12(1-2), 213–232. https://doi.org/10.7202/011563ar De l’intentio operis à l’intentio lectoris Essai herméneutique à partir de l’épisode du démoniaque de Gérasa (Mc 5,1-20) André Gagné Université de Montréal Université catholique de Louvain 1. Hypothèse et démarche L’épisode du démoniaque de Gérasa (Mc 5,1-20 // Mt 8,24-34; Lc 8,26- 391) est un des plus captivants de tout le Nouveau Testament. Mais l’idée que des forces maléfiques pourraient avoir une telle emprise sur les hom- mes se heurte au doute du lecteur moderne, pour qui le monde du récit semble bien loin de la réalité2. Alors, comment interpréter ce texte? Faut- il y renoncer? Si oui, pourquoi continuer à le lire? Sinon, quel sens peut- il avoir pour moi, lecteur d’aujourd’hui? Que puis-je espérer y trouver? Avant d’entamer l’étude du texte en question, il importe d’en faire une lecture suivie afin de voir de quoi il s’agit. Cette histoire est précédée du récit de l’apaisement de la tempête sur la mer (Mc 4,35-41) et suivie de l’histoire de la guérison de la fille de Jaïros (Mc 5,21-24a.35-433). Le récit de Mc 5,1-20, quant à lui, s’amorce par l’information que Jésus arrive au pays des Géraséniens et qu’un démoniaque vient à sa rencontre (5,1-2); il se clôt avec le départ des deux protagonistes du lieu de l’évé- nement (5,18-20). Le texte de Mc 5,1-20 de la Traduction Œcuménique de la Bible (TOB) se présente comme suit: Théologiques 12/1-2 (2004) p. 213-232 1. Dans cet article, je n’examine que la version de Mc, à l’origine des récits de Mt et de Lc. 2. Cela n’empêche pas le fait qu’une telle vision du monde soit partagée par certains groupes religieux. 3. Notons qu’un autre récit, l’histoire de la guérison de la femme à la perte de sang (Mc 5,24b-34), est inséré à l’intérieur même de l’histoire de la guérison de la fille de Jaïros. 214 andré gagné (1) Ils arrivèrent de l’autre côté de la mer, au pays des Géraséniens. (2) Com- me il [Jésus] descendait de la barque, un homme possédé d’un esprit impur vint aussitôt à sa rencontre, sortant des tombeaux. (3) Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. (4) Car il avait été souvent lié avec des entraves et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves, et personne n’avait la force de le maîtriser. (5) Nuit et jour, il était sans cesse dans les tombeaux et les montagnes poussant des cris et se déchirant avec des pierres. (6) Voyant Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui. (7) D’une voix forte il crie: «Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t’adjure par Dieu, ne me tour- mente pas.» (8) Car Jésus lui disait: «Sors de cet homme, esprit impur!» (9) Il l’interrogeait: «Quel est ton nom?» Il lui répond: «Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux.» (10) Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. (11) Or il y avait là, du côté de la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. (12) Les esprits impurs supplièrent Jésus en disant: «Envoie-nous dans les porcs pour que nous entrions en eux.» (13) Il le leur permit. Et ils sortirent, entrèrent dans les porcs et le troupeau se précipita du haut de l’escarpement dans la mer; il y en avait environ deux mille et ils se noyaient dans la mer. (14) Ceux qui les gardaient prirent la fuite et rapportèrent la chose dans la ville et dans les hameaux. Et les gens vinrent voir ce qui était arrivé. (15) Ils viennent auprès de Jésus et voient le démoniaque, assis, vêtu et dans son bon sens, lui qui avait eu le démon Légion. Ils furent saisis de crainte. (16) Ceux qui avaient vu leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et à propos des porcs. (17) Et ils se mirent à supplier Jésus de s’éloigner de leur territoire. (18) Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à être avec lui. (19) Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: «Va dans ta maison auprès des tiens et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde». (20) L’homme s’en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l’étonnement. La plupart des études traitant de l’épisode du démoniaque de Gérasa ont été entreprises dans une perspective historique. Mais cette démarche s’est trop souvent limitée à l’histoire du texte, c’est-à-dire à la critique textuelle et à l’histoire de la tradition, au détriment de l’interprétation (Craghan 1968, 522-526; Pesch 1971; Légasse 1997, 318). D’autres ont cherché à comprendre ce texte à partir du climat sociopolitique au pre- mier siècle. La confrontation entre Jésus et Légion aurait servi à illustrer la supériorité du Christ face aux ennemis du peuple de Dieu (Myers 1998, 186-210), dénonçant ainsi la politique oppressive de Rome à l’épo- 215 l’épisode du démoniaque de gérasa que du récit (Gagné 2001). Dans une autre visée, certains ont su relever les tensions du texte en soulignant les rapprochements qui existent entre la défaite de Légion et certains récits de l’Ancien Testament (Cave 1964; Derrett 1979). Ils perçoivent ainsi l’intertextualité comme une clé de lecture majeure dans l’interprétation de Mc 5,1-20. Par ailleurs, certains auteurs ont opté pour la voie synchronique (Senior 1984; Wefald 1995). Aborder l’Évangile de Marc en tenant compte de sa cohérence globale permet de mieux saisir sa théologie. Une lecture synchronique cherche à comprendre la façon dont le texte programme la lecture et configure la vision du monde de ses destinataires. Aborder un récit dans sa facture synchronique, c’est admettre qu’un texte peut être compris à partir de ses propres mécanismes internes. Dans ce cas, le sens est essentiellement du côté de l’intentio operis (Eco 1992, 29-32). Toujours sur le plan interprétatif, une approche intertextuelle exige que l’on reconnaisse la présence d’un texte dans un autre texte (Genette 1982, 8; Compagnon 1998, 130-131). L’interprétation dépend alors de la manière dont un auteur a intégré certaines données textuelles à son œuvre, en vue de produire une résonance théologique qui lui est propre. Dans cette perspective, l’intertextualité se reconnaît dans des textes qui portent les traces linguistiques évidentes d’autres textes. À l’instar des recherches synchroniques, ce type d’approche intertextuelle considère aussi l’interprétation comme relevant de l’intentio operis, fai- sant partie des procédés communicationnels de l’auteur ou de l’œuvre4. Mais il existe une autre manière d’aborder l’intertextualité en la plaçant du côté de l’intentio lectoris5 (Compagnon 1998, 130-131). Dans cette perspective, l’intertextualité est essentiellement une entreprise de 4. La stratégie communicationnelle peut être autant celle de l’auteur réel que de l’auteur implicite. Certains s’objecteront du fait que l’on parle ici d’auteur, en signa- lant que nous n’avons aucun accès à l’auteur réel ou historique de l’œuvre. Le débat tourne autour de la question de l’intentionnalité de l’auteur. Si certains veulent éviter de parler de l’intention de l’auteur, il faudra tout de même admettre qu’il y a, certes, une intentionnalité textuelle évidente, par la présence même de l’inter- textualité (voir Compagnon 1998, 107-110). Cela dit, que ce soit l’auteur réel, l’auteur implicite ou le texte, il y a intentionnalité et rien ne suppose que l’on ne puisse pas l’attribuer à un auteur réel ou implicite. 5. On pourrait dire que l’intentio lectoris s’apparente à ce que certains appellent aujourd’hui le reader response criticism ou la critique à l’heure du lecteur (voir Resseguie 1982, 411-343). 216 andré gagné lecture où les renvois intertextuels sont arbitraires. L’intertexte se cons- truit à partir du rapport qu’un lecteur établit entre les textes6. La vaste expérience de lecture d’un individu devient le catalyseur de l’intertextua- lité. Elle se manifeste lorsque «la mémoire est alertée par un mot, une impression, un thème […] comme un souvenir circulaire» (Piégay-Gros 2002, 19). Ce faisant, l’intertextualité est uploads/Litterature/ jesus-et-les-demons.pdf
Documents similaires


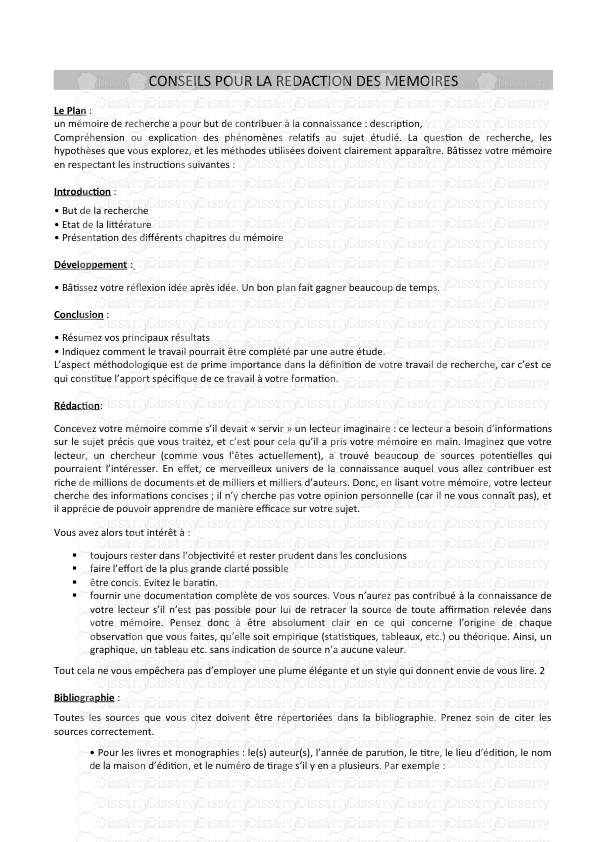







-
44
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 19, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2339MB


