Cet article a été publié sur le site http://www.info-metaphore.com Il a d’abord
Cet article a été publié sur le site http://www.info-metaphore.com Il a d’abord été publié in : SEMEN, n°15, Figures du discours et ambiguïtés.2001-2, coordination Marc Bonhomme; Annales Littéraires de l'Université de Franche-Comté, 30-32 rue Mégevand 25030 Besançon Cedex Ronald LANDHEER Université de Leiden (Pays-Bas) LA MÉTAPHORE, UNE QUESTION DE VIE OU DE MORT? 1. Introduction: métaphore et ambiguïté Est-ce qu’il y a une relation essentielle entre la métaphore et l’ambiguïté? Voilà la principale question à laquelle nous tâcherons de donner une réponse dans ce travail. Et du même coup nous nous proposons de remettre en cause a) la définition à notre sens un peu trop restrictive de l’ambiguïté donnée par Catherine Fuchs (1996) et b) la pertinence de la distinction traditionnelle entre métaphore vive et métaphore morte. 1.1. L’ambiguïté Essayons d’abord de préciser la notion très complexe de l’ambiguïté. Si on entend par là la propriété d’un segment de langue de recevoir plus d’une interprétation, il convient de faire toute une série de précisions. Pour commencer, il faut faire une distinction fondamentale entre l’ambiguïté virtuelle et l’ambiguïté actuelle. Les faits de polysémie et d’homonymie relèvent de l’ambiguïte virtuelle, phénomène inhérent à l’économie langagière et qui fait que toute notion ne reçoit pas nécessairement une expression distincte. Il s’agit d’une plurivalence sur le plan de la langue, indépendamment de son emploi dans le discours. En voici (sous 1) quelques exemples, de trois niveaux différents: a. lexical, b. syntagmatique et c. phrastique: (1) a. cuisinière; perdre; cours; avocat; bière; vol. b. l’enseignement de l’histoire; un professeur de droit allemand. c. il attend la nuit; je l’ai quitté joyeux. Souvent une telle ambiguïté virtuelle sera désambiguïsée discursivement, comme dans (2) a-c: (2) a. Notre cuisinière est enrhumée. b. L’enseignement de l’histoire de cette faculté a une renommée mondiale. c. Je l’ai quitté joyeux et je le suis resté toute la journée. Mais si l’effet du contexte sur l’ambiguïté de départ (présentée ici en italique) est nul, l’ambiguïté virtuelle peut devenir une ambiguïté effective ou actuelle, une ambiguïté donc qui se présente au niveau du discours. Dans ce cas-là, c’est l’énoncé entier qui est ambigu, comme dans (3) a-c : (3) a. Nous avons une excellente cuisinière. b. A mon avis, l’enseignement de l’histoire est très utile. c. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que Sophie préfère attendre la nuit. Et si même un contexte plus large ne filtre pas la plurivalence de départ, l’ambiguïté actuelle (et entièrement contextualisée) qui subsiste présente encore deux possibilités: elle peut être volontaire ou non : 1 Cet article a été publié sur le site http://www.info-metaphore.com Il a d’abord été publié in : SEMEN, n°15, Figures du discours et ambiguïtés.2001-2, coordination Marc Bonhomme; Annales Littéraires de l'Université de Franche-Comté, 30-32 rue Mégevand 25030 Besançon Cedex - Ainsi, il se peut fort bien que l’émetteur de (3) b. veuille dire «le fait qu’on enseigne l’histoire» (= génitif objectif) et qu’il n’ait pas prévu que son énoncé serait compris comme «ce que l’histoire nous enseigne» (= génitif subjectif). Alors, on a affaire à une ambiguïté non intentionnelle ou involontaire, i.e. un malentendu. - La seconde possibilité est que la plurivalence de départ soit pour ainsi dire exploitée par l’émetteur et dans ce cas-là, il s’agit d’une ambiguïté intentionnelle, comme en (4): (4) Voilà le premier vol de l’aigle… (cf. Landheer, 1984: 123-124) célèbre boutade prononcée à propos de la confiscation des biens de la maison d’Orléans par Napoléon III, nommé «l’aigle», et où l’ambiguïté du mot vol (voir (1) a.) et même du syntagme entier vol de l’aigle est manifestement voulue. Dans ce qui suit, nous nous occuperons surtout de cette dernière forme d’ambiguïté: l’ambiguïté actuelle et intentionnelle (en discutant aussi la reconnaissabilité de ce caractère intentionnel). Contrairement à Catherine Fuchs (1996: 13), qui parle seulement d’ambiguïté s’il est question d’une «alternative entre plusieurs significations mutuellement exclusives associées à une même forme», nous considérons aussi comme ambigus des énoncés qui présentent un cumul de deux ou plusieurs significations, comme dans (4), dont la lecture visée demande l’actualisation simultanée de deux sens différents des mots vol et aigle. Nous proposons ainsi de faire une distinction entre l’ambiguïté sélective (où il faut effectivement faire un choix entre deux ou plusieurs lectures incompatibles: i.e. l’ambiguïté au sens strict de Fuchs; il est alors question d’une bifurcation de sens) et l’ambiguïté cumulative (où il est question d’un dédoublement de sens: deux ou plusieurs sens s’imposent à la fois). Mais il y a encore un troisième type d’ambiguïté, que nous appellerons allusive, et dont le slogan publicitaire cité sous (5) est un exemple: (5) Elles vous aiment encore mieux quand elles ne peuvent plus vous sentir (cité par Catherine Kerbrat-Orecchioni, 2001: 156) Comme le note Kerbrat-Orecchioni à propos de (5) «seul le sens olfactif est dénotativement acceptable: le sens affectif (lié au syntagme “ne pas pouvoir sentir quelqu’un”) est incompatible avec le cotexte (il introduirait dans l’énoncé … une contradiction interne); s’il vient automatiquement à l’esprit, c’est sur un mode purement connotatif». Kerbrat-Orecchioni parle dans ces sortes de cas d’un «double sens avec hiérarchie». Pour notre part, nous les appelons donc allusivement ambigus: il y a une lecture dominante, intellectuellement ‘correcte’, et une autre lecture qui ne s’ajoute qu’allusivement. N.B. D’une façon générale, on peut dire que l’ambiguïté sélective se présente comme non- intentionnelle, à l’opposé de l’ambiguïté cumulative et de l’ambiguïté allusive qui sont normalement intentionnelles. 1.2. La métaphore Quant à la métaphore, il est d’usage de distinguer entre la métaphore vive et la métaphore morte. Mais dans quelle mesure s’agit-il là d’une distinction pertinente? 2 Cet article a été publié sur le site http://www.info-metaphore.com Il a d’abord été publié in : SEMEN, n°15, Figures du discours et ambiguïtés.2001-2, coordination Marc Bonhomme; Annales Littéraires de l'Université de Franche-Comté, 30-32 rue Mégevand 25030 Besançon Cedex - Tout d’abord: qu’est-ce qu’on entend exactement par une métaphore morte? Dans son Traité de stylistique française (193 ssqq), Charles Bally donne comme exemple de ce qu’il appelle une «image morte» la phrase Vous courez un grand danger, et il la commente ainsi: «il n’y a plus ni image ni sentiment d’image, sinon au point de vue historique; nous sommes dans l’abstraction pure». Et en effet, le plus souvent on parle d’une métaphore morte quand il s’agit du sens figuré d’un mot polysémique (courir dans l’exemple de Bally) et que ce sens figuré s’est complètement lexicalisé et détaché du sens dit «propre». On constate alors que ce sens figuré a beau être dérivé d’un sens propre, avec lequel il entretient en principe un rapport de ressemblance ou d’analogie, mais ce lien de ressemblance s’est tellement affaibli qu’il ne joue plus ou plus guère un rôle actif ni au niveau cognitif ni au niveau pragmatique ou discursif. Mais bien sûr, une telle définition de la métaphore morte pose problème: ainsi le mot bouchon dans le sens de «bouchon (dans la circulation)» est complètement lexicalisé, une figure éteinte donc, si l’on veut, mais s’agit-il là d’une image morte? Comparons à titre de curiosité les deux exemples suivants: (6a) Sur l’autoroute entre Paris et Lyon il y a souvent des bouchons. (6b) Sur l’autoroute entre Pouilly et Macon: attention aux bouchons! (cf. Landheer, 1984: 92) Objectivement parlant, on dirait que (6a) et (6b) véhiculent la même information : on a affaire aux mêmes bouchons (à savoir de la circulation trop dense sur certaines tranches de l’autoroute). Mais si le rapport de ce sens métaphorique du mot bouchon avec son sens propre reste purement virtuel dans (6a), il en va autrement dans (6b), où il y a un indice qui évoque ce lien d’une façon tout à fait évidente: la cooccurrence des toponymes Pouilly et Macon, deux villes réputées pour leurs vins. Dans (6b), on a affaire à une ambiguïté allusive (l’encombrement de l’autoroute comportant la lecture dominante, les bouchons de bouteille la lecture allusive, avec éventuellement – en fonction du co(n)texte plus large – un renvoi aux automobilistes ayant trop bu…), grâce au dégel d’une métaphore qui avait l’air d’être morte. Il est évident d’ailleurs que la complicité du contexte et notre connaissance du monde sont des facteurs essentiels pour une interprétation adéquate des cas comme (6b) ou (4). Donc, suivant la définition de Bally, une métaphore morte est une figure complètement lexicalisée, dénuée de sa motivation primitive, et dont le sens appartient à un mot polysémique, comme c’est le cas de courir et d’autres exemples comme ceux nommés en (7) : (7) feu (‘amour’), âne (‘personne stupide’), plat (‘trivial’), éclat (de rire). Cela veut dire que les polysèmes courir, feu, âne, plat et éclat contiennent une ambiguïté virtuelle, tout comme les exemples cités sous (1) a. Une fois intégrés dans des énoncés, ils peuvent donc être désambiguïsés ou non, comme tous les mots polysémiques (cf. (2) a., resp. (3) a.). Seulement, comme nous venons de voir dans (6b) et comme nous allons encore voir par la suite, il est souvent très difficile de constater si la motivation de leur sens figuré («l’image») ait effectivement disparu (c.q. soit «morte») dans l’esprit uploads/Litterature/ landheer-la-metaphore-une-question-de-vie-ou-de-mort.pdf
Documents similaires





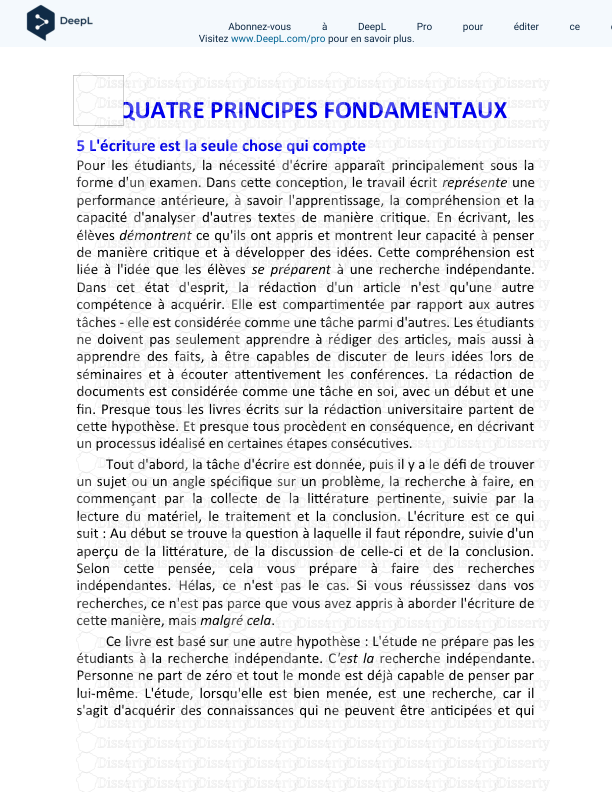




-
76
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 06, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0913MB


