Revue d’égyptologie 63, 1-20. doi∞∞: 10.2143/RE.63.0.2957944 Tous droits réserv
Revue d’égyptologie 63, 1-20. doi∞∞: 10.2143/RE.63.0.2957944 Tous droits réservés © Revue d’égyptologie, 2012. LE DIALOGUE DE KHÂKHEPERRÊSENEB AVEC SON BA TABLETTE BRITISH MUSEUM EA 5645/OSTRACON CAIRE JE 50249 + PAPYRI AMHERST III & BERLIN 3024 PAR CHRISTOPHE BARBOTIN Musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes – PARIS Deux œuvres occupent une place à part au sein de la littérature égyptienne du Moyen Empire∞∞: la «∞∞collection de mots∞∞» de Khâkheperrêseneb, relativement peu abordée dans la recherche égyptologique1, et le fameux Dialogue d’un homme avec son ba, qui a suscité un nombre d’articles et de livres infiniment supérieur à la première2. Elles se signalent par leur forme, un monologue de fait dans le cadre d’un dialogue implicite pour l’une, un dialogue actif impliquant un interlocuteur d’un nouveau genre, le ba, pour l’autre. Elles sont en outre dépourvues du moindre élément de contexte, ce qui porte leur contenu à un niveau d’abstraction inhabituel en littérature égyptienne. Car elles se signalent encore et surtout par leur fond∞∞: expression d’un mal-être irréductible à aucun mot connu d’un côté, interro- gations sur les idées traditionnelles de la vie et de la mort de l’autre. La date des deux textes Ils ont été composés au Moyen Empire. Bien que la tablette du British Museum, pour Khâkheperrêseneb, soit une copie du début de la XVIIIe dynastie3, le nom même de l’au- teur de la «∞∞collection de mots∞∞» situe à Sésostris II la date la plus ancienne possible. Elle le place en tout état de cause à une époque qui ne peut être postérieure à l’existence d’un 1 Sur ce texte, voir en dernier lieu St. Quirke, Egyptian Literature 1800 BC, questions and readings, 2004, p. 173- 175∞∞; W.K. Simpson, dans W.K. Simpson (éd.), The Literature of Ancient Egypt. An Anthology of Stories, Instructions, Stelae, Autobiographies and Poetry, 2003, p. 211-213∞∞; R.B. Parkinson, «∞∞The Text of Khakheperreseneb∞∞: New readings of EA 5645, and an Unpublished Ostracon*∞∞», JEA 83 (1997), p. 55-68 et pl. X-XII∞∞; id., «∞∞Khakheperreseneb and Traditional Belles Lettres∞∞», dans P. Der Manuelian (éd.), Studies in Honor of William Kelly Simpson, II, 1996, p. 647- 654 et P. Vernus, «∞∞L’intuition de Khâkheperrêseneb∞∞», dans id., Essai sur la conscience de l’Histoire dans l’Égypte pharaonique, 1995, p. 1-33. 2 Objet d’une toute récente monographie par J.P. Allen, The Debate between a Man and His Soul. A Masterpiece of Ancient Egyptian Literature, 2011, avec l’historiographie complète de l’œuvre et la variété des titres qui lui ont été donnés (p. 1-3) ainsi qu’une bibliographie exhaustive (p. 245-249). 3 EA 5645. Elle aurait fait partie, selon Parkinson, de la troisième collection Salt et proviendrait de Thèbes (JEA 83 [1997], p. 60, n. 5). L’ostracon Caire JE 50249, qui proviendrait de Dahchour (R.B. Parkinson – R.J. Demarée, «∞∞The Text of Khakheperresenb: an addendum∞∞» JEA 93 [2007], p. 270), date également du début de la XVIIIe dynastie. 2 CHR. BARBOTIN RdE 63 (2012) culte de ce roi, donc entre Sésostris II et la XIIIe dynastie. Vernus4, suivi par Parkinson, penche pour la fin de la XIIe ou la XIIIe dynastie d’après l’emploi non-extensif de la construction sujet + Ìr + infinitif de verbe intransitif, qui pointe statistiquement cette période. Mais l’argument ne porte que sur le seul verbe Ìpr, en deux occurrences seule- ment. Ceci en relativise beaucoup la valeur comme critère de datation, d’autant plus que ces deux cas sont chacun suivis d’une proposition pseudo-verbale qui en complète l’as- pect5. Au contraire, l’emploi extensif de ladite construction apparaît à deux reprises dans le texte avec des verbes intransitifs6, et une fois avec le verbe transitif írí7. Elle est en outre bien distincte de la tournure sujet + s∂m.f à valeur aoriste que l’on rencontre à trois reprises en contexte négatif8. On ne peut donc exclure que le traitement particulier de Ìpr observé chez Khâkheperrêseneb ne tienne au sujet même du texte qui soupèse ce verbe sous tous ses aspects9. À l’inverse, l’expression de la filiation par antéposition honori- fique plaide pour une date plus ancienne, en tout cas antérieure à la XIIIe dynastie10. Le désarroi du copiste de la XVIIIe dynastie devant cet archaïsme paraît à cet égard fort significatif11. Le papyrus de Berlin 3024 et les quatre fragments du papyrus Amherst III12 qui lui cor- respondent, pour le Dialogue, datent quant à eux du règne d’Aménemhat III13. Mais le texte a été recopié sur un original préexistant d’après les erreurs et omissions du copiste qu’on y relève14, et surtout d’après l’énoncé du colophon qui est sans ambiguïté là-des- sus15. Il semble remonter à la première moitié de la XIIe dynastie d’après ce même critère 4 P. Vernus, Le surnom au Moyen Empire, 1986, no 183, p. 42∞∞; id., Future at Issue. Tense, Mood and Aspect in Middle Egyptian∞∞: Studies in Syntax and Semantics, 1990, p. 188∞∞; id., Essai, p. 3. 5 Îprw Ìr Ìpr / nn mí snf (ro10) «∞∞des événements surviennent, qui n’avaient pas d’équivalent l’année précédente∞∞» et nhpw Ìr Ìpr r¨ nb / Ìr tnbÌ r Ìprt (ro 12) «∞∞ceux qui se lamentent surviennent chaque jour, en train de trembler à propos de ce qui survient∞∞». Dans ce dernier cas, la proposition enchâssée tire sa valeur extensive de son rapport à la première propo- sition qui en est à la fois le sujet et le substrat aspectuel. 6 Änk pw Ìr nky m Ìprt (ro 10) et … Ìr tnbÌ Ìr Ìprt (cf. n. 5). 7 Bw nb twt(w) / Ìr írt st (vo 2). 8 Nn mdt ntt k.s ∂d.s (ro 5), nn ¨rÈ ss.f (vo 3) et nn ∂nwd dí.f r (vo 4). Cf. infra, n. 76. 9 On note ainsi l’emploi de sÌpr en inaccompli non-extensif∞∞: Ìsf Ìn Ìr sÌpr rÈw (vo 5) «∞∞repousser les expressions fait survenir l’opposition∞∞», et bien entendu les jeux sur les participes substantivés de Ìpr (ro 10, ro 12 et vo 1). 10 G. Lefebvre, Grammaire de l’égyptien classique (BdE 12), 1955, §59, p. 41∞∞: «∞∞jusqu’à la XIIe dyn. (mais pas plus tard)∞∞». Cf. aussi M. Malaise – J. Winand, Grammaire raisonnée de l’égyptien classique (AegLeod 6), 1999, § 49, p. 47 («∞∞jusqu’à la 12e dynastie »). Ceci est parfaitement compatible avec l’usage de la locution ∂dw n.f, introductive du surnom dès le milieu de la XIIe dynastie (P. Vernus, Le surnom, p. 83-84). 11 Puisqu’il a ajouté un déterminatif au nom du père, contrairement à l’usage correct. 12 Aujourd’hui conservés à la Pierpont Morgan Library de New York et identifiés par R.B. Parkinson, «∞∞The Missing Beginning of the “Dialogue of a Man and His Ba”∞∞: P. Amherst III and the History of the “Berlin Library”∞∞», ZÄS 130 (2003), p. 120-133. L’ensemble provient de la région thébaine, peut-être d’une tombe de l’Assassif. 13 R.B. Parkinson, Reading Ancient Egyptian Poetry. Among other Histories, 2009, p. 76. 14 J.P. Allen, loc. cit., p. 9. 15 Äw.f pw Ìt.f r pÌwy.fy mí gmyt m ss (col. 154-155) «∞∞c’est ainsi qu’il vient, depuis le début jusqu’à la fin, conformé- ment à ce qui a été trouvé dans les écrits∞∞» (cf. J.P. Allen, Debate, p. 112). LE DIALOGUE DE KHÂKHEPERRÊSENEB AVEC SON BA 3 RdE 63 (2012) syntaxique évoqué plus haut auquel le grand nombre d’occurrences donne cette fois un poids statistique indéniable16. Les deux œuvres sont donc grammaticalement compatibles, rien ne s’oppose à ce qu’elles soient contemporaines. La forme de Khâkheperrêseneb La tablette du British Museum sépare le texte en quatre alinéas copiés en deux sessions d’écriture, comme le suggère la présence d’une date inscrite en rouge entre les deuxième et troisième alinéas17 («∞∞le deuxième mois de chémou, le vingt-huitième jour »), chacun d’entre eux correspondant à un paragraphe d’après le sens. Ce découpage a d’ailleurs été adopté par certains traducteurs18, tandis que d’autres ont préféré n’en pas tenir compte19. Le texte est parsemé de points rouges correspondant à des unités de sens avec quelques notables erreurs et omissions du copiste du Nouvel Empire20. L’ostracon, en revanche, ne porte aucune trace de ponctuation21. Comme le rappelle Parkinson22, la plupart des égyptologues s’accordent à reconnaître que les «∞∞mots∞∞» de Khâkheperrêseneb ne se suffisent pas à eux-mêmes mais représentent au contraire le début d’un développement aujourd’hui perdu23. C’est d’ailleurs ce qu’il suggérait lui-même en 1996 lorsqu’il évoquait la possibilité que les «∞∞mots∞∞» constituent le prologue d’un discours24. Mais en dernier lieu, il semble revenir sur cette opinion au motif que l’ostracon du Caire ne donne pas de section nouvelle du texte, et d’autre part que la longueur de la composition selon la tablette de Londres correspond à celle de l’enseigne- ment d’Aménemhat Ier, soit un gabarit plausible pour l’époque25. 16 J.P. Allen, loc. cit., p. 9 et p. 118-121. 17 R.B. Parkinson, JEA 83 (1997), p. 63, n. 19. 18 M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature. A Book of Readings, I, 1973, p. 145-149∞∞; St. Quirke, Egyptian Literature, p. 173-175. De même, P. Vernus suit le découpage des deux premiers paragraphes qu’il réunit en un «∞∞exorde∞∞» (Essai, p. 4). 19 E. Bresciani ne crée qu’un seul alinéa, à la fin de ro 13 (Letteratura e poesia dell’antico Egitto, 1969, p. uploads/Litterature/ le-dialogue-de-khakheperreseneb-avec-son-ba-la-date-des-deux-textes 1 .pdf
Documents similaires








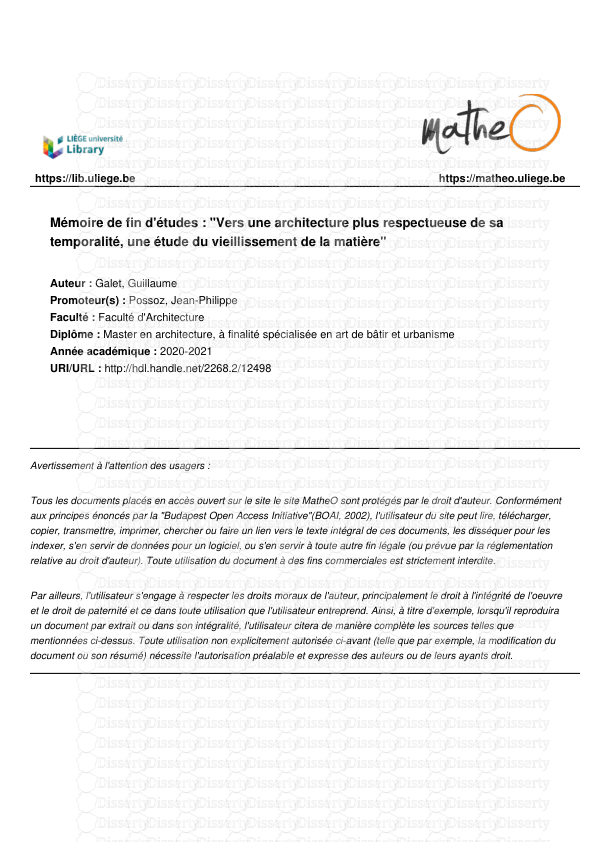

-
48
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 29, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2364MB


