« Les Dames galantes » au fil des mots Guárdate de las caídas, principalmente
« Les Dames galantes » au fil des mots Guárdate de las caídas, principalmente de espaldas ; que suelen ser peligrosas en las principales damas. À bon vin ne faut point d’enseigne. Pierre de Bourdeille [v.1540-1614], abbé commendataire (c’est donc un laïc) et seigneur de Brantôme, après une carrière de militaire et de courtisan, fait une chute de cheval (en 1584), se retrouve « perclus et estropié » pendant deux ans et consacre pour l’essentiel à l’écriture les vingt années qui suivent. Ceux qui apprécient cet écrivain, contemporain de Montaigne [1533-1592] et si différent de lui, ne s’en tiennent pas aux Dames galantes (le titre n’est pas de l’auteur) mais c’est l’ouvrage qui — peut-être pour de mauvaises raisons — a assuré sa survie littéraire. Aux questions que je me posais à la lecture du texte, j’ai le plus souvent trouvé des réponses ; chacun y fera sa moisson à sa guise. Je me suis, en toute lucidité, attelé à une tâche sans fin, mais à cela nul souci : je publierai les livraisons par intermittence. Aucun contrat, aucune promesse, aucun engagement ne me lie et je goûte mon indépendance comme je chéris ma liberté. La matière sur laquelle je travaille étant le langage, aucun vocabulaire n’est, à mes yeux, choquant, à la différence de lusage qui en est fait ; mais la réprobation ne doit pas aller aux mots. Voltaire ayant vitupéré contre cul-de-sac (« Comment a-t-on pu donner le nom de cul-de-sac à l’angiportus des Romains ? »), Diderot, dans Jacques le fataliste, l’égratigne : « …Je me suis fourré dans un [sic] impasse, à la Voltaire, ou, vulgairement dans un cul-de-sac, d’où je ne sais comment sortir… » Éditions consultées : Louis-Jean-Nicolas Monmerqué, 1822 Jean Alexandre C. Buchon, 1838-1839 Garnier, 1848 Henri Vigneau, 1857 Ludovic Lalanne, 1876 Henri Bouchot, 1882 Prosper Mérimée et Louis Lacour de La Pijardière, 1891 et 1894 Maurice Rat, 1947 [texte de base] Pascal Pia, 1981 Étienne Vaucheret, 1991 Dans les notes et commentaires, la toile d’araignée signale une redite intentionnelle. Vogue la gallée ! 001 À MONSEIGNEUR MONSEIGNEUR LE DUC D’ALENÇON, DE BRABANT, ET COMTE DE FLANDRES, FILS ET FRÈRE DE NOS ROIS. onseigneur, d’autant que1 vous m’avez fait cet honneur2 souvent à la cour3 de causer4 avec moy fort5 privement6 de plusieurs7 bons mots et contes8, qui vous sont si familiers9 et assidus10 qu’on diroit qu’ils vous naissent à veuë d’œil11 dans la bouche, tant vous avez l’esprit grand, prompt et subtil, et le dire12 de mesme13 et trés-beau, je me suis mis à composer14 ces discours15 tels quels16, et au mieux que17 j’ay peu, afin que, si aucuns18 y en a qui vous plaisent, vous fassent autant19 passer le temps et vous ressouvenir de moy parmy20 vos causeries21, desquelles22 m’avez hon- noré autant que gentilhomme de la cour23. Le dédicataire est François d’Anjou [1554-1584], dernier fils de Henri II et de Catherine de Médicis. Selon Antoine Adam, la dédicace aurait été rédigée entre 1582 et le 10 juin 1584, date de la mort du duc. 1 « comme, étant donné que, vu que » 2 cet honneur de : « cet honneur, (à savoir) de » → l’honneur de 3 (à Amboise) 4 l’emploi de causer au sens de « bavarder » était récent [à l’époque, le mot n’a rien de familier] ; voir, plus bas, causeries 5 intensif, emploi adverbial ancien de l’adjectif ( j’en doute fort) 6 « en particulier, à part » Voici des adverbes en -ment présents dans l’œuvre de Brantôme et dignes d’attention, à des titres divers, pour les lecteurs du XXIe siècle : affettement « avec coquetterie » assiduellement « continuellement » bigarrément compassément « dignement » condignement « à proportion » continemment « avec continence » désordonnément « dans le dérèglement des mœurs » déterminément dispostement « lestement, avec souplesse » divulguement « communément » fatament « fatalement, d’une manière prédestinée » gorgiasement « magnifiquement » hardiëment on trouve de même vrayëment impertinemment « déraisonnablement, mal à propos » impollument « sans tache, sans souillure » inadvertamment « étourdiment » infamement inviolamment « inviolablement » loyaument luctueusement « avec grand deuil » nesciemment « par ignorance » outrecuydément M salaudement scalabreusement « dangereusement » signalément « remarquablement » tellement quellement « comme ci, comme ça », Ni fort bien ni fort mal, mais plutôt mal que bien, explique Littré volontierement 7 « nombreux » 8 « anecdotes, histoires » (le mot anecdote n’était pas encore entré dans la langue) 9 « habituels, coutumiers » 10 « continuels ». Dans son VIIe Discours, Brantôme décrit Marguerite de Valois effon- drée lorsqu’elle apprend la mort d’Yzabel d’Austrie (Isabelle d’Autriche, femme de Charles IX) : « elle en garda, vingt jours durant, le lict, l’entretenant de pleurs et de gemissemens assi- dus. » C’est un latinisme : au rapport de Suétone, Alexandria capta nihil sibi præter unum murrinum calicem ex instrumento regio retinuerit et mox uasa aurea assiduissimi usus confla- uerit omnia « une fois qu’Alexandrie fut tombée, (Auguste) ne se réserva du trésor royal qu’un vase murrhin et ne tarda pas à faire fondre tous les récipients en or d’usage cou- rant ». 11 à veue d’œil : ‹eu› note /y/ (voir juste après au mieux que j’ai peu) ; l’expression était récente (1re attestation : 1562) et équivaut à « en un clin d’œil » 12 « l’art de raconter, le talent de conteur » ; infinitif substantivé (quelques vestiges : le boire et le manger, le savoir, le rire, le bien-être…) 13 « pareil, semblable, comparable » ; deux exemples tirés de l’Avare : « un lit de quatre pieds, à bandes de points de Hongrie, appliquées fort proprement sur un drap de couleur d’olive, avec six chaises et la courte-pointe de même » — « Elle a raison: à sot compliment il faut une réponse de même. » 14 « rédiger » 15 « récits » — Antoine Adam : « exposés » 16 « sans art » : l’auteur se défend de toute prétention littéraire. Cf. tellement quelle- ment à la note 6. — É. Vaucheret : « aussi mauvais que bons, sans grande valeur » 17 au mieux que (+ pouvoir) a précédé du mieux que 18 si aucuns y en a : « s’il y en a certains » 19 autant passer le temps et : « ‹ils› vous fassent à la fois passer le temps et » ; efface- ment fréquent du pronom personnel sujet 20 « au milieu de » 21 « au milieu de vos entretiens/conversations » 22 « dont » ; honnoré, écho d’honneur du début de paragraphe 23 sur le modèle de autant qu’homme du monde ; cour au début et en fin de paragraphe. Gentilhomme conserve le sens initial de gentil « noble » Je vous en dedie donc, Monseigneur, ce livre, et vous supplie le fortifier de vostre nom et autorité24, en attendant que je me mette sur25 les discours serieux. Et en voyez un à part, que j’ay quasi26 achevé, où je deduis27 la comparaison de six grands princes et capitaines qui voguent28 aujourd’huy en ceste chrestienté, qui sont29 : le roy Henri III vostre frere, Vostre Altesse, le roy de Navarre vostre beau-frere, M. de Guise, M. du Maine, et M. le Prince de Parme, alleguant30 de tous vous autres31 vos plus belles valeurs32, suffisances33, merites et beaux faits, sur lesquels j’en remets la conclusion à ceux qui la sçauront mieux faire que moy. Cependant, Monseigneur, je supplie Dieu vous augmenter tousjours en vostre grandeur, prosperité et altesse34, de laquelle je suis pour jamais, Vostre trés-humble et trés-obeissant subjet, et trés-affectionné serviteur. BOURDEILLE. 24 « réputation et prestige » premier pléonasme lexical ou redoublement synonymique, cf. sûr et certain, sain et sauf, seul et unique, nul et non avenu, contraint et forcé… 25 « que j’aborde » 26 emprunt direct au latin depuis la fin du Xe siècle ; quasiment (qui doit être un cas unique en son genre) n’est pas attesté avant 1505 27 « j’expose » — Antoine Adam : « je traite de » ; la comparaison de six grands princes et capitaines : l’inspiration vient de Plutarque à travers la traduction d’Amyot 28 « sont célèbres/renommés » : Brantôme (IVe Discours) parle d’une Française, vivant à Ferrare, qui « craignoit qu’il ne luy mésadvint, parce qu’elle sentoit fort de Luther, qui voguoit pour lors, pria mon frere de l’emmener avec luy en France, et en la cour de la reine de Navarre » 29 Henri III [1551-1589] ; François d’Anjou ; le futur Henri IV [1553-1610] ; Henri de Lorraine [1550-1588] (le mot pseudo-historique attribué à Henri III : « Mon Dieu, qu’il est grand ! Il est encore plus grand mort que vivant ! » ne se trouve ni dans les Mémoires-Journaux de Pierre de L’Estoile — où c’est une interpolation d’éditeurs —, ni dans la relation de Marc Miron [† 1608], médecin de Charles IX et d’Henri III) ; Charles de uploads/Litterature/ les-dames-galantes-au-fil-des-mots-001.pdf
Documents similaires





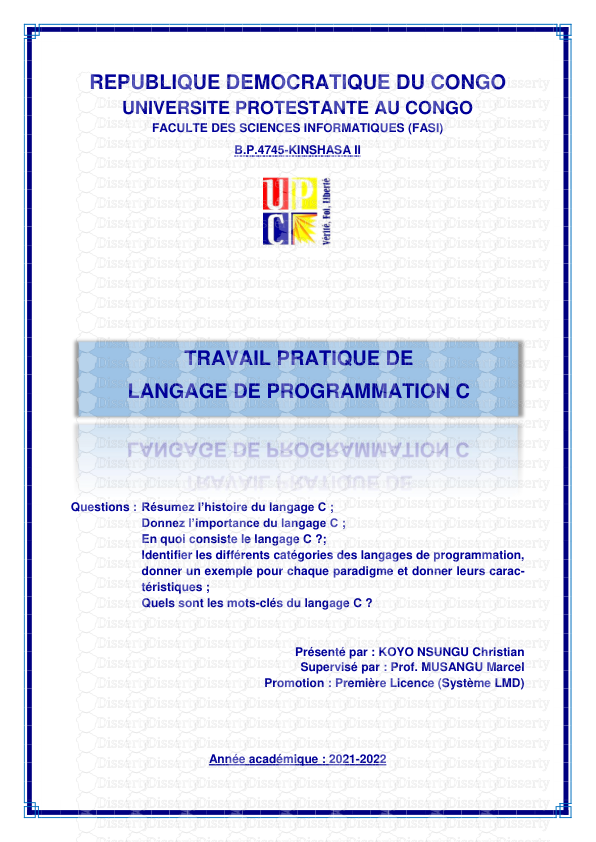




-
76
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 27, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 2.0699MB


