Jules Romains de l'Académie française PSYCHÉ Lucienne Le dieu des corps Quand l
Jules Romains de l'Académie française PSYCHÉ Lucienne Le dieu des corps Quand le navire... augmenté d'une introduction par Olivier Rony (Les scanneurs) Gallimard Jules Romains est né en 1885 à Saint-Julien-Chapteuil, dans le Velay. Il passe toute son enfance et sa jeunesse à Paris, où son père était instituteur. Normalien, agrégé de philosophie et licencié en sciences naturelles, il débute dans la littérature par la poésie, conçoit l'idée de l'« unanimisme » et en écrit le poème essentiel : La Vie unanime, en 1908. L'unanimisme est une manière de penser qui substitue un sentiment cosmique à l'égocentrisme romantique. Ses romans Mort de quelqu'un (1911) et Les Copains (1913) sont l'illustration de cette doctrine. Après la guerre, Jules Romains poursuit sa carrière littéraire et théâtrale. Ses pièces sont devenues des classiques et se jouent partout : M. Le Trouhadec saisi par la débauche (1923), Knock ou Le Triomphe de la médecine (1923), Le Dictateur (1926), Donogoo (1930), etc. Psyché (1922-1929) est une suite de trois romans sur l'amour conjugal. Dans le premier, Lucienne, l'auteur des Copains à qui ses lectrices reprochaient de n'écrire que pour les hommes, s'adresse aux femmes dans un langage qu'elles reconnaissent, non pour l'avoir déjà entendu, mais parce qu'il est la voix la plus secrète de leur cœur. Les deux autres volumes de cette trilogie s'intitulent Le dieu des corps et Quand le navire... En 1932, Jules Romains entreprend la publication d'un grand roman en vingt-sept volumes, qu'il termine en 1944 : Les Hommes de bonne volonté, vaste fresque de la société française pendant un quart de siècle. Ennemi du totalitarisme, il avait prévu les dangers de l'hitlérisme et il doit quitter la France en 1940. Il vit aux États-Unis puis au Mexique et rentre en France en 1946. Il est élu à l'Académie française la même année. Jules Romains est mort en août 1972. PRÉFACE (ajoutée par les scanneurs) JULES ROMAINS, ROMANCIER DU REGARD SUBJECTIF Olivier RONY Société des Amis de Jules Romains Dans cette préface je vise à éclairer la nature du regard subjectif, c’est-a- dire le récit à la première personne, qui y est mis en œuvre par le romancier. En même temps, j’aimerais m'interroger quelque peu sur la structure de la trilogie, les modalités du récit n’étant pas étrangères, à mon avis, aux conditions dans lesquelles elle a été écrite et à la matière de la fable. Ici, permettez-moi de citer quelques lignes d'une lettre de Jules Romains publiée dans la revue Europe, le 15 décembre 1928, a la suite de l'article de René Maublanc consacré au Dieu des corps : L'idée de l'ensemble du livre remonte a cette période de 1907-1911, où j'ai conçu la plupart des sujets, des grands thèmes que j'ai essayé de traiter dans les vingt années qui ont suivi, sans m'imposer d‘ailleurs aucun ordre dans l'exécution des œuvres successives. [...] L'idée dont je parle s‘est présentée a moi en même temps que celle de Mort de quelqu’un. [...] Bref, je commençai par Mort de quelqu'un. [..] Quand je me décidai, vers 1920, le souvenir même de mes anciennes méditations, le précédent de Mort de quelqu'un, me firent croire d'abord que la chose se réglerait en un seul gros volume [Europe, 15 décembre 1928, pp. 575-578]. Psyché, sous une forme que nous ne connaissons pas (et dont rien ne subsiste dans les dossiers de Jules Romains), devait donc être « bouclée » en un seul roman, comme Mort de quelqu'un. Or, la matière a proliféré et Lucienne a formé un tome indépendant et se suffisant à lui-même. Les circonstances ont fait que c’est seulement en 1928 qu'il a pu entreprendre ce qu'il considérait comme étant la suite de ses aventures. Or, six ans, cela compte, et ce laps de temps, ainsi que ce qui a pu se passer pendant cette période, ont très bien pu avoir une influence sur la matière même du récit et sur sa forme. Si l'on revient maintenant à l’approche purement formelle de ce procédé de narration dans l'œuvre romanesque de Jules Romains, on constate que les récits à la première personne forment environ un cinquième de cette production, ce qui n’est pas négligeable, et compte non tenu des tomes des Hommes de bonne volonté, dont deux épisodes au moins, la Douceur de la vie, et le Tapis magique, contiennent de substantiels morceaux de journal d'un des principaux personnages, Jallez. Que l'on cherche à dégager les raisons pour lesquelles le romancier paraît préférer ce mode de narration au mode classique de récit à la troisième personne (ou selon Gérard Genette, de récit hétéro-diégétique), et il est clair que la première personne est utilisée lorsque le caractère autobiographique prime sur tout le reste, chaque fois en somme que le romancier entend s'effacer du texte au profit du « moi » de son personnage : Lucienne, Pierre Febvre, Jallez, Jean-Pierre Jerphanion, les narrateurs anonymes des deux nouvelles de Violation de frontières, Marthe Chauverel « la femme singulière » et enfin les clients du café de l'Ambassade dans le Vin blanc de la Villette. Cet effacement du romancier est presque toujours exigé par le degré de vraisemblance très élevé qu'il est nécessaire d'attribuer à ce qui est raconté. Tout se passe alors comme si le lecteur devait avoir, plus que jamais, l'impression que les faits ont vraiment eu lieu, objectivement si l'on peut dire. Ceci est évident dans le cas des deux derniers tomes de Psyché et dans celui de Violation de frontières. En outre, ces récits à la première personne ont presque tous pour narrateurs des héros qui prétendent avoir un témoignage spécial à délivrer, témoignage sur ce qu’ils considèrent avoir été un moment exceptionnel, rare, de leur vie. Tous les degrés de ces confidences existent : depuis Jallez, installé à Nice en 1919 et qui décide de tenir un journal, parce qu'il veut sauver de l'oubli la « douceur » d'une vie quotidienne délicieuse au sortir de la guerre, jusqu’à Pierre Febvre et aux narrateurs de Violation de frontières, qui entendent fixer par écrit les faits étranges dont ils ont été les acteurs ou les témoins. C'est la valeur du témoignage qui importe, comme si ce témoignage ne pouvait être mieux délivré que par celui qui a été là. Le romancier disparaît pour ne pas s’interposer entre le héros et le lecteur. Il y a transfert. Et la subjectivité de ce narrateur tend, d'une certaine manière, à nous installer dans un rapport objectif par rapport à ce qui est raconté, puisque l’auteur (celui qui pourrait arranger, mentir, choisir à la place du personnage), disparaît au profit de celui qui a vu, vécu. Il existe donc, entre le romancier et le lecteur, la conclusion d’un pacte autobiographique tacite, qui garantit la prétendue authenticité de l'histoire. Si l’on veut, le récit à la première personne apporte des gages au réalisme. Et l’ininventable du vécu est porté à son apogée par l'emploi du pronom personnel je, dans un récit autodiégétique, où selon Gérard Genette héros et narrateur se confondent au nom de la véracité. Psyché offre la conjonction parfaite des deux critères que je viens de préciser (je sais qu'il y aurait sans doute d’autres critères discriminants, mais je me limite volontairement, dans le cadre de cet exposé, à ces deux- là) : le récit d'événements exceptionnels (perçus comme tels par le héros en tout cas) et qui aux yeux mêmes de l’auteur ont une valeur intrinsèque telle qu’ils doivent être sauvés de l'oubli. Le « moi » du héros doit donc être capable à la fois de définir en quoi la matière des faits lui est devenue précieuse et en quoi ces faits supposent qu'on les transmette à autrui (ou qu'on les expose à soi-même) afin de les rendre objectivement acceptables. Les tomes II et III présentent un exemple intéressant de ce type de récit : le vécu, c'est ce que Pierre Febvre raconte, et la part objective est représentée par les notes et les réflexions qu'il distribue à l'intérieur même de son récit et en cours de rédaction, recréant par là une sorte d’auteur qui contrôle, juge, rectifie, amende et nuance son approche subjective des faits. On retrouverait ici les deux instances narratives proposées par Léo Spitzer et reprises par Gérard Genette dans Figures III [Le Seuil 1972] : le « je narrant » et le « je narré ». Jules Romains les utilise avec une extrême virtuosité à l'intérieur de son roman et ce, bien entendu, avec la volonté de faire prendre son affabulation pour un document authentique. Mais Psyché s'ouvre par un premier volet qui, lui aussi, est un récit à la première personne. Pourtant, ce tome ne présente pas les mêmes modalités. Lucienne, le Dieu des corps et Quand le navire... contiennent non seulement deux narrations dont les voix sont tour à tour féminine et masculine, mais deux ensembles de faits qui diffèrent assez sensiblement par le ton et l'atmosphère, en dépit de la fragile apparence de continuité et d'homogénéité. Regardons d'un peu plus près ce premier volet de Psyché. Lui aussi, il obéit, uploads/Litterature/ psyche-by-jules-romains-pdf.pdf
Documents similaires









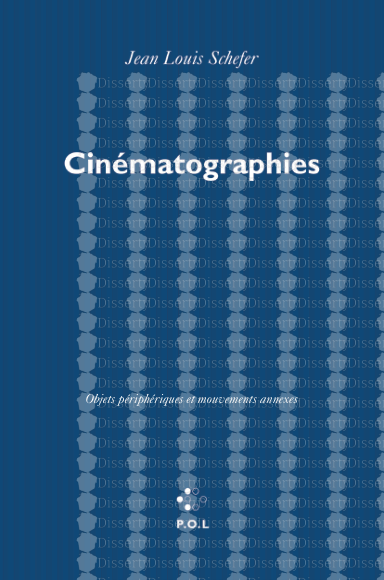
-
92
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 07, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 2.0079MB


