Auteur : Raphaël Authier Karen GLOY, Die Philosophie des deutschen Idealismus.
Auteur : Raphaël Authier Karen GLOY, Die Philosophie des deutschen Idealismus. Eine Einführung, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2021, 138 p. S’ajoutant aux nombreux travaux de philosophie et d’histoire de la philosophie publiés par Karen Gloy, cet ouvrage propose une introduction à l’idéalisme allemand, vraisemblablement – même si rien ne le précise – à l’usage d’étudiants de premier cycle. Il y est question à la fois de ce qu’est l’idéalisme allemand en général et des thèses défendues par ses principales figures. La première moitié de l’ouvrage tente ainsi de délimiter chronologiquement l’idéalisme allemand, propose de le comprendre comme une « philosophie moniste » (ch. 2), animée par une exigence de rationalisation et d’explication systématique, et s’attache à en comprendre les « racines » (ch. 3). Ces dernières sont identifiées d’une part à la philosophie grecque, et d’autre part à la philosophie kantienne. Bien qu’elle soit un peu trop centrée, relativement au premier point, sur les présocratiques (curieusement, Platon et Aristote ne sont évoqués que très rapidement), l’analyse est convaincante et efcace. Quatre chapitres consacrés à Kant restituent avec finesse des points de débat importants, et soulignent combien les idéalistes se sont compris comme des continuateurs de l’œuvre de Kant. La deuxième moitié de l’ouvrage présente quelques positions philosophiques majeures de l’idéalisme, celles de Reinhold, de Fichte, de Schelling et de Hegel. D’autres figures (Jacobi et Hölderlin) font l’objet de considérations plus ponctuelles. La construction d’un tel propos découle d’une conviction philosophique afrmée fermement dans le deuxième chapitre : l’étude de l’idéalisme allemand ne répond pas seulement à un besoin érudit, celui d’une compréhension plus exacte de l’histoire de la philosophie, mais aussi à un intérêt qualifié de sachlich-systematisch (p. 16), qui fait de ces textes un point d’appui essentiel pour la formulation contemporaine des questions philosophiques (une confrontation avec d’autres modes de questionnement étant esquissée p. 14-15). Par sa clarté et sa netteté, l’ouvrage accomplit efectivement sa tâche introductive et didactique. Cela étant dit, la perspective méthodologique d’ensemble et le principe de la sélection des auteurs et des textes traités auraient mérité d’être explicités. Difcile de comprendre, par exemple, pourquoi Hegel n’est étudié qu’à partir de la Science de la logique et de la Philosophie de l’histoire, ce qui ne va pas sans difcultés. D’une façon un peu similaire, Schelling est quasi uniquement abordé à partir de sa correspondance avec Fichte et de quelques textes de philosophie de la nature : il n’est pas évident de voir quel principe justifie la mise à l’écart des textes de la période médiane et de la dernière philosophie. Mais il est vrai qu’un examen de ces derniers aurait pu entrer en tension avec l’insistance de l’autrice sur l’idée d’une « philosophie moniste » (p. 16 et passim) – le sens exact de cette expression pourrait d’ailleurs être davantage précisé. Au fond, les aspects traités dans cet ouvrage sont les motifs classiques, ceux qui ont le plus retenu les lecteurs dans la réception de long terme des textes idéalistes (d’où les deux axes que sont la logique et l’histoire pour le cas de Hegel, par exemple). Et il en va d’ailleurs de même des analyses consacrées à Kant : les thèmes qui sont abordés, après un rapide résumé de la Critique de la raison pure (la théorie de la conscience de soi, la théorie de la chose en soi, la théorie de la totalité) sont ceux qui ont été traditionnellement associés au postkantisme. Du reste, la périodisation de l’idéalisme que propose Karen Gloy reste extrêmement classique, et ne fait (voir p. 7) que reprendre à grands traits le schéma de Richard Kroner (Von Kant bis Hegel). De ce fait, la lecture de cet ouvrage conduit ses lecteurs à se poser une question de méthode : faut-il concevoir une introduction à l’idéalisme allemand comme l’exposé des motifs que l’on a traditionnellement retenus de ce corpus depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, ou faut-il considérer qu’introduire à un corpus suppose d’y faire entrer le lecteur directement, en mettant entre parenthèses le filtrage thématique résultant des diférentes lectures qui en ont été faites depuis ? Raphaël AUTHIER (Sorbonne Université) Retrouver ce compte rendu et l’ensemble du Bulletin de littérature hégélienne XXXII chez notre partenaire Cairn ! ! ! ! ! ! ! "##$%&' '"!(%)$% ! ! *+,,"&(%* *-".+//%( (%#0%(#0%( ! ! .$''%1&/* 2$.'&%( Raphaël Authier ARCHIVES DE PHILOSOPHIE.pdf Saved to Dropbox • 6 Mar 2023 at 05:24 Pour citer cet article : Karen GLOY, Die Philosophie des deutschen Idealismus. Eine Einführung, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2021, 138 p., in Bulletin de littérature hégélienne XXXII, Archives de philosophie, tome 85/4, Octobre-Décembre 2022, p. 167-204. ♦♦♦ Jacques MARTIN, L’individu chez Hegel, éd. Jean-Baptiste Vuillerod, préface d’Étienne Balibar, Lyon, ENS Éditions, 2020, 178 p. Le travail d’édition réalisé par Jean-Baptiste Vuillerod sur le mémoire de fin d’études supérieures de Jacques Martin intitulé L’Individu chez Hegel mérite d’être salué. De l’introduction rédigée par l’éditeur du texte, on lira en particulier avec grand profit les pages 24 à 32, concernant le concept de problématique, l’idée d’un transcendantal historique dans le contexte de la philosophie française de la seconde moitié du XXe siècle et la diférence entre la perspective de Martin et celle d’Althusser. Précisons surtout que ce mémoire soutenu sous la direction de Gaston Bachelard en 1947, longtemps resté inédit, est bien plus ambitieux que son titre ne le suggère : Jacques Martin y esquisse une interprétation d’ensemble de Hegel orientée « par référence » (p. 41) à la critique de Hegel par Marx, c’est-à-dire « vers l’efort de Marx pour définir ce que l’on pourrait appeler un individualisme concret » (p. 84). Le chapitre II, consacré aux textes de jeunesse et en particulier à L’Esprit du christianisme et son destin, porte sur le statut de l’individu, mais la réflexion menée par l’auteur est bien plus vaste, aussi bien relativement à la méthode par laquelle nous interprétons les textes de Hegel (introduction et chapitre I,) que relativement au sens de l’idéalisme hégélien (chapitre III). Que cet ouvrage voie bien au-delà de la notion d’individu, l’auteur le dit d’ailleurs explicitement : « le problème philosophique de l’individu saisi dans Hegel nous ofre une occasion d’individualiser le problème de la philosophie », c’est-à-dire d’examiner « l’émergence toujours incertaine chez Hegel de l’essence de la philosophie elle-même » (p. 42). Les lecteurs et les commentateurs de Hegel y trouveront ample matière à réflexion. Un point nous semble symptomatique. La méthode de lecture déployée par l’auteur le conduit à souligner ce qu’une vision du « système hégélien comme le développement d’une intuition qui suft à lui conférer son sens » (p. 56) aurait de réducteur. Il renvoie ainsi dos à dos l’idée selon laquelle l’« “intuition” du penseur […] “cause” le sens du système », et l’idée selon laquelle « elle le fonde » (p. 63). Cette perspective l’amène à repérer quelque chose comme une « aliénation radicale de l’individu dans l’univers hégélien » (p. 85). Une difculté significative se pose néanmoins : car tout en remettant en question le rôle interprétatif de cette « intuition », tout en expliquant que les textes de Hegel ont une richesse qui n’est pas épuisée par cette intuition, Jacques Martin continue d’afrmer qu’il y a bien quelque chose comme une « intuition hégélienne » (qu’il rapproche d’ailleurs parfois d’une « intuition mystique », p. 58 et p. 77-78). C’est celle-ci que J. Martin tente de caractériser dans les pages 69 à 76, tout à fait décisives pour l’hypothèse interprétative qu’il met en place. Mais est-on sûr du point de départ, c’est-à-dire de l’intuition originelle ici prêtée à Hegel ? Ne faudrait-il pas plutôt remettre en cause la réductibilité de la pensée hégélienne à une « intuition » (de quelque ordre qu’elle soit), et même admettre que le modèle bergsonien d’une « intuition fondamentale » ne s’applique qu’assez mal à Hegel ? Le geste paradoxal accompli par l’auteur, qui consiste en même temps à faire jouer à cette intuition un rôle pour le penseur et à refuser qu’elle contraigne notre lecture, est sans doute le signe d’une difculté que beaucoup de lecteurs de Hegel, en particulier à l’époque de l’auteur du mémoire, ont éprouvée, parce qu’ils se voulaient hégéliens sans vouloir l’être à la manière de Hegel lui- même. Sur le plan de l’érudition, on regrettera que l’éditeur, dans son introduction pourtant très riche, attribue à l’auteur de L’Individu chez Hegel la paternité des traductions du Misse Sine Nomine d’Ernst Wiechert, du Jeu des perles de verre de Hermann Hesse en même temps que celle de L’Esprit du christianisme et son destin de Hegel (p. 15). S’il est exact que le Jacques Martin, dont le texte vient d’être édité, fut aussi le traducteur de Hegel, c’est un autre Jacques Martin qui fut le traducteur de Wiechert et de Hesse. Il y eut, on le sait, d’innombrables Jacques Martin, parmi lesquels au moins deux sont en efet susceptibles de nous intéresser : le philosophe donc, né à Paris en 1922, élève de Jean Hyppolite en khâgne (comme Foucault), condisciple d’Althusser à uploads/Litterature/ raphael-authier-archives-de-philosophie.pdf
Documents similaires

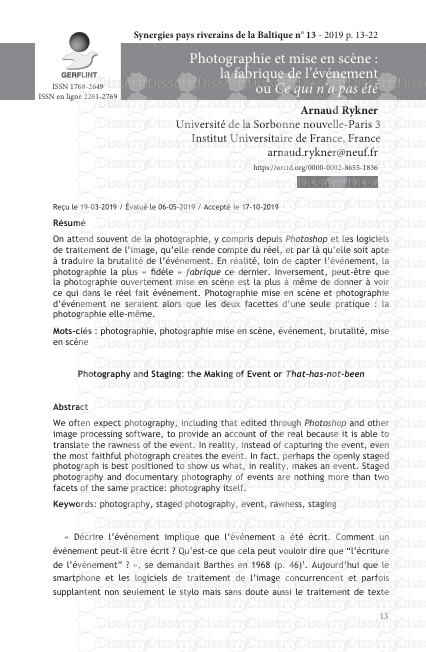








-
41
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 01, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3984MB


