Vers la Grèce antique. De la nostalgie au deuil par Paul Ricœur NOVEMBRE 2013 #
Vers la Grèce antique. De la nostalgie au deuil par Paul Ricœur NOVEMBRE 2013 #Grèce Reprenant les catégories nietzschéennes d’histoire monumentale, antiquaire et critique, Paul Ricœur analyse la manière dont l’histoire répond à une « demande du présent », demande qui peut se traduire par la nostalgie ou l’oubli. Deux options que Ricœur refuse, plaidant pour un travail de deuil qui ravive les questions contemporaines sur le passé. Du classique à l’archaïque Pour les philosophes, la Méditerranée – la première Méditerranée réfléchie et pensée –, c’est évidemment la Grèce antique, une Grèce qui incluait encore la Sicile, mère de la rhétorique, et la face maritime de l’Asie Mineure avant les guerres médiques. De quels « idéals » les philosophes, éduqués par Kant, le penseur du Nord, sont-ils redevables à cette Grèce philosophante ? La question est à la fois inéluctable et sans réponse assignable. Inéluctable, en ce sens que, dans la mémoire philosophique, la Grèce est tout simplement inoubliable. Mais que faisons-nous de cette mémoire accablante ? Pour m’orienter dans cette question embarrassante, je suivrai le fil offert par Nietzsche dans son fameux essai : « De l’utilité et les inconvénients de l’histoire pour la vie2 ». Dans cette Considération dite inactuelle (ou intempestive), l’auteur fait la distinction entre histoire monumentale, histoire antiquaire et histoire critique. Cette distinction est suscitée par une révolte contre une culture livrée à la fascination que le passé exerce sur le présent à travers l’historiographie elle-même. Ce qui est intempestif dans cette considération, c’est précisément ce suspens d’un rapport pervers au passé, suspens que provoque le déplacement du champ du savoir (Wissen) à celui de la vie (Leben). Les mots « utilité » et « inconvénient » (Nutzen, Nachteil) marquent dans le titre la transvaluation du rapport à l’histoire issue de cette interruption. Cela dit, qu’en est-il de la distinction entre ces trois histoires, et comment s’applique-t-elle de façon exemplaire à notre rapport à la Grèce antique ? Disons d’abord qu’il ne s’agit ni de trois stades qui seraient apparus successivement au cours de l’histoire et qu’il faudrait à leur tour soumettre au jugement critique, ni de trois attitudes mutuellement exclusives entre lesquelles il faudrait choisir. Il s’agit bien plutôt d’une typologie, désignant des modalités de rapport avec le passé, entre lesquelles nous ne cessons d’osciller, allant et revenant de l’une à l’autre. L’histoire monumentale relève de la culture savante ; comme la dénomination choisie le suggère, elle enseigne et avertit par l’insistance d’un regard obstinément rétrospectif qui interrompt toute action dans le souffle retenu de la réflexion. Nietzsche en parle sans sarcasme : sans une vue d’ensemble prise sur la chaîne continue des événements, aucune idée de l’homme ne se formerait. La grandeur ne se révèle que dans le monumental ; l’histoire lui élève le mausolée de la renommée, qui n’est autre que « la croyance à la cohésion et à la continuité de la grandeur à travers tous les temps ; c’est une protestation contre la fuite des générations et contre la précarité de tout ce qui existe3 » [221] (227). Il n’est pas difficile d’appliquer cette description au rapport le plus fondamental que nous entretenons avec le monde grec. C’est le rapport à la Grèce en tant que « classique ». Entendons par « classique », avec Gadamer4, la sorte d’exterritorialité dont jouissent les grandes œuvres, dont le sens excède les conditions concrètes de production, et qui ainsi s’élèvent tellement au-dessus de leur temps qu’elles ne souffrent pas de la perte de leur contexte, mais restent capables d’une série indéfinie de recontextualisations qui n’altèrent pas fondamentalement leur identité sémantique. Cette élévation au-dessus du temps a bénéficié plusieurs fois à la Grèce classique, de Socrate aux stoïciens et aux épicuriens, à travers Platon et Aristote. Ainsi la Grèce classique a-t-elle été revécue et repensée plusieurs fois à l’identique – du moins le croyait-on – à l’époque du néoplatonisme païen et du néoplatonisme chrétien, du temps de l’aristotélisme arabe, juif et chrétien, à l’ère de la Renaissance italienne et européenne et, nous allons y revenir plus longuement dans la suite, jusqu’à l’aube de l’idéalisme allemand. Ces répétitions sont certes très différentes les unes des autres. Et surtout les contemporains n’ont cessé de se tromper sur l’identité du platonisme, de l’aristotélisme, du stoïcisme. Les génies de la Renaissance eux-mêmes ne savent pas distinguer, dans ce qu’ils inventent, entre ce qu’ils trouvent et ce qu’ils créent. Mais cet aveuglement est précisément constitutif de l’histoire monumentale. Après le cri d’éloge de Nietzsche : « Si la grandeur a été possible une fois, elle sera sans doute possible à l’avenir » – cri de ralliement de tout retour aux Grecs, du moins à la Grèce classique –, vient l’exclamation : « Et cependant… » (Und doch) : le vice secret de l’histoire monumentale, c’est de « tromper à force d’analogie », à force d’égaliser les différences ; évaporée, la disparité ; ne restent que des « effets en soi », à jamais imitables, ceux que les grands anniversaires commémorent. Dans cet effacement des singularités, « le passé lui- même souffre dommage » [223] (133). Dans un langage peut-être différent de celui de Nietzsche, je dirai que l’histoire monumentale ignore la sorte de rapport entre écriture et lecture qui la constitue et qui fait que les textes – les monuments aussi, au sens large, comme le rappelle encore une fois l’expression « histoire monumentale » – ne survivent qu’à travers une chaîne de réinterprétations, et à la faveur d’attentes nouvelles, de questions nouvelles, auxquelles il est demandé aux pensées du passé de répondre dans les termes du passé. C’est ce qui n’a cessé d’arriver à Platon et Aristote, qu’ils soient relus, le premier par Plotin, par Origène ou par Augustin, le second par Averroès, Maïmonide ou Thomas d’Aquin. On ne reprochera pas à ces penseurs d’avoir inventé – au double sens qu’on vient de dire – ce qu’ils tenaient pour être le platonisme ou l’aristotélisme. La condition historique de la pensée fait qu’il n’est sans doute pas d’invention absolue hors d’un rapport dialectique entre innovation et tradition, et surtout que ce rapport n’est pas naturellement transparent à lui-même. Comment la Renaissance se connaîtrait-elle à la fois comme naissance et comme répétition ? La reprise – la Wiederholung – ne se connaît pas elle-même. C’est peut-être ce secret de la reprise que l’histoire antiquaire voudrait percer, en mettant entre le passé et nous, la distance de la vénération. Or la vénération s’adresse à autre chose que la grandeur, la hauteur architecturale, la puissance tectonique des grands accomplissements et des grandes œuvres ; elle se porte vers quelque chose de plus intime, à savoir l’attache de l’arbre à ses racines. De la vénération pour les racines résulte la devise de la préservation, qui est la devise même de l’histoire antiquaire. Préserver les racines, dit- elle. La devise justifie un durable compagnonnage et met en garde contre les séductions de la vie cosmopolite, toujours éprise de nouveauté. Pour elle, avoir des racines n’est pas un accident arbitraire, c’est tirer croissance du passé, en s’en faisant l’héritier, la fleur et le fruit. Appliqué à notre rapport à la Grèce, ce rapport de vénération-préservation a pris particulièrement vigueur lorsque l’attention non seulement des historiens des idées, mais des philosophes les plus créateurs, s’est déplacée en amont de la Grèce dite classique vers la Grèce archaïque ; pour le dire vite, lorsque le regard scrutateur est remonté de Socrate aux présocratiques. Le rapport à Parménide, Héraclite, Anaximandre, Xénophane, a toujours été très différent du rapport à Socrate, Platon et Aristote. Ce dernier est largement resté un rapport à ce qui enseigne et avertit, selon la suggestion de l’expression : histoire monumentale. Ce rapport est devenu de préservation-vénération, selon le sens que Nietzsche lui assigne par le terme d’histoire antiquaire. Ce rapport au passé doit être soigneusement distingué du rapport archéologique, bien qu’il le prolonge en un sens. Il le prolonge en ce sens que seule la reconstruction et l’édition critique des fragments des Présocratiques a permis la sorte plus subtile de rapport qui triomphe avec Heidegger dans ses écrits sur Parménide et Héraclite5. L’expression même de « Présocratiques » est éloquente : elle désigne beaucoup plus que la conquête d’une antériorité temporelle, à savoir la conquête d’un passé plus passé que celui de l’âge classique, d’un passé qui n’est rejoint qu’à travers l’ébranlement, voire la destitution, de l’idée même de classique. On a caractérisé plus haut celle-ci par la permanence d’un modèle susceptible d’une suite indéfinie de décontextualisations et de recontextualisations. Or le rapport à la Grèce archaïque n’est plus le rapport à quelque instance transhistorique, mais à l’immémorial profond. La Grèce n’est pas la seule à avoir été touchée par la quête du Ur – de l’originaire et de l’originel. Mais elle est devenue un des lieux privilégiés de ce rapport à un hors-temps qui, à la différence du classique, n’a pas laissé des monuments auxquels nous voudrions nous égaler, mais seulement des traces que l’on n’a jamais fini de déchiffrer. Si l’on considère, uploads/Litterature/ vers-la-grece-antique.pdf
Documents similaires









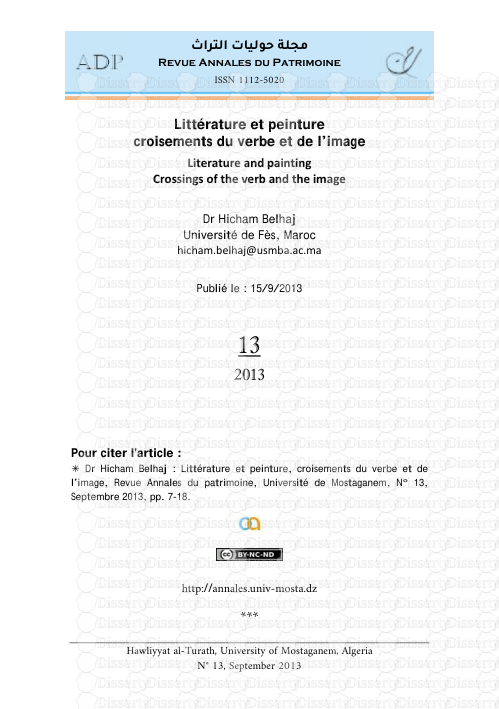
-
104
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 04, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1894MB


