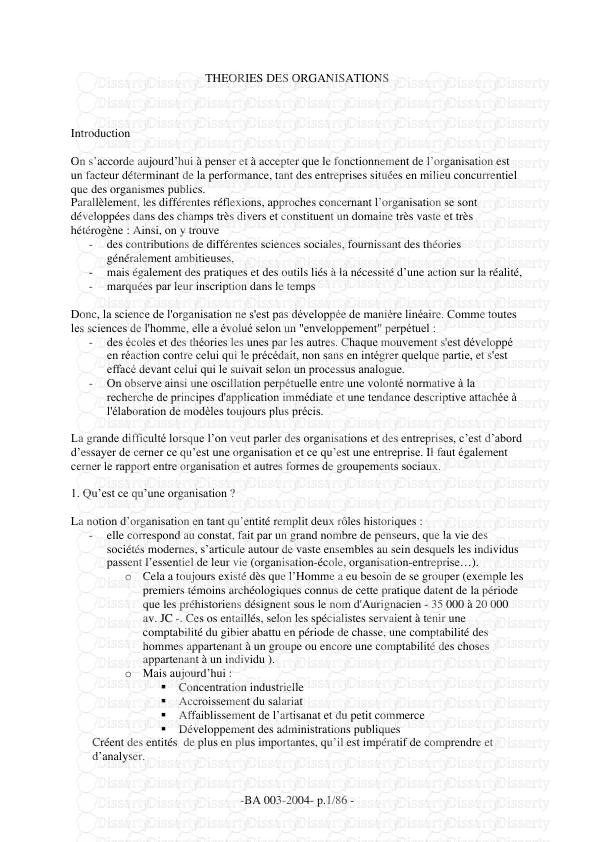-BA 003-2004- p.1/86 - THEORIES DES ORGANISATIONS Introduction On s’accorde auj
-BA 003-2004- p.1/86 - THEORIES DES ORGANISATIONS Introduction On s’accorde aujourd’hui à penser et à accepter que le fonctionnement de l’organisation est un facteur déterminant de la performance, tant des entreprises situées en milieu concurrentiel que des organismes publics. Parallèlement, les différentes réflexions, approches concernant l’organisation se sont développées dans des champs très divers et constituent un domaine très vaste et très hétérogène : Ainsi, on y trouve - des contributions de différentes sciences sociales, fournissant des théories généralement ambitieuses, - mais également des pratiques et des outils liés à la nécessité d’une action sur la réalité, - marquées par leur inscription dans le temps Donc, la science de l'organisation ne s'est pas développée de manière linéaire. Comme toutes les sciences de l'homme, elle a évolué selon un "enveloppement" perpétuel : - des écoles et des théories les unes par les autres. Chaque mouvement s'est développé en réaction contre celui qui le précédait, non sans en intégrer quelque partie, et s'est effacé devant celui qui le suivait selon un processus analogue. - On observe ainsi une oscillation perpétuelle entre une volonté normative à la recherche de principes d'application immédiate et une tendance descriptive attachée à l'élaboration de modèles toujours plus précis. La grande difficulté lorsque l’on veut parler des organisations et des entreprises, c’est d’abord d’essayer de cerner ce qu’est une organisation et ce qu’est une entreprise. Il faut également cerner le rapport entre organisation et autres formes de groupements sociaux. 1. Qu’est ce qu’une organisation ? La notion d’organisation en tant qu’entité remplit deux rôles historiques : - elle correspond au constat, fait par un grand nombre de penseurs, que la vie des sociétés modernes, s’articule autour de vaste ensembles au sein desquels les individus passent l’essentiel de leur vie (organisation-école, organisation-entreprise…). o Cela a toujours existé dès que l’Homme a eu besoin de se grouper (exemple les premiers témoins archéologiques connus de cette pratique datent de la période que les préhistoriens désignent sous le nom d'Aurignacien - 35 000 à 20 000 av. JC -. Ces os entaillés, selon les spécialistes servaient à tenir une comptabilité du gibier abattu en période de chasse, une comptabilité des hommes appartenant à un groupe ou encore une comptabilité des choses appartenant à un individu ). o Mais aujourd’hui : Concentration industrielle Accroissement du salariat Affaiblissement de l’artisanat et du petit commerce Développement des administrations publiques Créent des entités de plus en plus importantes, qu’il est impératif de comprendre et d’analyser. -BA 003-2004- p.2/86 - - elle correspond également au postulat que toutes ces entités pourraient bien avoir des caractéristiques communes et êtres vues comme ayant à résoudre des problèmes voisins, quels que soient leurs objectifs spécifiques. La difficulté de cerner la notion d’organisation vient (pour l’essentiel) de son triple sens : - Dans un premier sens, les organisations désignent des groupements humains qui coordonnent leurs activités pour atteindre les buts qu'ils se donnent, ceux-ci étant dirigés vers un environnement. L'organisation apparaît donc comme une tentative de réponse au problème de l'action collective, à la nécessité de participation à la tâche commune des individus qui la composent. Cette définition met l'accent sur l'aspect dynamique de l'organisation assurant les conditions de stabilité relative pour qu'une action collective puisse se développer sur une durée suffisamment longue. Bien évidemment, il y a autant de formes spécifiques d'organisations que d'objectifs justifiant l'action collective o Elles sont de nature économique (entreprises), sociale (syndicats), politique (partis), religieuse (églises), écologique (Green Peace), caritatives (Secours Populaire) ou humanitaire (Médecins du Monde) etc... o La nature des enjeux constitue même un facteur essentiel de différenciation, comme on le voit par exemple entre les entreprises traditionnelles (organisations à intérêts commerciaux privés) et établissements de type hospitalier ou universitaire (organisations à intérêts publics sans but lucratif). À ce titre, les organisations peuvent être de nature économique (entreprises), sociale (syndicats), politique (partis), éducative (universités), religieuse (églises), écologique (Green Peace), caritatives (Secours Populaire) ou humanitaire (Médecins du Monde) o Leur diversité tient aussi au degré de complexité (selon la taille, la technologie, le contexte d'action) ou de la façon dont les hommes sont impliquées dans l'action commune : plutôt par les contraintes (prisons, asiles), par espérance de "gain" (entreprises) ou par conviction idéologique (syndicats, associations). - Dans un second sens, elles caractérisent les diverses façons par lesquelles ces groupements agencent ou structurent les moyens dont ils disposent pour parvenir à leurs fins. Ces modes organisationnels sont appliqués à des ensembles concrets (atelier, réseau commercial, service après-vente) ou à des fonctions génériques (information, travail). Ce sont des instruments de rationalisation, permettant d'optimiser la gestion des ressources, la division des tâches, la répartition des pouvoirs, les règles de fonctionnement, etc. - Dans un troisième sens, on utilise le terme d'organisation pour décrire l'action d'organiser, c'est-à-dire le processus qui engendre les groupements ou les structurations décrits plus haut. 2. Organisation et autres formes de groupements sociaux Des définitions – ou tentatives – qui précèdent, montrent la difficulté de positionner l’organisation au sein d’autres formes de groupements sociaux : la famille par exemple, un gang, un marché.. Dans la recherche d’une classification des formes de relations sociales, il est possible de prendre trois critères (Kadushin 1966) - Le degré d’intensité de l’interaction entre les individus qui y participent -BA 003-2004- p.3/86 - - Le degré d’institutionnalisation de ces relations (cad de reconnaissance et de stabilisation) - Le degré de formalisme du leadership qui y est exercé Densité de l’interaction Élevée Degré d’institutionnalisation Degré de formalisation du leadership Interaction indirecte Interaction directe Modérée ou nulle Informel Le groupe social La foule La « société» Nul ou modéré Formel Une association volontaire Un gang Informel Une communauté, un marché Le voisinage, un marché Élevé Formel Une organisation Une organisation, la famille L’État nation L’organisation y est dès lors vue comme une forme de relations sociales : - à interaction élevée, indirecte et directe (il y a ou non une hierarchie intermédiaire) - à fort degré d’instutionnalisation (il y a des statuts, il y a des règles) - et ou est présent un leadership formel (il y a des chefs même si ce leadership n’est pas le seul à influer sur le comportement des membres). 3. Qu’est ce que l’entreprise ? La vie économique est aujourd'hui organisée autour des entreprises qui donnent à la civilisation occidentale plusieurs de ses caractères essentiels : urbanisation, rythme de vie, cadre immédiat de l'activité professionnelle de millions de salariés sont autant de conséquences directes de la montée en puissance de cette catégorie de la vie économique et sociale. Cette valorisation de l'entreprise au premier plan des préoccupations tant individuelles que sociales est pourtant un phénomène relativement récent. Tirant son origine de l'ébranlement de l'ordre médiéval et corporatif fondé sur un système économique d'échanges indissociable de l'enchevêtrement des relations sociales, l'entreprise est un fait d'histoire inscrit dans les développements récents de notre civilisation. D'ailleurs, le mot entreprise n'est apparu dans la langue française qu'en 1699 pour caractériser une opération de commerce, et c'est seulement à la fin du XVIIIème siècle, en 1798, peu de temps après la publication posthume de l'Essai sur la nature du commerce en général de Cantillon et la promulgation du décret Allarde et de la Loi Chapelier, qu'il est utilisé dans le sens de manufacture (apparue dans sa forme "moderne" avec la révolution industrielle) pour décrire une organisation de biens de production de biens ou de services à caractère commercial. Parallèlement, dans sa brève histoire, l'image globale de l'entreprise a connu de profonds revirements en résonance avec un contexte culturel qui lui a été plus ou moins favorable selon les époques. -BA 003-2004- p.4/86 - Hier, terrain privilégié de la lutte des classes, dénigrée comme lieu d'aliénation, d'oppression et d'exploitation, aujourd'hui, laboratoire d'une nouvelle forme de consensus politique et social, espace d'épanouissement et de réalisation personnels, l'entreprise postmoderne est devenue, dans les années 80, l'objet de tous les désirs, le cœur de cible d'une société en mal d'idéalismes. Incontestablement, la décennie 80 restera celle de l'entreprise, symbole du goût du risque et de l'action, envahissant l'imaginaire et le peuple des métaphores excessives. Bien plus : la logique productive et marchande, les méthodes managériales, l'esprit d'entreprise ont été érigés en modèle de référence au point d'envahir très largement le service public qui ne répond plus aux exigences du modèle bureaucratique wébérien. Son action a partout été, et de tous côtés, remise au centre de l'attention. Se voulant aux antipodes d'un passé qu'on déclare définitivement révolu, l'entreprise moderne est devenu une communauté éthique ; elle s'affirme comme le pôle d'excellence dans tous les domaines, proclame haut et fort sa mission sociale et culturelle en prétendant parfois réconcilier, en une vaste synthèse harmonieuse, l'économique, le social et le culturel. Si la place de l'entreprise dans la vie économique est aujourd'hui largement reconnue, cela ne signifie pas pour autant que sa définition fasse l'objet de consensus. L’entreprise est l'une de ces notions du sens commun pour lesquelles il est toujours malaisé de préciser clairement le contenu. Au-delà des difficultés liées à la superposition uploads/Management/cours 2 .pdf
Documents similaires










-
52
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 22, 2022
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 0.6000MB