ALAIN PONS De la «nature commune des nations au Peuple romantique. Note sur Vic
ALAIN PONS De la «nature commune des nations au Peuple romantique. Note sur Vico et Michelet. Pour ceux qui recherchent les principes inspirateurs de Michelet, comme pour ceux qui étudient Vico, sa « fortune > et son influence, la rencontre de l'historien français avec le philosophe napolitain constitue une sorte de passage obligé, aussi inévitable qu'embarrassant. Est-il besoin de souligner l'insistance avec laquelle Michelet a toujours reconnu sa dette envers celui qu'il appelle affectueusement son « vieux Vico » ? Son œuvre s'ouvre, en 1827, par Les Principes de la philosophie de ťhistoire, traduits de la Scienza nuova et précédés ďun discours sur le système et la vie de Vauteur1. Quarante-deux ans plus tard, dans la Préface de 1869 à son Histoire de France, il affirme encore : « Je n'eus de maître que Vico. » On pourrait multiplier les citations : < Mon Vico, mon Juillet, mon principe héroïque. > — « Dès 1824, la fureur de Vico, une incroyable ivresse de son grand principe historique », etc. *. En quoi consiste donc cette paternité spirituelle que Michelet attribue à Vico, et quel est ce « grand principe héroïque > ? Et cette filiation est-elle bien légitime ? En d'autres termes comment Michelet a-t-il compris Vico, et Га-t-il même compris ? Il est impossible d'échapper à ces questions, et c'est là que rembarras commence. Cet embarras des « micheletistes » tient d'abord, pourquoi ne pas le dire, aux difficultés qu'ils ont d'avoir accès à l'œuvre de Vico qu'ils ne connaissent, la plupart du temps, que par la traduction et l'interprétation de Michelet lui-même. Ceux qui veulent échapper au cercle vicieux se heurtent à la pauvreté de la bibliographie vichienne en langue française et, s'ils s'attaquent au texte original, latin et italien, ils risquent d'être rebutés par les aspérités de la langue et de la pensée, et déconcertés par la variété discordante des commentaires auxquels se livrent les spécialistes. Aussi, bien souvent, se contentent-ils de quelques allusions vagues à la théorie des corsi et ricorsi par exemple, qui est loin de représenter l'aspect le plus intéressant de la philosophie vichienne. En admettant que ces difficultés préjudicielles soient surmontées, la confrontation 1. En 1835, il publie des Œuvres choisies de Vico, dans lesquelles il ajoute à son travail de 1827 la traduction de la Vie de Vico par lui-même, de plusieurs lettres et extraits divers, et du De antiquissima Italorum sapientia. 2. Sur les rapports de Michelet avec Vico, voir en particulier G. Lanson, « La formation de la méthode de Michelet », in Revue ďhistoire moderne et contemporaine, 1005-1906, t. VIL — G. Monod, « Michelet et l'Italie », in Jules Michelet, études sur sa vie et ses. œuvres, avec des fragments inédits, Paris, 1905. — Du même, La Vie et la pensée de Jules Michelet, 2 vol., Paris, 1923. — B. Donati, Nuovi studi sulla filosofa civile di G.B. Vico, Firenze, 1936. — ОЛ. Haac, Les Principes inspirateurs de Michelet, Paris et New Haven, 1951. — J.-L. Cornuz, Jules Michelet, un aspect de la pensée religieuse au XIXe siècle, Genève et Lille, 1955. — P. Viallaneix, La Voie royale, essai sur Vidée de peuple dans l'œuvre de Michelet, Paris, 1959. — G. Fasso, « Un presunto discepolo di Vico : Giulio Michelet », in Omaggio a Vico, Napoli, 1968. 40 Alain Pons Vico-Michelet a bien des chances de provoquer une déception qui peut s'énoncer ainsi : « En définitive, Michelet doit-il à Vico autant qu'il le proclame ? » Le Discours qui précède la traduction de 1827 est une analyse, objective et encore timidement respectueuse. La figure de Vico qui s'en dégage est avant tout celle d'un «précurseur», et même du précurseur par excellence de la science historique moderne. La Préface de l'Histoire romaine (1831) souligne cet aspect: «Dans le vaste système du fondateur de la métaphysique de l'histoire, existent déjà, en germe du moins, tous les travaux de la science moderne. Comme Wolf, il a dit que l'Iliade était l'œuvre d'un peuple, son œuvre savante et sa dernière expression, après plusieurs siècles de poésie inspirée. Comme Creuzer et Goerres, il a fait voir des idées, des symboles dans les figures héroïques ou divines de l'histoire primitive. Avant Montesquieu, avant Gans, il a montré comment le droit sort des mœurs des peuples, et représente fidèlement tous les progrès de leur histoire. Ce que Niebuhr devait trouver par ses vastes recherches, il l'a deviné, il a relevé la Rome patricienne, fait revivre ses curies et ses gentes. Certes, si Pythagore se rappela qu'il avait, dans une vie première, combattu sous les murs de Troie, ces Allemands illustres auraient dû peut-être se souvenir qu'ils avaient jadis vécu tous en Vico. Tous les géants de la critique tiennent déjà, et à l'aise, dans ce petit pandemonium de la Scienza nuova. » Déjà Ballanche avait insisté sur le caractère prémonitoire, étonnamment moderne de la Scienza nuova, mais c'était pour conclure : « Vico sort du tombeau alors qu'il n'a plus rien à enseigner. » Or pour Michelet, Vico a beaucoup à enseigner encore, et cet enseignement tient en un mot : « L'humanité est son œuvre à elle-même. » Ce « mot de la Scienza nuova », ce « mot profond qui est la vraie lumière moderne », ce n'est pas, notons-le, dans le Discours de 1827, mais dans la Préface de l'Histoire romaine de 1831 qu'il le prononce pour la première fois. L'homme est « son propre Prométhee » : le « principe héroïque » est désormais dégagé, il retentira tout au long de l'oeuvre de Michelet. Une note du Journal (23 mars 1842), guère citée, rapproche Vico de Descartes et de Leibniz, les deux autres héros de la pensée moderne : «Héroïsme du temps moderne: que reste-t-il? Moi. Descartes: je pense, donc je suis (individuellement). Leibniz : je cause, donc je suis (individuellement). Vico : je cause, donc je suis (comme humanité), c'est-à-dire que non seulement mon individualité, mais ma généralité est causée par moi. » A mesure qu'il suit l'évolution qui l'éloigné du christianisme et va aboutir à une rupture violente, Michelet entraîne « son vieux Vico » avec lui et le tire de plus en plus dans une direction non chrétienne, antichrétienne même, comme le montre la note fameuse rédigée à Nervi, en mai 1854 : « Vico enseigne comment les dieux se font et se refont, l'art de faire les dieux, les cités, la mécanique vivante qui trame le double fil de la destinée humaine : la religion et la législation, la foi et la loi. Donc c'est l'homme qui a fait tout cela. Il est incessamment son créateur, il fabrique sa terre et son ciel. Voilà le mystère révélé. Révélation si hardie que Vico en a peur lui-même et fait d'étonnants efforts pour croire qu'il est encore croyant. Le christianisme, religion vraie, reste là tout seul, comme unique exception, à qui le téméraire auteur fait humblement la révérence, lui jurant qu'il n'a rien à craindre dans cette lumière subite. Virgile et Vico sont non-chrétiens, plus que chrétiens. Virgile, c'est la mélodie plaintive de la mort des dieux, Vico, c'est la mécanique par quoi les dieux se refont. Avec le droit, il fait les dieux. En traduisant Vico, j'espérais encore accorder science et religion ; mais dès 1833 je posai la mort temporaire du christianisme et, en 1848, de toutes les religions. J'eus par l'Italie De la « nature commune des nations* au Peuple romantique. 41 une éducation très libre, non chrétienne, Virgile, Vico et le Droit. J'ai passé dix ans (1830- 1840) à refaire la tradition du Moyen Age, ce qui m'en a montré le vide. J'employai dix ans (1840-1850) à refaire la tradition antichrétienne, antimessianique. » « Voilà le mystère révélé... » On sent que Michelet vient de lire Feuerbach. Quelques jours plus tard, il note d'ailleurs dans son Journal, à la date du 4 juin 1854 : « Le grand xvm® siècle... n'est repris (en Italie) que par un géant, Vico, qui dépasse tout, contenant Feuerbach, etc., mais ne se sait pas lui-même et n'est pas su des autres. » Du coup ce Vico qui « ne se sait pas lui-même г et qui, croyant écrire une « théologie civile raisonnée de la providence divine », en arrive à contenir Feuerbach inquiète les commentateurs qui concluent que Michelet a compromis Vico avec lui dans son aventure spirituelle, et qu'après l'avoir servi, dans sa jeunesse, il s'en sert, dans son âge mûr, comme d'un génie tutélaire et décoratif. La perplexité des « micheletistes г rejoint alors celle des historiens des idées qui essaient de suivre à la trace la fortune de l'œuvre de Vico hors d'Italie, et d'apprécier à sa juste mesure le rôle joué par Michelet dans sa diffusion en France. Je ne veux pas reprendre ici le problème général des rapports de la pensée française avec Vico 3. Je me contenterai de rappeler qu'il faut attendre les dernières années du xvnr9 siècle pour trouver quelques allusions au philosophe napolitain sous la plume de penseurs uploads/Philosophie/ alain-pons-roman.pdf
Documents similaires






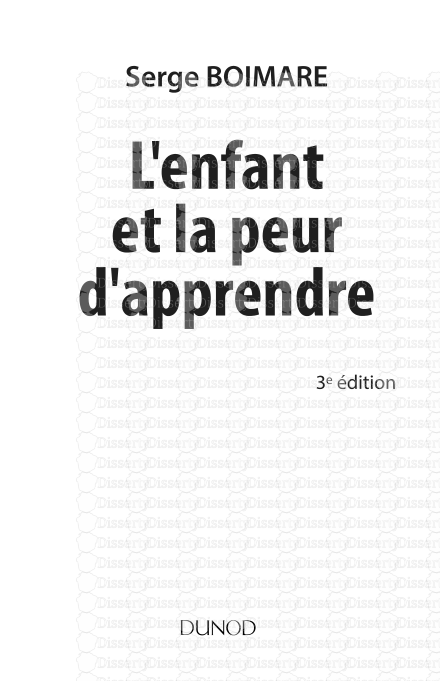



-
47
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 08, 2022
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1008MB


