http://section-clinique.org/dossiers-textes_sur_l_angoisse-207.html Hervé CASTA
http://section-clinique.org/dossiers-textes_sur_l_angoisse-207.html Hervé CASTANET Antonin Artaud – « Obturer l’infini percé » À Florence Lœb, amie d’Antonin Artaud L’œuvre d’Antonin Artaud, dans ses formes multiples (poésie, critique, théâtre, dessins, etc.), est au croisement du discours critique et du discours clinique. L’histoire des travaux sur Artaud suit cette ligne de démarcation. Faut-il choisir une troisième voix qui “ parlerait de la folie et de l’œuvre ” en tentant de nouer Artaud psychotique et Artaud génie ? Cette option a ses lettres de noblesses (M. Foucault, M. Blanchot, J. Laplanche par exemple), mais en faisant de cette conjonction problématique le cœur de sa réflexion elle tend à négliger et la critique et la clinique. Ce et qui conjoint folie-œuvre pose une unité de fait où le génie poétique est le strict répondant de la folie : Artaud est d’autant plus fou qu’il écrit ce qu’il écrit (ainsi les glossolalies), Artaud est d’autant plus un grand poète qu’il peut écrire ce qu’il écrit à cause (ou malgré) sa folie. La boucle est bouclée : folie et œuvre sont désormais inséparables et l’unitarisme qui fonde ces approches inéliminable. J. Derrida, en son temps, proposa une autre lecture : lire Artaud avec les outils qu’Artaud élabora. Le poète nous enseignerait un avant la conjonction-disjonction (le et, le ou) : il n’y a plus le corps et-ou la parole, mais une parole devenue corps ; il n’y a plus le corps et-ou le théâtre, mais un théâtre (dit de la cruauté) advenu par le corps, etc. Une telle lecture, qui se veut anti-métaphysique et anti-unitariste, résonne, dans ses résultats, comme un plaidoyer pro domo. L’auteur découvre chez Artaud la théorie qu’il est en train de construire : avant le langage, existerait une écriture plus ancienne dite archi-texte ou archi-parole . Une conséquence : Artaud se fond dans la théorisation tirée de son œuvre. L’interrogation, ici plus limitée, porte sur : · la position subjective dont Artaud témoigne : pour lui, il y a eu rapt du langage et envoûtement de son corps. · la place et la fonction de l’œuvre dans ce témoignage auquel elle donne forme poétique et graphique. L’œuvre n’est pas que témoignage, elle assure une construction et même une véritable élaboration conceptuelle - ainsi Le théâtre de la cruauté qui redéfinit la représentation et sa clôture habituelle en référence à un nouveau corps désenvoûté. Par ailleurs, l’œuvre graphique du poète, indissociable de la cruauté, assure une fixation d’être par un étonnant travail sur la lettre dessinée, peinturlurée. Elle fait réponse au rapt du langage et tente de sortir Artaud de son envoûtement par l’invention de « totems d’être » La perte des mots Le 31 janvier 1948, Artaud, dans un poème, rappelle ce qui lui arriva, dix ans auparavant, en 1937. Il y a un avant et un après 1937 . Cette date inscrit un véritable bouleversement subjectif où apparaît ce déclenchement qui voit son monde mental s’effondrer. Que s’est-il passé ? Le langage est parti. “ Dix ans que le langage est parti / qu’il est entré à la place / ce tonnerre atmosphérique / cette foudre / devant la pressuration aristocratique des êtres / de tous les êtres nobles [...] ” Comment cela fut-il possible ? “ Par un coup / anti-logique / anti- philosophique / anti-intellectuel / anti-dialectique / de la langue [...] ” L’effet est précis : la langue ne s’articule plus comme auparavant, l’être n’est plus une unité qui noue ce corps à cette pensée, l’identité de soi à soi n’opère plus. Artaud parlera d’une érosion dans la pensée : “ Cet éparpillement de mes poèmes, ces vices de forme, ce fléchissement constant de ma pensée, il faut l’attribuer non pas à un manque d’exercice, de possession de l’instrument que je maniais, de développement intellectuel ; mais à un effondrement central de l’âme, à une espèce d’érosion, essentielle à la fois fugace, de la pensée, à la non-possession passagère des bénéfices matériels de mon développement, à la séparation anormale des éléments de la pensée[...] Il y a donc un quelque chose qui détruit ma pensée ; un quelque chose qui ne m’empêche pas d’être ce que je pourrais être, mais qui me laisse, si je puis dire, en suspens. Un quelque chose de furtif qui m’enlève les mots que j’ai trouvés . ” L’adjectif furtif - l’étymologie faisant surgir la dimension de vol en douce, sans se montrer, sans être pris, avec grande rapidité - se retrouve dans l’expression “ rapts furtifs ” utilisé dans Le Pèse-Nerf. Le rapt furtif, c’est le vol à la dérobée. Il porte sur les mots : aussitôt trouvés par la pensée (effet logique, philosophique, intellectuel, dialectique de la langue), ils sont dérobés, vite et sans retour possible . Le rapt touche prioritairement les mots articulés. Il est un “ coup ” porté contre la pensée et son élaboration mentale. Le rapt accompli, restent des “ trous de vide de plus en plus incommensurables ” où s’invoquent la foudre, le tonnerre - “ [...] néant interne / de mon moi / qui est nuit, / néant, / irréflexion,/ [...] ” Artaud ne s’y trompe pas lorsqu’il donne son nom à ce trou vidé de sa présence : l’être n’existe pas. “ Je suis seul à pouvoir parler de l’être parce que je suis le seul à savoir par antécédente expérience que l’être n’existe pas . ” L’être, après la disparition du langage, n’est plus. Perte du langage et perte de l’être sont inséparables parce qu’identiques. Le langage fait l’être. “ Oui, oui, moi, Antonin Artaud, 50 piges, 4 septembre 1896 à Marseille, Bouches-du-Rhône, France, je suis ce vieil Artaud, nom éthymologique du néant, et qui bientôt aussi abandonnera cette éthymologie avec tous les acides éthymines, liliques, éthynimes, thyliques, éthyliques, taliques, manimanes, thymsiliques, éthylamétiques, tatriques, taltiques et taltaliques, et manimanétiques de manitou, maniques, éthanes, et métamniques, qu’elle contient . ” Cette description nomme l’expérience d’Artaud : sa pensée s’érode sous l’effet de ces acides, dont l’énumération se fait selon l’axe métonymique du délire. Elle est vidée de ce qu’elle contient, de tous ses contenus d’acides. “ [...] j’étais le vide[...] ” dira-t-il. Son nom même se réduit éthymologiquement au néant. Artaud est son nom propre de néant. Ce que l’on appelle l’esprit - et que l’on retrouve dans l’expression commune avoir tous ses esprits - fait désormais défaut : “ Ca n’existe pas, les esprits / ce n’est qu’une bave sortie de l’homme, une sorte de tempo dédoublé de sa vie. / Qui dit : Je suis esprit, n’est qu’un double et avoue sa race de double et c’est tout / Car un esprit n’est plus en vie . ” Ce trou vide entend résonner les glossolalies, la désarticulation du langage, la perte de la logique, l’affirmation de la suite homophonique métonymique : “ radar / tabul ça bizar / radar tabul / ça ta rulde / ala bizar / radar ta bulde / ala putar ”. Artaud, en se comparant à van Gogh comme lui “ suicidé de la société ”, le dit en une phrase : “ Je suis comme le pauvre van Gogh, je ne pense plus [...] ” Les mots (avec la pensée, l’être, l’esprit) sont partis. C’est comme résultat de ces disparitions (la même, déclarée en 1937, saisie en ses multiples effets), que notre poète commente le travail de van Gogh : “ [...] la peinture de van Gogh aura été celle d’un temps où il n’y eut pas d’âme, pas d’esprit, pas de conscience, pas de pensée [...] ” À la finitude de la clôture du mot (de la pensée, de la conscience, de l’âme), Artaud oppose l’infini : “ Et il avait raison van Gogh, on peut vivre pour l’infini, ne se satisfaire que d’infini, il y a assez d’infini sur la terre et dans les sphères pour rassasier mille grands génies [...] Mais surtout van Gogh voulait enfin rejoindre cet infini pour lequel, dit-il, on s’embarque comme dans un train pour une étoile . ” Le poète arrivera à affirmer que le mental n’existe pas, qu’il n’est qu’une façon de faire maladroitement exister les “ subterfuges de l’esprit ”, qu’il est une ruse de Dieu, des prêtres, des savants, des psychiatres, etc. “ [...] il ne peut y avoir de maladies mentales parce qu’il n’y a pas et qu’il n’y a jamais eu de mental, / le mental étant un organisme faux qui ne répond à rien, ne correspond à rien chez aucun homme vivant, et serait matériellement parlant beaucoup plus décelable chez certaines races de [ … ] que dans la désespérante race humaine [...] non les hommes n’ont pas de mental . ” Il clamera : “ Gérard de Nerval n’était pas fou [...] Non, van Gogh n’était pas fou [...] ”, et, pour lui-même, d’ajouter : “ — Vous délirez, monsieur Artaud. Vous êtes fou. — Je ne délire pas. Je ne suis pas fou ” Fou n’est pas pour Artaud le mot qui le désigne, alors qu’il n’hésite pas à parler de son uploads/Philosophie/ antonin-artaud-obturer-l-x27-infini-perce.pdf
Documents similaires





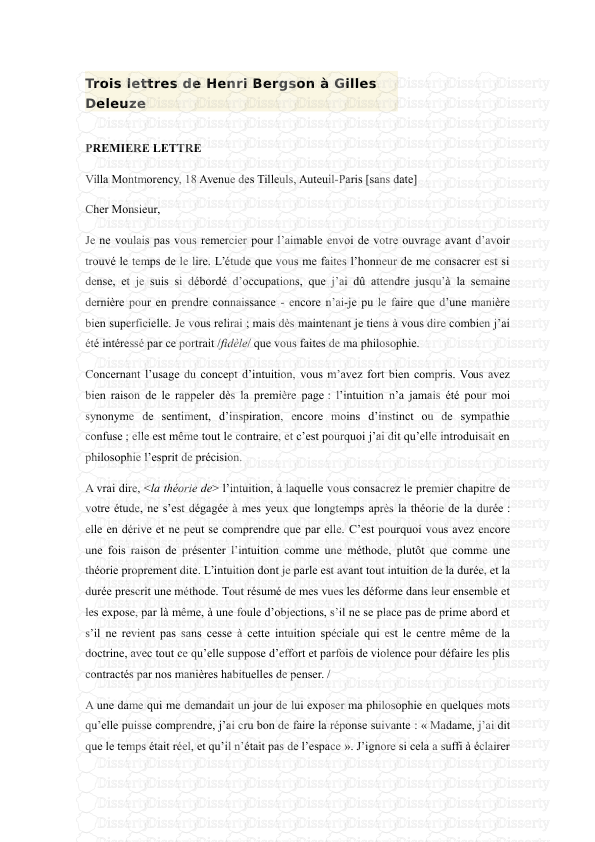




-
127
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 07, 2021
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0804MB


