171 Revue des Études Amazighes, 2, 2018, p. 171-190 Le Maroc au miroir du ciném
171 Revue des Études Amazighes, 2, 2018, p. 171-190 Le Maroc au miroir du cinéma colonial : Anthropologie d’un regard Mohammed BAKRIM Chercheur et critique cinéma A la mémoire de Martine Joly « Certes, le cinéma n’est pas toute l’histoire. Mais sans lui, il ne saurait y avoir de connaissance de notre temps ». Marc Ferro. « Analyser la connaissance anthropologique coloniale revient à identifier les préjugés et les erreurs qui l’ont orientée. La sociologie de la connaissance se réduirait ainsi à une sociologie de la méconnaissance ». Hassan Rachik, Le proche et le lointain. « Un affamé, un humilié, il faut le montrer avec son nom, son prénom et ne pas raconter une histoire avec un affamé, un humilié… car à ce moment tout change, tout est moins efficace, moins moral ». Cesare Zavattini. 172 « Symphonie berbère, André Zwobada, 1947 » Je suis heureux et ravi de prendre part à cette rencontre, importante non seulement de par sa nature académique, du lieu qui l’accueille, mais aussi du fait de sa pertinence par rapport aux grandes questions qui traversent le paysage intellectuel et artistique marocain. Et je dirai même que par certains aspects, notamment le rapport entre la société et les images qui la représentent, elle s’inscrit dans un débat qui transcende les frontières et prend une dimension universelle. Filmer la société ouvre en effet sur des problématiques récurrentes, nourrissant souvent ce que l’on appelle la querelle des images, à travers le temps (l’évolution du cinéma) et l’espace (chaque société réagit différemment aux images) ; en débattre aujourd’hui à Agadir dans une transversalité enrichissante, réunissant anthropologues, spécialistes des sciences sociales, critiques et chercheurs dans le cinéma, est fort opportun. 173 La querelle des images D’abord du point de vue de l’actualité immédiate. Le cinéma a été au cœur de grandes polémiques impliquant justement la question du rapport à la société. L’année écoulée a été marquée par deux faits majeurs qui pourraient éclairer notre débat par des illustrations éloquentes. En France, au mois de décembre, La vie d’Adèle d’Abdel Kechiche s’est vu retirer l’autorisation d’exploitation, en d’autres termes une interdiction pure et simple de toute distribution dans les salles ou tout autre support. Au Maroc, le film de Nabil Ayouch, Much loved a été interdit dans des conditions qui en disent long sur notre époque. Deux interdictions qui attestent que les images continuent de susciter des réactions passionnées, au-delà des contingences et des procédures. En France, le pays qui a vu naître le cinéma, le film de Kechiche a été interdit après un long feuilleton judiciaire qui a abouti à la décision du conseil d’Etat. Au Maroc, c’est une campagne inédite tant par son ampleur que par son contenu qui a amené les autorités de tutelle à agir avant même que le film ne postule à une autorisation de sortie. Les réseaux sociaux numériques ont été instrumentalisés dans une entreprise liberticide. La société a dicté à l’Etat une position au détriment des règles de fonctionnement élémentaire de l’Etat de droit. Nous sommes passés en fait d’une censure par en haut (via les instances habilitées par la loi) à une censure par en bas. Je rappelle le précédent passé presque inaperçu où Un film de Mohamed Achaoer a été retiré des salles suite à la pression du public sur l’exploitant, le film disposant pourtant des autorisations officielles. Le recours au concept de « panique morale » forgé par des théoriciens anglo-saxons peut aider à comprendre comment la rencontre avec certaines images expriment l’existence d’un sentiment d’anxiété généralisé à la suite de bouleversements profonds de la société en termes de valeurs et de modes de vie. Le cas du film de Ayouch est emblématique d’autant plus que le cinéaste n’a cessé de développer autour de son film un discours d’escorte qui n’hésite pas à puiser dans l’arsenal de la théorie du cinéma, pour la défense de sa démarche esthétique, des concepts ayant acquis leur légitimité dans l’histoire des genres cinématographiques, parlant tantôt de réalisme, tantôt de « naturalisme » voire de « réalisme naturaliste » ! 174 Ce qui nous a interpellé le plus, c’est quand il a déclaré à un grand magazine français (Télérama) : « c’est la réalité de mon pays que je montre ». Cela nous place dans le vif du sujet. Autant d’éléments qui légitiment la nécessité d’une intervention académique qui interroge par les outils des sciences sociales, les rapports entre le champ de la production symbolique dont le cinéma est une composante aujourd’hui essentielle et l’ensemble du monde social. Dans cette perspective, je rappelle que le cinéma n’est pas la réalité ; c’est un discours sur la réalité. Et qui dit discours dit construction à partir d’un système énonciatif ; un film c’est un discours construit, scénarisé, mis en scène sur cette réalité. Ni le documentaire, ni la fiction ne peuvent prétendre à la réalité. Nous sommes dans la logique de la représentation qui est le fruit d’un regard, d’un point de vue sur le monde. Nabil Ayouch qui connaît très bien le fonctionnement de la publicité sait pertinemment que par exemple pour un spot de trente secondes, ce sont des semaines de travail, sinon des mois pour parvenir à un discours atteignant son but, sa cible. En avançant que Much loved « c’est la réalité », le cinéaste contribue à la confusion qui règne dans notre contexte socioculturel à l’égard de la réception des images et de la représentation du corps, de la vie intime ou même de certains aspects de la vie sociale. Une confusion qui nourrit la querelle des images qui aboutit parfois à des césures aux conséquences tragiques, voir les derniers événements vécus en France et ailleurs. D’où l’importance de placer le débat à un autre niveau. Non pas celui du pourquoi ? Mais du comment ? C’est-à-dire, situer le débat au sein du cinéma. Poser le débat de fond sur la représentation du social au cinéma. Le film de Ayouch pose par exemple la question de la pertinence pour un cinéma qui aspire à dire le réel, de la division entre fiction et documentaire. Il n’est pas certain que le documentaire puisse toucher la réalité plus que la fiction. Le documentaire donne l’illusion qu’on puisse capter le réel… Il faut faire preuve d’humilité, c’est une illusion. Car c’est quoi le réel ? J’aime beaucoup cette définition qu’en donne Serge Daney : « le réel, c’est ce qui ne revient pas deux fois ». Conscient de cela, Ayouch n’a pas fait un documentaire, il fait du cinéma documenté. Le réel est fuyant, il nous échappe sans cesse. Ce que nous montre le cinéma, c’est une image d’une réalité perçue par un regard. Le titre de l’article que le journal Le monde a consacré au 175 film est révélateur : « Nabil Ayouch dévoile ses prostituées sur la Croisette » ; la problématique est ainsi rappelée en renvoyant à l’auteur, à son film, à son travail d’écriture (en amont et en aval), de montage, de casting... Encore une fois, il s’agit de rappeler une évidence : Much loved, ce ne sont pas des images justes, ce sont juste des images. Des images qu’il faudra interroger à la lumière des acquis du cinéma, du cinéma social en l’occurrence. Lire le film de Ayouch à la lumière de sa propre pratique du genre (Ali Zaoua notamment) ; à la lumière de la filiation cinéphilique qu’il convoque nécessairement, de Bresson à Ken Loach en passant par Pasolini mais aussi Mostafa Derkaoui et Lagtaâ. Et, en somme, lui poser les questions sur les enjeux cinématographiques et politiques de ses choix. En se donnant comme projet de dévoiler des aspects de la société marocaine, il se dévoile lui-même notamment à travers le regard qu’il porte sur les corps, les gestes, les voix, les lieux ; à travers la place qu’il assigne à la caméra et donc déterminant une place pour le spectateur. Qui filmer ? Comment filmer ? En allant filmer des franges de la société dépourvues de moyens d’expression autonome (les enfants de la rue, les pauvres, les prostituées, les exclus…) il opte pour un choix cinématographique qui est éminemment aussi un choix politique. C’est le débat que nous aurions aimé pour le film, le cinéma et le pays. Un débat suspendu pour l’instant tant que l’hypothèque du devenir du film n’est pas levée. 176 Le cinéma colonial Il serait alors utile de situer cette problématique dans une perspective historique pour l’inscrire dans une historicité où elle rejoindrait les grandes questions intellectuelles qui traversent notre champ culturel. Et en convoquant dans ce sens le cinéma colonial dans une rencontre dédiée au rapport cinéma et société au Maroc, je me trouve d’emblée dans la possibilité de formuler une première hypothèse : du cinéma colonial d’hier au cinéma social d’aujourd’hui, je constate la permanence du même paradigme ; celui d’une relation dictée par des rapports de domination, colons/colonisés ; dominants/dominés. En quelque sorte, on continue à produire la même économie politique des images ; là, on filme les indigènes, ici uploads/Philosophie/ cinemamarocain.pdf
Documents similaires








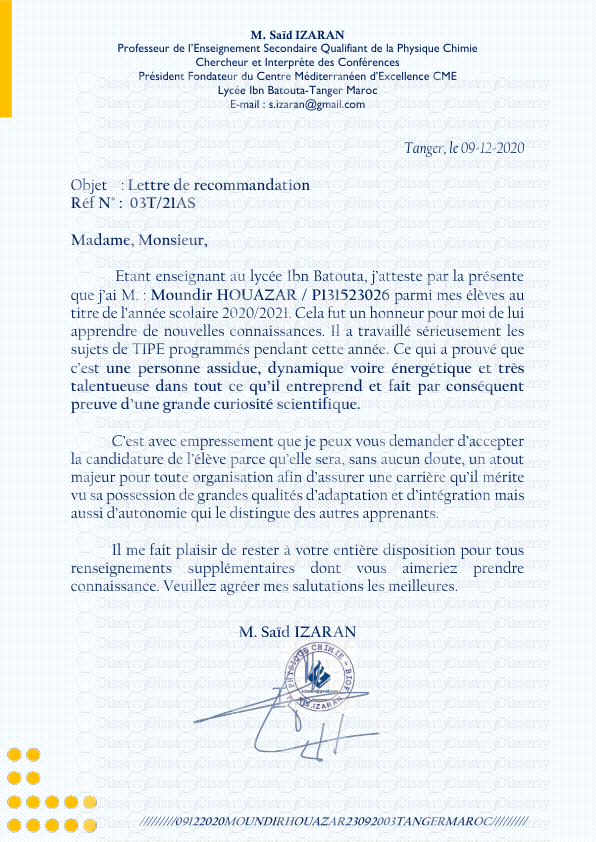

-
94
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 02, 2021
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3092MB


