Presses Universitaires de France is collaborating with JSTOR to digitize, prese
Presses Universitaires de France is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Revue de Métaphysique et de Morale. http://www.jstor.org CONTRIBUTIONS A L'HISTOIRE DE L'ÉVOLUTION PHILOSOPHIQUE DE KANT Author(s): Lewis Robinson Source: Revue de Métaphysique et de Morale, T. 31, No. 2 (Avril-Juin 1924), pp. 269-353 Published by: Presses Universitaires de France Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40896087 Accessed: 31-10-2015 15:25 UTC Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/ info/about/policies/terms.jsp JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org. This content downloaded from 146.201.208.22 on Sat, 31 Oct 2015 15:25:59 UTC All use subject to JSTOR Terms and Conditions CONTRIBUTIONS A L'HISTOIRE DE L'ÉVOLUTION PHILOSOPHIQUE DE KANT 1. En publiant le présent mémoire, notre intention n'est pas de reprendre dans son ensemble le thème déjà si souvent traité de l'histoire de révolution de la philosophie de Kant. Nous nous proposons seulement d'en détacher les moments sur lesquels nous avons quelque chose de neuf à dire, ou que nous croyons pou- voir éclairer d'un jour nouveau. Toutefois, pour obtenir, dans la mesure du possible, un tableau d'ensemble, nous ne pourrons éviter de toucher, en passant, à mainte donnée connue, et déjà bien établie. Ce sera le cas, surtout dans le paragraphe suivant, où sont traités les débuts assez clairs de la pensée philosophique de Kant, c'est-à-dire la période connue chez les historiens, sous le nom de rationaliste-dogmatique. 2. Pendant cette période, Kant est sous l'influence de deux grands esprits auxquels il fait allusion, dès les premières lignes de son premier écrit : Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte. Ce sont: Newton, dans le domaine des sciences naturelles, Leibniz et son école, dans le domaine de la philoso- phie. Dans le domaine des sciences naturelles, auquel il se voue de préférence à cette époque de sa vie, Kant est, on le sait, arrivé beaucoup plus tôt à maturité que dans celui de la philosophie, et son chef-d'œuvre en cette matière, Y Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, appartient déjà à cette première période. En métaphysique, son point de vue est, à cette époque, celui de la Monadologie, qu'il n'interprétait cependant aucunement dans un sens idéaliste, mais bien, avec Wolff et son siècle, dans un sens étroitement dualiste. C'est le fait d'avoir découvert la nature This content downloaded from 146.201.208.22 on Sat, 31 Oct 2015 15:25:59 UTC All use subject to JSTOR Terms and Conditions 270 REVUE DE MÉTAPHYSIQUE ET DE MORALE. dynamique de la substance simple et non sa nature psychique qu'il vante, dans son écrit de 1746, comme étant la grande décou- verte de Leibniz, une découverte que seul Aristotè, dans sa doc- trine si généralement mal interprétée de l'Entéléchie, avait pres- sentie. Leibniz, écrit-il au début de ce traité {Wahre Schätzung, § I), dem die menschliche Vernunft so viel zu verdanken hat, lehrte zuerst, dass dem Körper eine wesentliche Kraft beiwohne, die ihm sogar noch vor der Ausdehnung zukommt. De même, il prend une attitude absolument étrangère à l'idéalisme dans le principal écrit philosophique de toute cette période, dans la Nova Dilucidatio, de 1755. Il y enseigne que l'âme, dans l'accomplisse- ment des fonctions intellectuelles, est forcément liée à la matière, et doit toujours rester unie à un corps organique, faute de quoi elle demeurerait toujours dans le même état, sans pouvoir subir aucun changement, - un point de vue qui se distingue de la doc- trine nuisible du matéralisme, uniquement par le fait de ne pas refuser à l'âme la faculté de la représentation (Prop. XIII, usus). Quant à la seconde conception fondamentale de la métaphy- sique leibnizo-wolffîenne : l'harmonie préétablie, Kant, suivant les traces de son professeur de philosophie Martin Knutzen, - comme, d'ailleurs, la plupart de ses contemporains, représentants du wolffianisme, - l'abandonne déjà dès le début de cette première période1. Son attitude à ce sujet est particulièrement nette dans son premier écrit, où il se déclare carrément pour la doctrine de l'influence physique. Le corps agit sur l'âme, de même que l'âme agit sur le corps; car l'âme aussi est le siège d'une force essen- tielle, d'une vis activa, et comme l'âme se trouve en un lieu défini, et que le lieu (d'après la théorie leibnizo-wolffîenne) est quelque chose qui désigne les actions réciproques des substances, recon- naître une influence de ce genre n'offre plus aucune difficulté. Es hat also einen gewissen scharfsinnigen Schriftsteller - c'est-à- dire Martin Knutzen - nichts mehr verhindert, den Triumph des physischen Einflusses über die vorherbestimmte Harmonie voll- kommen zu machen ( Wahre Schätzung, § 6). Dans la Dissertation de 1755, par contre, il défend une conception qui paraît moins éloignée de la conception leibnizo-wolffïenne. Il repousse main- 1. On verra, en lisant B. Erdmann (Martin Knutzen und seine Zeit, 1876, p. 79 et suiv.), que, dès environ 1740, la doctrine de l'harmonie préétablie avait été presque complètement abandonnée dans l'école de Wolff. This content downloaded from 146.201.208.22 on Sat, 31 Oct 2015 15:25:59 UTC All use subject to JSTOR Terms and Conditions L. ROBINSON. - L'ÉVOLUTION PHILOSOPHIQHE DE KANT. 271 tenant l'idée de l'influence physique, et croit devoir accepter y entre les substances, une harmonie générale, bien que non préé- tablie. La dépendance réciproque des substances, l'action des esprits sur les corps et des corps sur les esprits ne sont pas expliquées par leurs qualités intérieures, mais par le fait d'être unies dans leur origine, dans l'intelligence divine (Nova Diluez- datio, Prop. XIII). Dans ces débuts Kant accepte, en principe, la preuve ontolo- gique de l'existence de Dieu (Prop. Viet VII), bien qu'ilrepousse les formes sous lesquelles elle se présente d'ordinaire, et notam- ment celle que lui a donnée Descartes; dans ce dernier cas, parce qu'elle repose sur le concept insoutenable de la causa sut. La preuve qu'il donne lui-même peut être considérée comme une preuve leibnizienne à rebours. Dieu, l'être nécessaire, enseignait Leibniz, doit être, pourvu seulement qu'il soitpossible. Tandis que Kant dit : Si seulement quelque chose est possible, Dieu, l'être nécessaire, doit exister. Car; nihil tanquam possibileconcipipotest , nisi, quicqùid est in omni possibili notione reale, existât, et qui- dem (quoniam, si ab hac discesseris, nihil omnino possibile, h, e. nonnisi impossibile foret) existet absolute necessário. Ainsi se trouve déjà indiquée la preuve que Kant a exposée plus tard, en détail, dans l'écrit de 1763, Einzig möglicher Beweisgrund] non pas, il est vrai, sous la forme rigide et dogmatique, sous laquelle il la conçut la première fois. Il manque, en outre, dans l'écrit de 1755, la conception qu'il acquerra plus tard, à savoir que l'exis- tence n'est pas un attribut ou une qualité distinctive des choses. Dans la scolie de la Prop. VIII, il parle directement du praedica- tum existentiae. C'est d'une façon frappante que Kant, plus tard le grand champion philosophique du libre arbitre, se place dans la Nova Dilucidatio (Prop. VIII et XI), au point de vue du semi-déter- minisme leibnizo-wolffîen. S'attaquant à Crusius, il combat le concept de Yindifferentiae aequilibris, parce que ce principe con- tredit celui de la raison suffisante, et il montre, dans un exposé détaillé et ingénieux, qu'en niant l'indifférence de la volonté, on ne détruit pas la responsabilité morale de l'homme. De même le problème de la théodicée, la justification de Dieu au sujet de l'existence du mal dans le monde, est traité par la même occa- sion, et résolu dans le sens leibnizien. Particulièrement in téres- This content downloaded from 146.201.208.22 on Sat, 31 Oct 2015 15:25:59 UTC All use subject to JSTOR Terms and Conditions 272 REVUE DE MÉTAPHYSIQUE ET DE MORALE. santé est la position prise par Kant, dans la Nova Dilucidado, devant le problème de la causalité, problème qui devait plus tard jouer un rôle si important dans l'histoire de l'évolution de sa pensée. A côté du principe d'identité, par lequel il comprend à la fois le principe d'identité et celui de contradiction, il place celui de la raison suffisante, ou, comme il préfère le nommer avec Crusius, dela raison déterminante (Leibniz, on le sait, emploie déjà les deux termes). Déterminer, explique-t-il à ce sujet, est affirmer un attribut, en excluant son contraire; une raison, par contre, est ce qui détermine un sujet par rapport à un attribut, ou aussi ce qui effectue une certaine liaison et dépendance entre un sujet et un attribut (Prop. IV). Sous le concept de raison suffisante enfin, est subsume celui de cause : quicquid enim rationem existentiae alicujus rei in se continet, hujus causa est (Prop. VI). Dans l'ensemble, Kant prepd position dans cet écrit comme défenseur de la roposition leibnizo-wolffienne contre les attaques de Crusius, bien qu'il critique, d'une façon cinglante, en plusieurs points, les explications données par Wolff, telle, par exemple, sa définition de la ratio (Prop. IV), ou la démonstration Wolff-Baumgarten de ladite proposition uploads/Philosophie/ lewis-robinson-contributions-a-l-x27-histoire-de-l-x27-evolution-philosophique-de-kant.pdf
Documents similaires


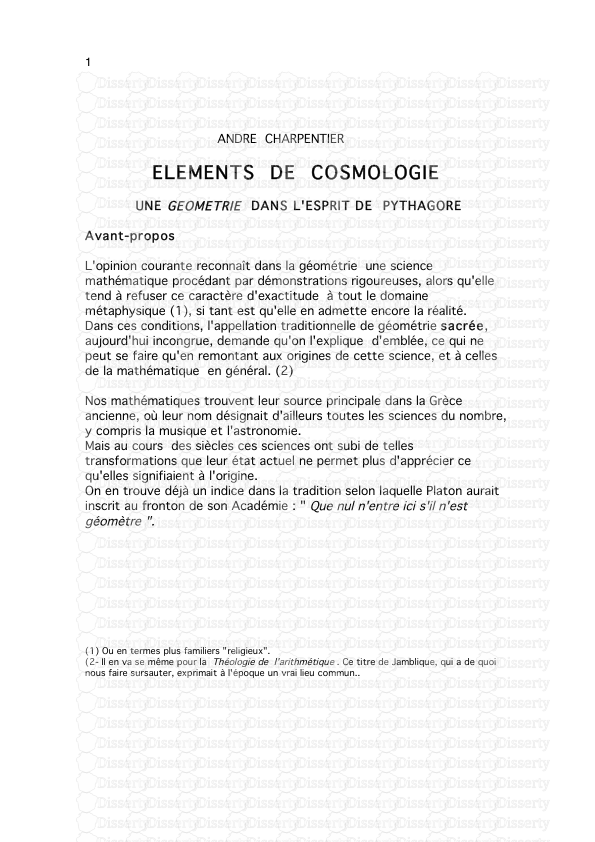







-
57
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 20, 2022
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 6.1114MB


