Revue Proteus – Cahiers des théories de l’art 1 Revue Proteus no3, l’art et l’e
Revue Proteus – Cahiers des théories de l’art 1 Revue Proteus no3, l’art et l’espace public Édito Des commandes officielles à l’activisme artistique, la présence de l’art dans l’espace public rend l’œuvre manifeste, en l’adressant à une collecti- vité. Pour autant l’œuvre ne se constitue pas de façon systématique en manifestation, au sens où elle serait détentrice d’une revendication particu- lière, d’un message que cette collectivité devrait déchiffrer. La proclama- tion de la fin des avant-gardes au XXe siècle ayant signé la remise en cause du pouvoir contestataire de l’art plutôt que celle de sa dimension poli- tique, nombre d’œuvres et d’interventions artistiques occupent aujour- d’hui l’espace public. Cependant, l’articulation de ces pratiques au contexte sociologique, économique et politique dans lequel elles s’ins- crivent n’est pas toujours interrogée – par les artistes eux-mêmes comme par les théoriciens. Le débat actuel sur le sujet se déploie entre deux positions théoriques antagonistes : celle qui considère que les pratiques en espace public sont politiques au sens où elles seraient par leur fonctionnement même des dispositifs mettant en question celui-ci ; celle, à l’opposé, qui voit dans ces interventions une dimension relationnelle plutôt que critique, les envi- sageant comme moyens de créer du lien social. Ces deux positionnements théoriques sont bien évidemment à considérer au prisme de l’axiologie de l’efficacité réelle ou supposée de projets artistiques qui reconfigurent l’es- pace public dans lequel ils s’inscrivent. Le numéro trois de la revue Pro- teus se veut ainsi une tentative de re-cartographier les rapports de l’art et de l’espace public dans un paysage social et culturel en pleine mutation. Réunissant des articles tant monographiques que synthétiques qui pro- viennent de champs épistémologiques divers, il aborde ces rapports sous leurs multiples topoi, aspects et transformations, interrogeant leurs limites et les conditions immanentes de leur construction. L’objectif n’est ni d’avaliser une conception de l’art comme fabrique de sociabilité, ni de s’enfermer dans le constat de la dépolitisation de l’es- pace public contemporain et les impasses théoriques et pratiques qui en découlent. Il s’agit plutôt de penser la place de l’art dans l’espace public à partir du questionnement suivant : doit-on considérer l’espace public comme un cadre qui préexisterait aux pratiques artistiques et dans lequel elles se contenteraient de s’inscrire, ou, au contraire, comme leur matériau même et leur cible principale ? Les différentes contributions du numéro prennent ainsi acte non de la seule présence de l’art dans l’espace public mais bien de la diversité des manifestations de celui-ci – diversité qui est aussi celle de leurs modes opératoires et de leurs effets. Vangelis ATHANASSOPOULOS et Cécile MAHIOU 2 Revue Proteus – Cahiers des théories de l’art Sommaire L’art et l’espace public L’artiste, la critique et l’espace public Aline CAILLET (UNIVERSITÉ PARIS I)............................................................................................................................4 Portrait de l’artiste engagé Sophie RAIMOND (UNIVERSITÉ DE NICE-SOPHIA ANTIPOLIS )..................................................................................11 Notes sur le socle Juan Sebastian CAMELO-ABADIA (MUSÉE DU JEU DE PAUME).................................................................................23 Entre deux noli me tangere, des dermatographies Apostolos LAMPROPOULOS (UNIVERSITÉ DE CHYPRE )..............................................................................................34 Terrorisme artistique : actes de langage dans l’espace public Benjamin RIADO (UNIVERSITÉ PARIS I).....................................................................................................................44 Étude monographique Errance dans les ruelles graphitiques de Matsumoto Taiyō Cyril LEPOT (UNIVERSITÉ PARIS I).............................................................................................................................53 3 Revue Proteus no3, l’art et l’espace public L’ARTISTE, LA CRITIQUE ET L’ESPACE PUBLIC* Qu’est-ce qu’une pratique artistique engagée ?*Un art en prise avec la chose publique, et, en ce sens, politique1 ? Si les vocables ne manquent pas pour qualifier un art que l’on suppose moins soucieux de ses procédés formels que du monde et de ses structures politiques, économiques et sociales, cette abondance de mots, loin de suggérer des nuances dans les approches, véhicule au contraire quelques ambiguïtés. Certains2 font du caractère politique – ou enga- gé – d’une œuvre un critère à même de discriminer les pratiques artistiques : il y aurait, à cet aune, un art politique et un art qui ne le serait pas. Le fondement de cette dichotomie courante tient, d’une part, dans l’usage du terme de politique comme attribut de l’art, d’autre part, dans l’identi- fication implicite de cette dimension politique au contenu. Loin de composer une véritable mé- thode opératoire à même d’identifier les différentes modalités par lesquelles toute œuvre d’art se construit dans un rapport au champ poli- tique, cette approche ne considère comme politiques ou engagées que des œuvres se récla- mant comme telles. Or, saisie dans sa structure même, toute œuvre, quelle qu’elle soit n’est jamais neutre politiquement : l’art n’est pas une activité privée, un loisir, mais une activité qui se lie au commun et entre, à ce titre, dans la sphère poli- tique (espace public d’exposition, sphère publique du jugement…). De même, en tant qu’activité *. Ce texte reprend en les reformulant certaines des thèses développées dans mon ouvrage Quelle critique artiste ? Pour une fonction critique de l’art à l’âge contemporain, Paris, L’Harmat- tan, 2008. 1. La sphère politique est comprise au sens inaugural grec de sphère publique, de ce que les hommes ont en commun et en partage par opposition à la sphère privée et intime. C’est ce sens que nous désignons dans l’expression « le politique » par distinction avec la politique, sens usuel et commun qui renvoie à ses modalités d’exercice et d’effectuation. 2. Nous pensons notamment à Dominique BAQUÉ, Pour un nouvel art politique. De l’art contemporain au documentaire, Paris, Flammarion, 2004. technique économiquement organisée, il convoque une certaine organisation politique du travail et de la production. En cela, tout art est politique, voire aussi social : il n’est pas une pro- duction indifférente au dehors. Une deuxième équivoque très en vogue est celle autour d’un « art social » terme désignant des œuvres aux prises avec le monde réel, qui modé- lisent des situations de rencontre dans une entreprise, la rue ou sur tout autre territoire com- mun ; pratiques qui revitaliseraient ou renouvelleraient les modalités d’intervention de l’artiste dans l’espace public. Les présupposés im- plicites cette fois reposent sur l’analogie entre socialité et portée politique – la présence ou l’in- tervention de l’artiste au cœur de l’espace public le dotant quasi magiquement d’un coefficient d’en- gagement – et, de façon corollaire, sur le caractère purement formel de cette supposée portée – à sa- voir une intervention dans l’espace social indifférente au contenu. Or, un simple locus – en l’espèce l’espace pu- blic – ne saurait à lui seul être signifiant. Et les sens politiques induits par les œuvres se déter- minent avant tout par les buts poursuivis et les moyens de production et formes mobilisées. L’es- thétique relationnelle3 – puisque c’est bien d’elle qu’il s’agit – joue sur la scène sociale, de ce point de vue, un rôle pour le moins ambigu : une fonc- tion modélisatrice, pourvoyeuse de formes, volant au secours d’un politique défaillant. Il est clair qu’ainsi compris, l’art participe de la construction du consensus et consiste à pacifier les zones qui seraient encore rebelles, et à lisser – au travers no- tamment du credo de la convivialité – les points de tensions et de conflits latents… Le contraire, on en conviendra, d’une position critique. 3. Telle qu’elle est défendue par Nicolas BOURRIAUD dans son ouvrage éponyme : Esthétique relationnelle, Dijon, Les presses du réel, 1998. 4 Revue Proteus – Cahiers des théories de l’art Un art critique plutôt que politique Un art politique, engagé ou social n’est donc pas, loin s’en faut, ipso facto critique, au sens de contes- tataire, dissident, minoritaire. C’est pourquoi à ces vocables nous préférons ceux d’art critique et de critique artiste. Car on objectera à raison que le terme d’art critique a une occurrence qui va bien au-delà de la seule sphère politique : la critique peut se faire à l’encontre de la société, des mœurs, de l’art, d’un milieu quel qu’il soit… C’est pour- quoi il est éclairant d’adjoindre à l’expression d’art critique celle de critique artiste qui, non seulement, clarifie la question mais permet de problématiser l’idée d’une fonction critique de l’art à l’âge contemporain. La critique artiste a été inaugurée par le roman- tisme et la modernité baudelairienne. Décalquée de l’expression critique sociale, elle met en œuvre, au XIXe siècle, au travers de la pratique artistique et d’une esthétique de l’existence, une contestation au nouveau monde capitaliste moderne et à ses valeurs, et partage avec elle bien des points, formes et motifs. Toutes deux s’enracinent en ef- fet dans quatre sources d’indignation principales1 que leur inspire le monde bourgeois capitaliste. La critique artiste a consisté essentiellement, au XIXe siècle, à inventer un mode de vie bohème, que théorise et incarne Baudelaire, dans son opposi- tion fondatrice entre l’attachement bourgeois, le patrimoine et la mobilité2. Elle porte en avant, d’une manière générale, les valeurs de grandeur de l’art et une éthique de la distinction pour contrer l’utilitarisme bourgeois. Elle revêt toutefois des formes opposées déjà sujettes à polémique et non homogènes à la lueur desquelles il est intéressant de penser la moderni- 1. Pour ces deux types de critiques, le capitalisme est source de désenchantement et d’inauthenticité des objets, des personnes et des genres de vie associés. Il est, uploads/Politique/ 1-proteus03.pdf
Documents similaires









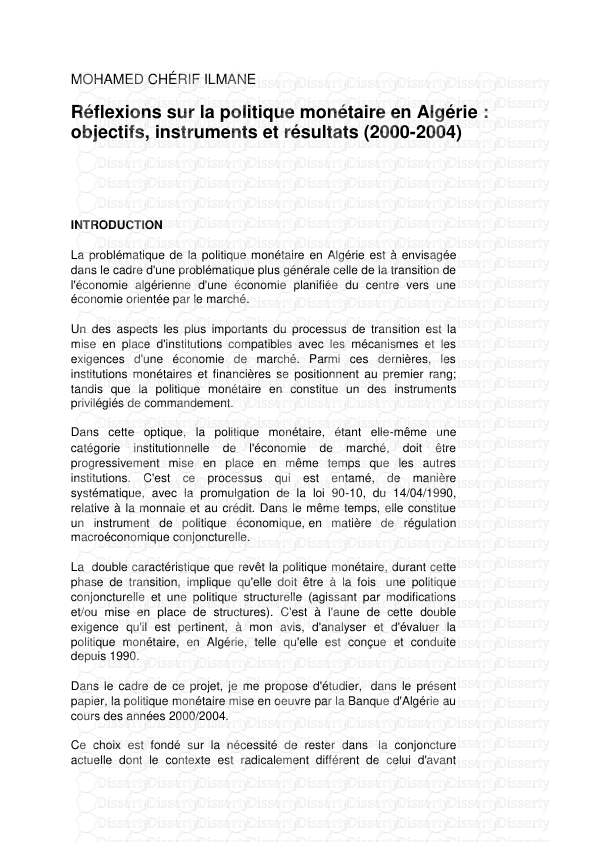
-
59
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 18, 2022
- Catégorie Politics / Politiq...
- Langue French
- Taille du fichier 1.3723MB


