Tous droits réservés © Athéna éditions, 2011 Ce document est protégé par la loi
Tous droits réservés © Athéna éditions, 2011 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. https://www.erudit.org/fr/ Document généré le 16 oct. 2022 15:12 Cahiers de recherche sociologique La connaissance scientifique aux frontières du bio-art : le vivant à l’ère du post-naturel Scientific knowledge at the boundaries of Bioart : Life in a post-natural world El conocimiento científico en las fronteras del bio-arte: lo viviente en la era de lo post-natural Élisabeth Abergel Numéro 50, printemps 2011 L’art post-humain. Corps, technoscience et société URI : https://id.erudit.org/iderudit/1005979ar DOI : https://doi.org/10.7202/1005979ar Aller au sommaire du numéro Éditeur(s) Athéna éditions ISSN 0831-1048 (imprimé) 1923-5771 (numérique) Découvrir la revue Citer cet article Abergel, É. (2011). La connaissance scientifique aux frontières du bio-art : le vivant à l’ère du post-naturel. Cahiers de recherche sociologique, (50), 97–120. https://doi.org/10.7202/1005979ar Résumé de l'article C’est en situant le concept du vivant tel qu’appréhendé par les technosciences et la nouvelle bio-économie, que le texte tente d’articuler la place du bio-art dans la production de la connaissance scientifique. La notion d’objet-frontière est utilisée afin de comprendre le dialogue qui peut s’établir entre deux mondes hétérogènes autour du statut du vivant. D’un côté, le monde de l’art qui met en scène le vivant dans ses oeuvres en le manipulant de manière créative et qui s’immisce dans la pratique scientifique et biogénétique à des fins « est-éthiques » et politiques, et qui tente d’interroger l’avenir de l’humain en explorant les possibilités du vivant. De l’autre côté, le monde scientifique qui tente de s’approprier le vivant en le redéfinissant dans le contexte de la bio-économie dans une logique endogène de production des savoirs. L’article explore les façons dont l’univers du bio-art, en intervenant dans le vivant, peut ouvrir de nouveaux espaces de réflexion sur le statut du vivant dans un monde post-naturel. La connaissance scientifique aux frontières du bio-art : le vivant à l’ère du post-naturel Élisabeth Abergel L ieu de confluence entre science et industrie et entre domaine public et domaine privé, la recherche scientifique en biotechnologie repré- sente une rupture dans la conception même du progrès biologique et de l’évolution organique. La biotechnologie et son appropriation du vivant se caractérisent par l’imbrication de technologies et de procédés scientifiques ainsi que par la survalorisation des produits issus des manipulations géné- tiques. La refonte du vivant s’inscrit par ailleurs dans une démarche indus- trielle, une démarche présentée comme vitale dans les entreprises étatiques et le secteur industriel privé, puisque visant la production et la manufacture de médicaments, de molécules, de fragments génétiques, de composantes chimiques et cellulaires, d’organes ainsi que d’organismes vivants capables de les manufacturer. Mais la dialectique entre organique et inorganique, entre vivant et non-vivant, entre passé et avenir qui sous-tend cette techno-science lui confère du même coup une puissante adaptabilité technologique : elle s’ouvre à des domaines tenant tant du virtuel que du réel, tant du naturel que du synthétique. Du point de vue d’une technoscience qui interpréterait la vie selon ses éléments les plus simples, on pourrait dès lors envisager l’avenir comme un vaste réassemblage génétique et moléculaire dont seul le génie humain serait capable d’imaginer les limites et les permutations possibles. Cahiers de recherche sociologique, no 50, printemps 2011 La refonte de la matière et la maîtrise de ses propriétés inhérentes sont au cœur de ce vaste chantier qu’est devenu le vivant de par sa capacité d’adapta- tion et sa force créatrice : un chantier par lequel les systèmes vitaux subissent des changements permanents et irréversibles. Paradoxalement, la recherche en biologie consiste à « optimiser » le vivant dans un monde de plus en plus hostile à la vie organique. Le défi technologique est de taille : adapter le vivant à toute sorte de dérèglements écologiques, politiques et sociotech- niques afin d’en assurer son potentiel et sa capacité productive. La biologie moléculaire et ses contributions au développement des sciences connexes du vivant demeurent en fait un domaine dont l’objectif ultime reste le profit et la domestication du monde naturel et de ses res- sources. Certains, comme Jean Ziegler, accusent les riches de vouloir élimi- ner la gratuité qu’autorise la nature et de voir dans celle-ci « une concurrence déloyale, insupportable. Les brevets sur le vivant, les plantes et les animaux génétiquement modifiés, la privatisation des sources d’eau doivent mettre fin à cette intolérable facilité1 ». Dans le cas qui nous concerne, c’est l’empire de la technoscience qui œuvre contre la gratuité de la nature en tentant de s’approprier le vivant, d’en redéfinir la valeur marchande et d’en déterminer l’avenir. Pour Jean-Paul Malrieu, la technoscience vue dans un contexte néo- libéral représente une forme nouvelle d’organisation de la production de connaissances et de ses dispositifs applicatifs, qui rompt avec une architecture amont-scientifique/aval- technique. Cette mutation obéit à des raisons endogènes, propres à la dyna- mique scientifique elle-même, mais elle est organisée par les pouvoirs étatiques et économiques, selon un projet politique qu’il faut bien comprendre2. Ordonner la rareté d’un bien omniprésent comme le vivant ne peut mal- heureusement se faire sans en altérer la signification et toute la symbolique qui l’entoure. Comment établir des droits de propriété sur un objet aussi incompris que la vie organique ? C’est pourtant autour d’une redéfinition du vivant que l’univers biotechnologique se structure puisqu’il réduit les orga- nismes naturels en de simples objets de propriété et par conséquent en objets technologiques. Notre relation au vivant est ainsi de plus en plus déterminée par la technoscience, dont le discours doctrinal s’appuie sur un rejet de l’op- position entre naturel et artificiel, ce qui, dans le langage culturel, se traduit par « un désapprentissage des schèmes qui ont défini le vivant pendant plu- sieurs siècles3 ». 1. J. Ziegler, L’Empire de la honte, Paris, Fayard, 2005, p. 47. 2. Jean-Paul Malrieu, « Pourquoi les technosciences ? », texte présenté à l’université citoyenne d’Attac, 2009. 3. M. Chopplet, « Du mode d’existence des objets génétiques », Quaderni, no 11, 1990, p. 9-23. La connaissance scientifique aux frontières du bio-art 99 La fluidité de ces catégories du vivant permet tout un processus d’auto- instrumentalisation de l’humanité, seule espèce qui cherche à contrôler sa propre évolution biologique afin de l’optimiser. Selon Habermas, l’opti- misation de l’humanité rendue possible par les manipulations génétiques nous oblige donc à questionner le fondement génétique de notre existence et notre identité en tant qu’espèce4. La fusion entre éléments organiques et techniques se retrouve d’ailleurs dans la relation entre le Darwinisme et l’idéologie de marché : toutes deux créent une indifférenciation entre sujet et objet ouvrant la voie à la perte d’autonomie du vivant et à son droit fon- damental à une hérédité non manipulée. Il se crée alors un paradoxe puisque la nature est par définition incontrôlable : c’est le contexte social et poli- tique dans lequel se déploie la connaissance scientifique qui donne la fausse impression d’une maîtrise scientifique, politique et sociale du vivant. Nouvelle étape dans l’appropriation du vivant (par le biais de nouveaux régimes de propriété intellectuelle et de systèmes de gouvernance mondiale encourageant son développement à l’échelle planétaire), la biotechnologie vise cependant aussi la maîtrise d’une évolution pouvant mener à la trans- gression de limites jamais franchies auparavant dans le monde organique. Les frontières entre les espèces, entre l’humain et l’animal, et entre l’humain et la machine s’en trouvent d’ailleurs déjà brouillées. Ces mêmes innovations technologiques menacent par ailleurs de détruire notre environnement et ceux qui l’habitent, même si les mondes de la biotechnologie et des tech- nosciences du vivant adoptent la logique du « business as usual » en évitant de remettre en cause les effets catastrophiques du capitalisme contemporain. À bien y regarder, la bio-économie5 forme en fait la pierre angulaire du capitalisme contemporain, car c’est par le biais de la manipulation des orga- nismes vivants et par l’exploitation de leurs capacités d’adaptation biolo- gique que le système actuel assure sa pérennité : la technoscience impose ses propres solutions. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la crise écolo- gique (changements climatiques, disparition de la biodiversité, pénurie d’eau douce, pandémies, etc.) stimule la recherche technoscientifique qui offre l’espoir d’un avenir meilleur malgré l’apparente insolubilité des problèmes ; car derrière le concept de bio-économie figure en fait une idéologie misant 4. J. Habermas, The Future of Human Nature, Cambridge, Polity Press, 2005, 127 p. 5. Le concept de bio-économie est défini ici comme : « …the idea of an industrial order that relies on biological materials, processes and services…a particular re-invention of the global economy – one that more closely enmeshes neoliberal economics and financing mechanisms with new biological technologies and modes of production » (The New Biomasters, www.etcgroup.org). Pour une généalogie du concept voir uploads/Science et Technologie/ la-connaissance-scientifique-aux-frontieres-du-bio-art-le-vivant-a-l-x27-ere-du-post-naturel.pdf
Documents similaires
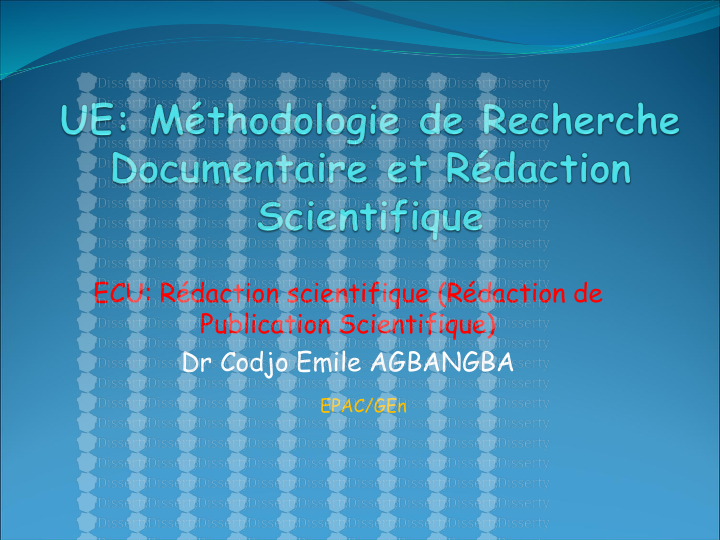









-
52
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 20, 2022
- Catégorie Science & technolo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3136MB


