LES METHODES DE LA SOCIOLOGIE Octobre 1999 INTRODUCTION Fondamentalement, le pr
LES METHODES DE LA SOCIOLOGIE Octobre 1999 INTRODUCTION Fondamentalement, le problème de la connaissance scientifique se pose de la même manière pour les phénomènes sociaux et les phénomènes naturels : dans les cas, des hypothèses théoriques doivent être confrontés à des données d'observation ou d'expérimentation. Toute recherche doit répondre à quelques principes stables et identiques, même si plusieures voies différentes conduisent à la connaissance scientifique. LES TROIS ACTES DE LA DEMARCHE Pour comprendre l'articulation des étapes d'une recherche aux trois actes de la démarche scientifique, il faut dire quelques mots que ces actes renferment et de la logique qui les unit. 1.La rupture Elle consiste à rompre avec les préjugés et les fausses évidences qui nous donnent seulement l'illusion de comprendre les choses. La rupture est donc le premier acte constitutif de la démarche scientifique. 2.La construction Cette rupture ne peut être effectuée qu'à partir d'une représentation théorique préalable qui est susceptible d'exprimer la logique que le chercheur suppose être à la base du phénomène étudié.Il ne peut y avoir, en sciences sociales, de constatation fructueuse sans construction d'un cadre théorique de référence. Les propositions doivent être le produit d'un travail fondé sur la logique et sur un bagage conceptuel valablement constitué. 3.La constatation Une proposition n'a droit au statut scientifique que dans la mesure où elle est susceptible d' être vérifiée par des informations sur la réalité concrète. Cette mise à l'épreuve des faits est appelée constatation ou expérimentation. Elle correspond au troisième acte de la démarche. LES SEPTS ETAPES DE LA DEMARCHE : Les trois actes de la démarche scientifique ne sont pas indépendants les uns des autres. Dans le déroulement concret d'une recherche, les trois actes de la démarche scientifique sont réalisés au cours d'une succession d'opérations qui sont regroupées en sept étapes résumées par un schéma . La question de départ La meilleure manière d'entamer un travail de recherche sociale consiste à s'efforcer d'énoncer le projet sous la forme d'une question de départ. Par cette question, le chercheur tente d'exprimer le plus exactement possible ce qu'il cherche à savoir, à élucider, à mieux comprendre. La question de départ servira de premier fil conducteur à la recherche. Pour remplir correctement sa fonction, la question de départ doit avoir un certain nombre de qualités de clarté, de faisabilité et de pertinence : ----> Les qualités de clarté : - précise - concise et univoque ----> Les qualités de faisabilité : - réaliste ----> Les qualités de pertinence : - vraie question, - aborder l'étude de ce qui existe, fonder l'étude de changement sur celle du fonctionnement, - avoir une intention compréhensive ou explicative et non moralisatrice ou philophique L'exploration Le projet de recherche ayant été provisoirement formulé sous la forme d'une question de départ, il s'agit ensuite d'atteindre une certaine qualité d'information sur l'objet étudié et de trouver les meilleurs manières de l'aborder. C'est le rôle de travail exploratoire. Celui-ci se compose de deux parties qui sont souvent menées parallèlement : d'une part un travail de lecture et d'autre part des entretiens ou d'autres méthodes appropriées. Les lectures préparatoires servent d'abord à s'informer des recherches déjà menées sur le thème du travail et à siter la nouvelle contribution envisagée par rapport à elles. Grâce à ses lectures, le chercheur pourra en outre mettre en évidence la perspective qui lui paraît la plus pertinente pour aborder son objet de recherche. Le choix des lectures demande à être fait en fonction de critères bien précis : liens avec la question de départ, dimension raisonnable du programme, éléments d'analyse et d'interprétation, approches diversifiées, plages de temps consacrées à la réflexion personnelle et aux échanges de vues. De plus la lecture proprement dite doit être effectuée à l'aide d'une grille de lecture appropriée aux objectifs poursuivis. Enfin, des résumés correctement structurés permettront de dégager les idées essentielles des textes étudiés et de les comparer entre eux. Les entretiens exploratoires complètent utilement les lectures. Ils permettent au chercheur de prendre conscience d'aspect de la question auxquels sa propre expérience et ses seules lectures ne l'auraient pas rendu sensible. Les entretiens exploratoires ne peuvent remplir cette fonction que s'ils sont peu directifs car l'objectif ne consiste pas à valider les idées préconçues du chercheur mais bien à en imaginer de nouvelles. La problématique Concevoir une problématique se fait en trois temps. - - - - > On fait d'abord le point sur le problème tel qu'il est posé par la question de départ et tel qu'il nous apparaît à travers les lectures et les entretiens exploratoires. Concrètement, cela consiste, d'une part, à repérer et à décrire les différentes approches du problème et, d'autre part, à détecter les liens et oppositions qui existent entre elles. Ces diverses approches se rattachent implicitement ou explicitement à des systèmes théoriques qui pourraient servir de cadre à autant de problématiques. - - - - > Dans un deuxième temps, il s'agit soit d'inscrire son travail dans un des cadres théoriques existants, soit de concevoir une nouvelle problématique. Au chercheur débutant, il est conseillé de se référer à un cadre théorique existant. Ce choix se fait en tenant compte des convergences apparaissant entre le cadre théorique, la question de départ et les autres informations retirées de la phase exploratoire. C'est à la lumière del a problématique retenue que la question de départ prend un sens particulier et précis. Lorsque celle ci n'a pas été bien précisée antérieurement, le choix d'une problématique est aussi l'occasion de reformuler la question de départ en référence à un cadre théorique particulier et de la rendre plus précise. - - - - > Dans un troisième temps, il s'agit d'expliciter sa problématique. Pratiquement, l'opération consiste à exposer les concepts fondamentaux et la structure conceptuelle qui fondent les propositions qu'on élabore en réponse à la question de départ et qui prendront forme définitive dans la construction. - - - - > Cette opération prend toute son importance lorsqu'il s'agit d'élaborer une nouvelle problématique, mais elle reste indispensable même lorsque la problématique retenue s'inscrit dans un cadre théorique préexistant. En effet, qu'elle existe déjà ou qu'elle soit encore à élaborer, la problématique doit être explicitée car elle fournit le canevas théorique sur lequel va s'édifier la construction du modèle d'analyse. Autrement dit et en bref, elle doit être clairement présentée parce qu'elle constitue les fondations de la recherche. Elle est la partie théorique qui, dans la recherche, précède et justifie le modèle d'analyse et les hypothèses qui seront soumis à l'épreuve des faits. La construction du modèle d'analyse Le modèle d'analyse constitue le prolongement naturel de la problématique en articulant sous une forme opérationnelle les repères et les pistes qui seront finalement retenus pour présider au travail d'observation et d'analyse. Il est composé de concepts det d'hypothèses qui sont étroitement articulés entre eux pour former ensemble un cadre dd'analyse cohérent. La conceptualisation, ou construction des concepts, constitue une construction abstraite qui vise à rendre compte du réel. A cet effet, elle ne retient pas tous les aspects de la réalité concernée mais seulement ce qui en exprime l'essentiel du point de vue du chercheur. Il s'agit donc d'une construction-sélection. La construction d'un concept consiste dès lors à désigner les dimensions qui le constituent et, ensuite, à en préciser les indicateurs grâce auxquels ces dimensions pourront être mesurées. On distingue les concepts opératoires isolés qui sont construits empiriquement à partir d'observations directes ou d'informations rassemblées et les concepts systémiques qui sont construits par raisonnement abstrait et se caractérisent, en principe, par un degré de rupture plus élevé avec les préjugés et l'illusion de la transparence. Une hypothèse est une proposition qui anticipe une relation entre deux termes qui, selon les cas, peuvent être des concepts ou des phénomènes. Elle est donc une proposition provisoire, une présomption, qui demande à être vérifiée. Dès lors, l'hypothèse sera confrontée, dans une étape ultérieure de la recherche, à des données d'observation. Pour pouvoir faire l'objet de cette vérification empirique, une hypothèse doit être falsibiable. Cela signifie d'abord qu'elle doit pouvoir être testée indéfiniment et donc revêtir un caractère de généralité, et ensuite, qu'elle doit accepter des énoncés contraires qui sont théoriquement susceptibles d'être vérifiés. Seul le respect de ces exigences méthodologiques permet de mettre en oeuvre l'esprit de recherche qui se caractérise motamment par la remise en question perpétuelle des acquis provisoires de la connaissance. L'observation L'observation comprend l'ensemble des opérations par lesquelles le modèle d'analyse est confronté à des données observables. Au cours de cette étape, de nombreuses informations sont donc rassemblées. Elle deront systématiquement analysées dans l'étape ultérieure. Concevoir cette étape d'observation revient à répondre aux trois questions suivantes : Observer quoi ? Sur qui ? Comment ? Observer quoi ? Les données à rassembler sont celles qui sont utiles à la vérification des hypothèses. Elles sont déterminées par les indicateurs des variables. On les appelle les données pertinentes. Observer sur qui ? Il s'agit ensuite de circonscrire le champ des analyses empiriques dans l'espace géographique et social ainsi que dans le temps. Selon le uploads/Science et Technologie/ les-methodes-de-la-sociologie.pdf
Documents similaires







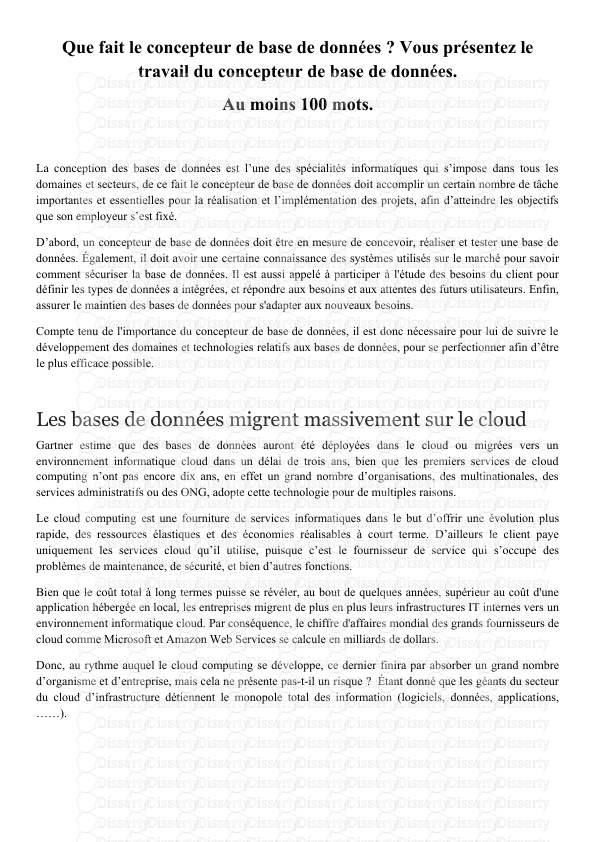


-
124
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 22, 2021
- Catégorie Science & technolo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0920MB


