LA PHYSIQUE DE HEIDEGGER Author(s): Catherine Chevalley Source: Les Études phil
LA PHYSIQUE DE HEIDEGGER Author(s): Catherine Chevalley Source: Les Études philosophiques, No. 3, HEIDEGGER (JUILLET-SEPTEMBRE 1990), pp. 289-311 Published by: Presses Universitaires de France Stable URL: http://www.jstor.org/stable/20848434 . Accessed: 23/06/2014 07:11 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org. . Presses Universitaires de France is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Les Études philosophiques. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.79.179 on Mon, 23 Jun 2014 07:11:41 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions LA PHYSIQUE DE HEIDEGGER* La physique math?matique tient une place importante dans les ?crits de Heidegger : particuli?rement ?vidente dans le cours de 1935, Die Frage nach dem Ding, cette pr?sence se manifeste aussi par de nombreuses autres occurrences dans le reste de l' uvre. Toutefois il s'agit toujours de passages, de remarques, d'allusions plus ou moins d?velopp?es, de promesses d'en reparler dans une autre occasion, ou de jugements d'allure elliptique et paradoxale. On sait par ailleurs que l'essentiel, pour Heidegger, ? partir de 1938, est la n?cessit? sans cesse r?affirm?e de penser l'essence de la technique. Le ph?nom?ne de la science, en tant qu'il est caract?ristique des Temps modernes, repose en effet sur la technique, comprise non pas en notre sens courant comme application ou technique m?canis?e, mais comme projet de repr?senter les choses dans la constance de leur changement, dans la loi de leur ?volution, de fa?on ? les soumettre ? un calcul. A premi?re vue, il ne semble pas qu'il y ait dans l' uvre de Heidegger aucun questionnement sur la physique math?matique qui ne soit subordonn? ? cette identification de la science ? l'essence de la technique. La question que je voudrais, pourtant, poser ici pourrait se formuler de la mani?re suivante : n'y a-t-il pas, ant?rieurement ? 1938, une r?flexion sur la physique math?matique qui non seulement pr?parerait la pr?do minance du probl?me de la technique, mais qui expliquerait ?galement certains aspects surprenants des passages consacr?s ? la physique dans les cours des ann?es 1950 ? * Les contributions ici r?unies correspondent pour l'essentiel aux communications pr?sent?es lors d'une Table ronde organis?e ? l'Ecole normale sup?rieure par les Archives Husserl de Paris (ens/cnrs), en octobre 1989, ? l'occasion du centenaire de la naissance de Martin Heidegger. (N.dJ.R.) Les Etudes philosophiques, n? 3/1990 ?t. ? 10 This content downloaded from 185.44.79.179 on Mon, 23 Jun 2014 07:11:41 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions 290 Catherine Chevalley Mais la n?cessit? de cette question, qui sugg?re qu'il existe une ?vo lution dans la position de Heidegger ? P?gard des sciences de la nature, ne peut s'imposer qu'apr?s certains d?tours. Je ne l'aborderai donc dans ce qui suit que par le biais de l'analyse d'une difficult? qui en appa rence ne concerne qu'un point de d?tail. Il s'agit de la r?f?rence que fait Heidegger ? l'existence d'une diff?rence d?cisive entre deux p?riodes de la physique moderne. Sous des formes plus ou moins d?velopp?es, la mention de cette diff?rence parcourt toute l' uvre de Heidegger jusqu'? la fin, jusqu'aux S?minaires du Thor par exemple, et sinon depuis le d?but et pour cause ? puisque cette diff?rence n'?merge en physique que dans les ann?es 1920 ? du moins depuis 1927. Il n'est pas n?cessaire, pour comprendre ce que veut dire Heidegger, de commenter l'un apr?s l'autre chacun des textes o? cette diff?rence intervient de mani?re r?currente; il suffira de citer un paragraphe de la conf?rence de 1953, Wissenschaft und Besinnung, qui expose avec nettet? et dans toute sa complexit? l'atti tude de Heidegger ? l'?gard de la physique math?matique. ? Cette allusion sommaire ? il s'agit des quelques pages qui pr? c?dent ? ? la diff?rence qui s?pare les deux ?poques de la physique moderne fait appara?tre clairement o? a lieu le changement qui fait passer de l'une ? l'autre : dans l'appr?hension et la d?termination de l'objectivit? dans laquelle la nature se met en ?vidence. Mais, dans ce changement qui a conduit de la physique classique et g?om?trisante ? la physique du noyau et du champ, ce qui ne change pas, c'est ceci, que la nature doit au pr?alable se pr?senter ? la r?quisition qui s'assure d'elle en la poursui vant et que la science accomplit en tant que th?orie. Comment toutefois, dans la phase la plus r?cente de la physique atomique, objet lui-m?me dispara?t, et comment c'est ainsi avant tout la relation sujet-objet en tant que relation qui prend le pas sur l'objet et le sujet et dont il faut s'assurer comme d'un fonds : c'est l? un point que nous ne pouvons examiner de plus pr?s. ?x Dans ce qui suit, je m'efforcerai d'expliquer les trois affirmations distinctes ?nonc?es dans ce texte. La premi?re est la pure et simple position d'une diff?rence; l'identification des deux p?riodes de la phy sique moderne dont il est question ne pose pas difficult?, car elle est maintes fois rendue explicite par Heidegger : il s'agit de la diff?rence entre la physique math?matique classique ? celle qui appara?t aux xvie et xviie si?cles ? et la physique atomique contemporaine ? c'est-?-dire la m?canique quantique, qui est ?labor?e entre 1925 et 1927. En revanche, ce qui fait davantage difficult? ou tout au moins para?t surprenant, c'est la nature de cette diff?rence, qu'explicite le second groupe d'affir mations : que signifie la modification de ? l'objectivit? dans laquelle la nature se met en ?vidence ? et que signifie la ? disparition de l'objet et du sujet ?, attribu?es ici ? la physique atomique ? Enfin, tout aussi i VA, 61/68. This content downloaded from 185.44.79.179 on Mon, 23 Jun 2014 07:11:41 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions La physique de Heidegger 291 surprenante compte tenu du caract?re somme toute fondamental que Heidegger para?t conf?rer ? cette diff?rence, est ensuite la troisi?me affirmation : l'annulation de la diff?rence, son annulation au regard de quelque chose qui demeurerait plus fondamental encore et qui serait la r?quisition de la nature, d?terminante, elle, pour la caract?risation de la modernit?. Je prendrai en consid?ration chacune de ces trois affirmations suc cessivement et en ce qui concerne la premi?re, je ferai d'abord l'hypo th?se que la position d'une diff?rence entre deux genres de physique math?matique est l'affaire du cours que Heidegger r?dige pour le semestre d'hiver 1935-1936 sous le titre de ? Grundfragen der Metaphysik ? et qui a ?t? publi? en 1962 sous celui de Die Frage nach dem Ding. Ceci revient ? proposer une perspective un peu inhabituelle en ce qui concerne la signification de ce cours, qui n?cessite d'?tre justifi?e. Je m'efforcerai donc de montrer dans un premier temps que c'est en 1935 que l'id?e d'une nouveaut? radicale dans les concepts fondamentaux de la physique math?matique commence ? agir dans l' uvre de Heidegger, au point de d?terminer l'autonomie du cours. Comment agit-elle ? En suscitant en vue de la compr?hension de notre position fondamentale actuelle, la question de la mise au clair du fondement de la physique classique comme ime question devant ?tre pos?e afin de permettre de voir ce qui exactement retentit encore en nous de ce fondement, alors m?me que nous savons mainte nant qu'il appartient au pass?. I. ? Position de la diff?rence : la reprise de h question de la chose et la situation interne des sciences de la nature Comment se pr?sente le cours de 1935 ? Le texte en est divis? assez in?galement en deux parties. La premi?re, ? Diverses mani?res d'inter roger en direction de la chose ?, est une sorte de longue introduction. La seconde, ? La mani?re kantienne d'interroger au sujet de la chose ? est consacr?e ? l'analyse de la ? d?termination philosophique de la chos?it? de la chose que Kant a cr??e ?2. Il est assez naturel de consid?rer le cours de 193 5 comme un cours sur Kant. Lorsque, ? la lecture du texte, l'on est frapp? par l'importance et la pr?cision de l'analyse de la pre mi?re loi du mouvement chez Galil?e et Newton, on l'interpr?te tout d'abord comme un effet en retour du fait que ce cours s'adresse ? l'Analytique des Principes. A bien examiner l'Introduction, pourtant, il est clair que l'ordre inverse est plus conforme ? la d?marche de Heidegger et que le choix du commentaire de la doctrine kantienne de l'objectivit? est command? bien plus directement par la question directrice qu'expose cette intro 2. FD, 42/67. This content downloaded from 185.44.79.179 on Mon, 23 Jun 2014 07:11:41 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions 292 Catherine Chevalley duction que par le simple souci d'en finir avec la lecture de toutes les parties de la Critique*. Quelle est cette question ? C'est la uploads/Sante/ catherine-chevalley-la-physique-de-heidegger.pdf
Documents similaires

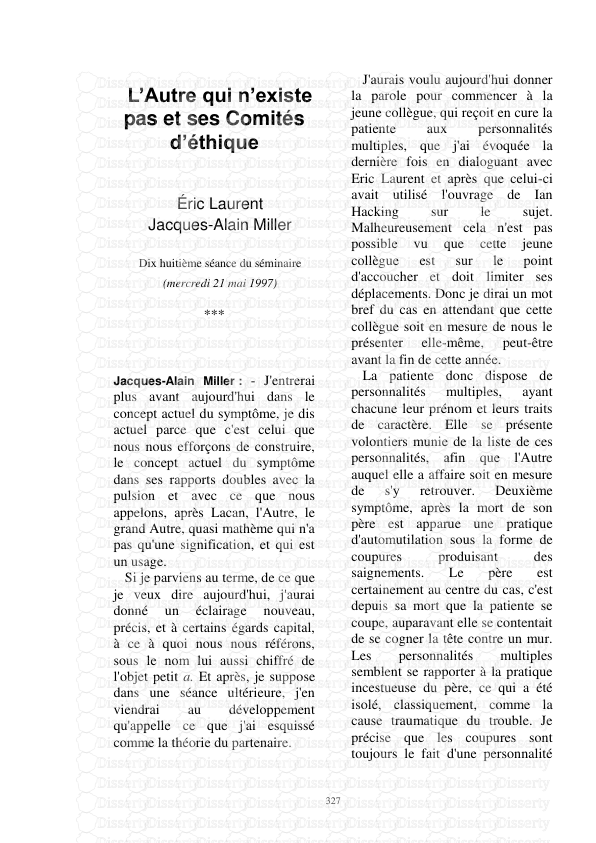








-
92
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 02, 2021
- Catégorie Health / Santé
- Langue French
- Taille du fichier 2.3499MB


