Cours de procédure pénale PROCEDURE PENALE La procédure pénale est l'ensemble d
Cours de procédure pénale PROCEDURE PENALE La procédure pénale est l'ensemble des règles qui organisent le processus de répression d'une infraction. Elle fait le lien entre l'infraction et la peine, par le biais de phases intermédiaires et nécessaires portant sur la constatation des infractions, le rassemblement des preuves, la poursuite des auteurs, et leur jugement par la juridiction compétente. fiche n°1 INTRODUCTION Procédure pénale = ensemble des règles juridiques qui régissent la recherche d’un coupable et son jugement Protection des personnes qui sont injustement accusées de criminel + protection de la société en réprimant les criminels LES SOURCES DE LA PROCEDURE PENALE -- Sources historiques Antiquité : procédure pénale préserve l’ordre public, la victime ne peut pas seule incarner les poursuites, IG, un magistrat incarne l’intérêt de la société Rome : système de l’action populaire, chaque citoyen peut engager les poursuites Moyen Age : grde ordo de la procédure criminelle en 1670, apparition des phases (information, instruction, jugement) Révolution : action populaire, jury d’accusation au stade de l’instruction, puis jury de jugement qui se prononce sur la culpabilité/innocence Système changé sous le Directoire : création des juges d’instruction, déclenchement des poursuites par le MP 1811 : Code d’instruction criminelle. Autoritaire, retour des conceptions d’ancien régime auxquelles la révolution avait voulu mettre un terme. Création des chambres d’accusation, principe de l’unité de la justice civile et pénale, principe de la séparation des fonctions (poursuites, instruction, jugement), principe de collégialité des juridictions Loi du 8 décembre 1897 ( loi Constans) : droit pour l’inculpé d’être assisté par un défenseur 1959 : entrée en vigueur du Code de Procédure Pénale (CPP). Marque le souci de mieux garantir les libertés individuelles, réglementation de l’enquête préliminaire, de la garde à vue, renforcement séparation poursuites/instruction/jugement Puis évènements politiques (Algérie), abandon de ces intentions, durcissement des droits de la défense, multiplication des juridictions d’exception… Evolution générale : renforcement du contradictoire, volonté de désengorger le système judiciaire, procédure + libérale -- Sources nationales La Constitution : règles qui intéressent directement la procédure pénale, rôle du CC, a consacré présomption d’innocence La loi : art 34 à la procédure pénale est de la compétence de la loi. Il y a aussi autres codes et lois non codifiées Le règlement : petite sphère de compétence à décrets + arrêtés ministériels Les principes généraux de la procédure pénale : Selon principe de légalité, juge ne peut pas en consacrer. Pourtant, les tire d’un txt pour une situation particulière. Règles d’organisation judiciaire, de compétence, lois processuelles : parfois, on ne sait pas si c’est une règle de fond ou de forme (ex : loi de prescription de l’action publique) -- Sources internationales Application de la CEDH en droit interne : articles 5 et 6 prévoient présomption d’innocence, procès équitable et public, juridictions indépendantes et impartiales… L’emportent sur dispositions internes incompatibles. Critique du prof : vision anglosaxone. CPP très précis (détention provisoire de 1 an) alors que Conv EDH non (durée raisonnable de la détention provisoire) On s’en remet à l’arbitraire des juges, cad ce contre quoi la Révolution française a lutté Au départ, jspr hostile à la Conv EDH, puis a admis de l’appliquer. Depuis qqs années, législateur recopie la convention dans le CPP. Contrôle du bon respect de la Conv EDH par les juridictions françaises : mis en place par la Convention elle-même. 3 organes à l’origine : -Commission : avait pour mission de parvenir à un règlement à l’amiable du litige entre la juridiction française et le citoyen français -Cour EDH : rôle juridictionnel -Comité des ministres -Protocole N° 11 (1998) : Commission a disparu, Cour EDH contrôle seule, Comité des ministres veille au bon respect des arrêts de la Cour. La CEDH est une juridiction permanente, composée de juges des Etats membres de l’Europe élus. Peut être saisie par un état signataire ou par une requête individuelle. On peut la saisir après avoir épuisé toutes les voies de recours interne. Composition de la Cour : comités, chambres, grde chambre. Chaque chambre est dotée d’un comité qui étudie recevabilité de la requête. Grde chambre saisie si une chambre s’est dessaisie en sa faveur, ou sur renvoi de l’affaire 3mois après le jugement par une chambre Condamnation de l’état français ne remet pas en cause arrêt de la juridiction française, a autorité de la chose jugée Mais depuis 2000, demandeur peut demander le réexamen de son cas. Le législateur intervient souvent après une condamnation de la France (cf écoutes téléphoniques en 1990, loi en 1991) LE ROLE DE LA PROCEDURE PENALE Système accusatoire : contradiction, le juge arbitre, rôle central des parties. Parait le + protecteur des droits de la personne accusée, procédure orale, publique. 1seule phase : le jugement. Justice collégiale. Système de preuve légale (aveu preuve irrécusable de la culpabilité). Défense de l’IG confiée à la seule victime. Système inquisitoire : objectif de lutte contra la délinquance. Rôle actif du tribunal, recherche des preuves, procédure écrite, voies de recours, ministère public, procédure secrète, plusieurs phases, principe de l’intime conviction du juge, très protecteur de l’IG Systèmes mixtes -- : différentes phases, mais contradiction, respect des droits de la défense, ministère public. Procédure pénale française : système mixte. Accusatoire : renforcement des droits des parties. + Inquisitoire : plusieurs phases, intime conviction. Poursuites : augmentation des droits du suspect. Instruction : secrète, écrite, non contradictoire avant. Depuis loi Constans, avocat, droits de la défense. Jugement : accusatoire, oral, publique, contradictoire, collégialité. L’influence du système accusatoire se manifeste par la place de la victime dans le procès. Fiche n°2 LES PARTIES A L’ACTION PUBLIQUE LES DEMANDEURS A L’ACTION PUBLIQUE Mp+ certaines administrations (des douanes par ex). Les membres du MP sont des magistrats, défendent l’IG. Obj : protection de la société -- L’organisation du ministère public Unité du MP : indivisibilité (membres interchangeables d’un jour à l’autre) Subordination hiérarchique (sous ministre de la justice, a autorité sur les procureurs généraux) Ministre peut enjoindre des poursuites, mais peut pas ddr qu’on ne poursuive pas. Tte désobéissance d’un membre du parquet constitue une faute disciplinaire (àsanction) Limites : pouvoir propre de chaque chef de parquet : la désobéissance aux instructions n’entraine pas l’irrégularité de l’acte, on peut pas obliger à agir. Risque juste des sanctions. Membre du MP doit respecter instruction, mais libre de ses positions à l’audience, liberté de parole (art 33 CPP), indépendance de parole Statut des membres du MP : le président est le procureur général auprès de la Cour de Cassation. Sanction prononcée par le ministre de la justice, après avis du CSM (pas lié par avis) -- La fonction du ministère public Autorité de poursuite, déclenche l’action publique, l’exerce, requiert l’application de la loi, dirige la PJ (Art 12 CPP), assure l’exécution des décisions de justice. Indépendance Autorité de poursuite indépendante : irresponsable, pcp de l’opportunité des poursuites (art 40 CPP), indépendant à l’égard des juges et des parties, peut déclencher action publique même si victime ne le souhaite pas. Irresponsabilité pénale et personnelle (victime devra assigner l’Etat si faute dans l’exercice de ses fonctions) Partie intégrante d’une juridiction répressive : partie principale au procès pénal, nécessairement présent. Selon jrspr, est une composante de la juridiction. Rôle ambigu : composante et partie LES DEFENDEURS A L’ACTION PUBLIQUE Personnes physiques : toutes les personnes physiques peuvent être appelées à comparaitre, sauf si ont immunité. Responsabilité pénale est personnelle (enfant mineur auteur de l’infraction sera défendeur à l’action publique, ses parents seront défendeurs à l’action civile) Personnes morales : action publique dirigée contre la personne morale, mais est représentée par son dirigeant. Pb qd infraction imputée à la sté+ son dirigeant. On peut désigner un mandataire de justice pour représenter personne morale. On est défendeur à l’action publique quand on est partie = qd on nous signifie qu’on nous impute la responsabilité de l’infraction (et pas quand le MP nous met en cause). Personne soupçonnée a des garanties, suspect devient partie qd on le met en examen, devient alors défendeur à l’action publique. Il existe des mises en cause officieuses, mais ne valent pas mise en examen. Statut de témoin assisté, pas de partie. Fiche n°3 LES PARTIES A L’ACTION CIVILE LES DEMANDEURS : LA VICTIME Art 2 CPP : Action en réparation appartenant à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction Procédure civile : notion de victime souple, dommage doit être certain, actuel, direct et personnel ≠ Procédure pénale : victime veut réparation + déclencher ou s’associer à l’action publique. Condition : que son préjudice soit le reflet en réduction du dommage que la sté a souffert, défense de l’IG à travers son intérêt particulier -- La qualité de victime La notion de victime est ≠ selon les phases : au stade de l’instruction (art 85) « celle qui se prétend lésée par l’infraction », au stade du jugement (art 2) conditions très strictes. On ne peut pas ddr au stade de l’instruction à la personne de prouver qu’elle a personnellement souffert du dommage, directement causé par l’infraction. Conditions à l’action civile devant le JI uploads/S4/ cours-de-proce-dure-pe-nale.pdf
Documents similaires









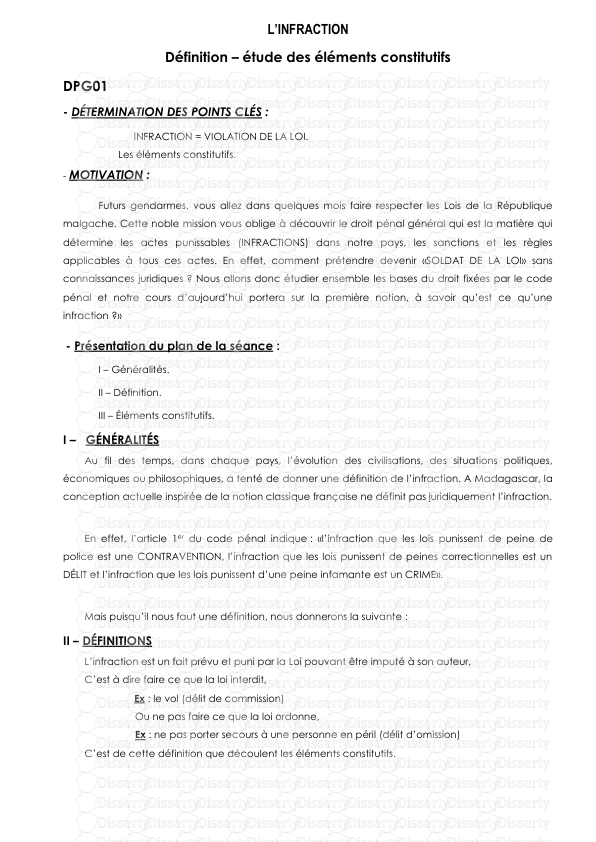
-
32
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 28, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.2640MB


