Les contrats nommés ( le régime Marocain ) Introduction générale : Dans notre v
Les contrats nommés ( le régime Marocain ) Introduction générale : Dans notre vie quotidienne nous passons des contrats les plus divers (location d’appartement, de véhicule, assurance, abonnement téléphonique, achats divers … Aussi et afin de donner plus de sécurité aux parties et parfois aussi pour édicter certains principes impératifs, le législateur est venu préciser la matière dont se concluent et s’exécutent les plus importants d’entre eux. Il s’agit d’après le D.O.C de contrats déterminés ceux que la loi règlemente en raison de leur importance : la vente, le bail, l’entreprise, le prêt, le mandat... etc. Le D.O.C leur réserve les articles 478 à 1240. Il y a de ce fait, un corps des règles générales applicables tous les contrats, qu’énoncent les articles 1 à 477 (formation, consentement, forme, cause, objet, ordre public…) . C’est le droit commun des contrats qui forme avec le régime de la responsabilité civile et des quasi-contrats l’objet de ce qu’on dénomme la théorie générale des obligations. L’objet du présent cours est l’étude des régimes spécifiques adaptés aux principales opérations concrètes que les contrats servent à organiser. Intitulé également le droit spécial des contrats ou le droit des principaux contrats, ce cours se propose d’étudier indépendamment des règles générales applicables à l’ensemble des contrats les dispositions propres à chaque contrat : obligations du vendeur, droits du locataire, responsabilité du dépositaire…etc. Afin de cerner l’intérêt de cette discipline, il convient de rechercher ses sources, de la mettre en regard de la théorie générale des obligations et puis d’approfondir la distinction des contrats déterminés ou nommés et les contrats innomés avant d’évoquer les difficultés de qualification des contrats et de proposer une classification de ceux –ci . A- Sources du droit des contrats : Parler de sources c’est se poser la question de savoir comment les règles juridiques relatives à un domaine donné prennent naissance ? a- Sources de droit interne : 1- En droit interne les règles applicables aux principaux contrats trouvent d’abord leur siège dans le Dahir formant code des obligations et contrats (D.O.C) du 12 Août 1913. Le D.O.C reste la source principale du droit spécial des contrats. Il organise les plus usuels, comme la vente, le bail, le prêt ou le dépôt. Les dispositions du D.O.C sont pour la plupart, supplétives de la volonté des parties. Dans ses articles 478 à 1240 il y a plus de 760 articles sur lesquelles les différentes constructions contractuelles peuvent s’appuyer. 2- La loi 15-95 promulguée par le Dahir n° 1-96-83 du ler Août 1996 formant code de commerce, comporte dans son livre IV intitulé les contrats commerciaux une réglementation relative au nantissement, à l’agence commerciale, au courtage. Etc. (art 334 à 544). 3- La loi 6-79 promulguée par le dahir n° 1-80-315 du 25 décembre 1980 organisant les rapports entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel (baux sans caractère commercial, industriel ou artisanal) . 4- Le dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal). 5- Le dahir du 7 octobre 1970 relatif à la protection des œuvres et artistiques qui réglemente un certain nombre de figures contractuelles : contrats édition, de représentation et de production. 6- La loi 17-99 portant code des assurances. 7- Dans l’ordre interne toujours, il faut compter avec certains types de contrats qui sont régis par le droit coutumier musulman, révélés par la pratique et consacrés ensuite par la jurisprudence, il s’agit de la Mossaqat, de la Mogharassa, de la Khammassat ou encore du contrat de vente Safqa. La pratique a par ailleurs importé et développé d’autres figures contractuelles qui portent un nom mais qui ne font l’objet d’aucune réglementation légale, par exemple : le contrat de franchising , de factoring …etc. Le rôle des praticiens est indéniable dans le développement des contrats spéciaux : les notaires , les banquiers, les assureurs, les vendeurs de matériels électroniques préparent très souvent des contrats qui reposent sur des conditions préétablies dont les parties n’ont plus qu’à remplir quelques lignes laissées en blanc et signer . b- Sources de droit international : A la législation nationale vient s’ajouter la réglementation internationale constituée essentiellement de textes ratifiés par le législateur marocain et qui viennent s’intégrer à notre droit positif, il s’agit essentiellement de : 1- La convention de la Haye du 15 Juin 1955 relative aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels. 2- La convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, qui est essentiellement supplétive. 3- A l’échelon international il faut aussi tenir compte des fameux incoterms régissant la plupart des ventes internationales, qu’on doit à la chambre de commerce internationale et qui sont si répandus qu’ils ont acquis la valeur d’usage. B- Les liens du droit des contrats avec la théorie générale des obligations : Le droit des contrats spéciaux n’a ni la généralité ni la portée de la théorie générale , cette dernière discipline a une autorité bien supérieure au droit des contrats spéciaux qui s’attache plutôt, aux particularités des conventions envisagées une à une . C’est pour cela qu’il se trouve que dans le domaine des affaires l’importance du droit des contrats dépassent parfois même celle de la théorie générale des obligations. Mais il faut tout de même dire qu’à l’ origine le droit des obligations contractuelles est pour l’essentiel, un droit des contrats spéciaux, en effet le droit romain tout comme le droit musulman classique connaissaient et organisaient un certain nombre de figures contractuelles. On a parfois l’impression que l’étude du droit des contrats n’est que la reprise sous une forme plus élaborée de la théorie générale des obligations, les contrats spéciaux n’étant conçus que comme des exemple de celle-ci , et que même si le D.O.C définit quelques contrats particuliers en leur donnant un nom , c’est juste pour que les parties s’en inspirent en tant que modèles avant de la personnaliser en fonction de leurs projets , Or si la théorie générale des obligations ne vit que grâce aux applications concrètes tirées du droit des contrats spéciaux , il faut dire aussi que le droit des contrats spéciaux ne peut pas non plus se passer des règles générales qui sont édictées par la théorie générale des obligations et surtout de la théorie de l’autonomie de la volonté qui contribue largement à expliquer certains aspects du phénomène contractuel. La frontière entre les deux matières est donc loin d’être étanche. Parfois certaines dispositions viennent donner des précisions sur la manière dont les règles générales des obligations s’appliquent : Exemple 1 : l’article 500 du D.O.C qui explique la manière dont s’opère la délivrance de la chose et qui diffère selon qu’ils s’agissent de la délivrance d’une chose mobilière ou immobilière. D’autres dispositions apportent de véritables dérogations aux règles générales et confèrent au contrat qu’elles gouvernement une sorte de particularisme et d’originalité. Exemple 2 : l’article. 931 du D.O.C qui permet au mandant de révoquer, quand bon lui semble, sa procuration. Il s’ensuit donc que l’objet du droit spécial des contrats et avant tout de compléter la théorie générale afin d’adapter les dispositions légales au particularisme de chaque type d’accord. C- Distinction contrats déterminés et contrats indéterminés : La liberté reconnue aux contractants de définir le contenu du contrat a aboutit à ce qu’il peut y avoir une infinité de contrats ayant pour réglementation celle qui a été prévue par les parties, en plus des règles générales applicables à tous les contrats, en effet et suivant l’article 230 du D.O.C « les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Le D.O.C. utilise la dénomination de « contrats déterminés » pour identifier chaque corps de règles et pour permettre la qualification des contrats en donnant un nom à chacun d’eux : vente , louage , échange , dépôt ….Une sorte de statut juridique . A l’inverse ceux que la loi ne détermine pas ou ne nomme pas, ne bénéficient pas d’un statut juridique défini, ce sont les contrats innomés. Ce sont ceux qui naissent des besoins de la pratique et qui finissent par être reconnus comme des nouvelles figures contractuelles. La liberté contractuelle permet à l’imagination des particuliers de façonner selon leurs besoins propres les arrangements qui leurs conviennent. Ils ne sont pas tenus de les couler dans l’un ou l’autre des moules juridiques préfabriqués que la loi met à leur disposition dans le cadre des « contrats déterminés ». Lorsqu’on évoque la liberté contractuelle dans le cadre de la théorie générale des obligations, c’est avant tout pour dire que les personnes ont le droit, à condition de respecter l’ordre public de déroger aux règles des contrats déterminés. En effet et pour une bonne part, ces règles on un caractère supplétif. La liberté contractuelle consiste alors à se démarquer par des clauses contraires. D- Difficultés de qualification des contrats : Pour l’application des règles d’un contrat déterminé, il est nécessaire d’établir la qualification juridique correspondante, les parties elles –mêmes déclarent souvent quel uploads/S4/ el-hachoumy-les-contrats-speciaux.pdf
Documents similaires



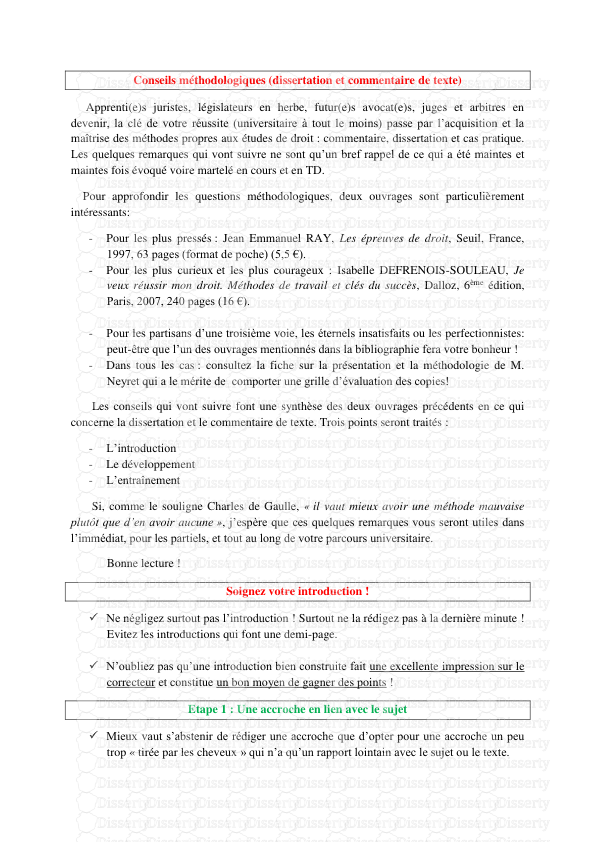






-
66
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 01, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.3291MB


