1 Working Paper no. 2015/2 La concurrence normative européenne et globale1 Beno
1 Working Paper no. 2015/2 La concurrence normative européenne et globale1 Benoît Frydman2 Working Paper no. 2016/3 La concurrence normative européenne et globale1 par Benoit Frydman2 Résumé. - Cet article a pour objet de proposer une définition de la concurrence normative, de retracer l’origine et l’évolution du concept et d’indiquer la méthode pragmatique que requiert son utilisation en droit positif. Il montre comment le tournant global a retourné l’infrastructure juridique de l’ordre moderne en un marché des droits nationaux orienté vers la demande des utilisateurs de droit et en mesure concrètement les effets dans les réformes des droits positifs nationaux. Il examine également comment la concurrence des Etats est instrumentalisée, au moyen des indicateurs, comme un dispositif clé de la gouvernance européenne et globale contemporaine avant de conclure sur le rôle de l’ingénierie juridique et la perspective d’une concurrence internormative, qui risque d’échapper davantage encore au contrôle et à l’intervention des Etats. 1.- Intérêt du sujet. – Objectif et plan de l’étude. – La concurrence normative à laquelle se livrent les Etats aux niveaux européen et mondial, en matières sociale, fiscale, ainsi que dans bien d’autres domaines, et les conséquences délétères qu’elle produit notamment sur les ordres juridiques nationaux, est devenu un sujet d’intérêt et de préoccupation majeur. Le problème intéresse, au-delà du cercle des juristes, les milieux politiques et administratifs et, plus largement encore, l’ensemble des citoyens, alertés par des affaires qui s’imposent régulièrement à la une de l’actualité mondiale3 et inquiets, en particuliers pour les Européens, de la survie de leur modèle politique et social. Sur le plan juridique, la mondialisation a intensifié le développement et l’emprise, non pas tant d’un droit global, au sens d’un ordre juridique mondial de règles communes établies par des institutions planétaires, que d’un marché global des droits nationaux4. Parmi ceux-ci, les ci-devant « sujets de droit » ont de plus en plus largement la possibilité de choisir les normes qui leur conviennent, notamment en ce qu’elles sont 1 Une version préalable de ce papier a été présentée en allocution d’ouverture du colloque international Concurrence réglementaire, sociale et fiscale dans l’Union européenne. Théorie et pratique(s) qui s’est tenu à Lyon les 19 et 20 novembre 2015. 2 Benoit Frydman est professeur à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) et président du Centre Perelman de philosophie du droit. 3 On pense évidemment aux pratiques fiscales révélées par la presse et les médias à l’occasion de l’affaire Luxleaks et encore plus récemment des Panama Papers en avril 2016. 4 B. Frydman et Guy Haarscher, Philosophie du droit, Paris, Dalloz, 1998 (3ème éd. actualisée en 2010). . 2 moins exigeantes ou moins coûteuses pour eux. La concurrence est d’autant plus féroce que les écarts sont très importants entre les régimes juridiques des près de deux cents Etats à travers le monde, sans compter les milliers de zones franches et autres régimes d’exception. Les écarts résultent non seulement de la différence de développement des Etats et de leurs ordres juridiques, mais aussi des pratiques des Etats eux-mêmes, qui réduisent parfois drastiquement leurs exigences en vue d’attirer vers eux des capitaux, des investissements mais aussi des entreprises et des activités économiques. Si les « paradis fiscaux » sont l’expression la plus radicale et la plus connue de ce phénomène, un très grand nombre d’Etats, y compris les plus développés notamment quant à leur modèle social et fiscal, recourent activement à ce type de pratiques. La concurrence normative est également utilisée comme un mode de gouvernance globale, en particulier par les organisations économiques et financières, internationales ou régionales, notamment au sein de l’Union européenne. La mise en concurrence des Etats et de leurs droits fonctionne comme une technique alternative à l’harmonisation des droits et favorise la diffusion d’un modèle normatif unique. En dépit de son importance pratique, l’étude de la concurrence normative est encore trop souvent délaissée à la philosophie et à l’analyse économique du droit, considérées à tort comme extérieurs au droit positif5. C’est là une position qui n’est guère réaliste ni tenable, dès lors que, d’une part, la concurrence normative affecte directement l’effectivité et peut-être le fondement des ordres juridiques nationaux et que, d’autre part, cette concurrence se manifeste elle-même directement par des modifications observables des règles de droit positif nationales. Cet article a pour objet, dans un premier temps, de proposer une définition de la concurrence normative (§ 2), de retracer l’origine et l’évolution du concept (§ 3) et d’indiquer la méthode que requiert son utilisation en droit positif (§ 4). Nous pourrons ensuite montrer comment le tournant global a retourné l’infrastructure juridique de l’ordre moderne (§ 5) en un marché des droits nationaux orienté vers la demande des utilisateurs de droit (§ 6) et en mesurer concrètement les effets dans les réformes des droits positifs nationaux (§ 7). Nous verrons également comment la concurrence des Etats est instrumentalisée, au moyen des indicateurs, comme un dispositif clé de la gouvernance européenne et globale contemporaine (§ 8) avant de conclure sur le rôle de l’ingénierie juridique et la perspective d’une concurrence internormative, qui risque d’échapper davantage encore au contrôle et à l’intervention des Etats (§ 9). 5 L’importation du concept dans la littérature en langue française est liée à l’étude des conséquences de la mondialisation sur le droit : “La mobilité des agents économiques, qui pratiquent de manière généralisée le ‘forum shopping’ (choix du droit le plus favorable ou le moins exigeant), suscite une course à la dérégulation compétitive entre les États. Un marché législatif international se met en place, qui met les ordres juridiques nationaux en concurrence et provoque, sous la pression de la demande, une baisse tendancielle de la ‘pression juridique’, dans un sens conforme à la loi du marché global ». (Frydman et Haarscher, Philosophie du droit, op. cit., ch. 2, section 2, § 1er “la loi du marché global”). La première étude doctrinale approfondie et de grande ampleur en langue française est due à Horatia Muir Watt dans son cours à l’Académie de droit international de La Haye : Aspects économiques du droit international privé : réflexions sur l’impact de la globalisation économique sur les fondements des conflits de lois et de juridictions, Leiden-Boston, Collection des cours de l’Académie de droit international de La Haye, 2004. La première partie de ce cours a pour titre spécifique : “la mise en concurrence des droits”. 3 2.- Définitions. - La notion de concurrence en économie définit à la fois la rivalité entre les acteurs sur un marché et l’état de ce marché lui-même. On peut, sur la même base, définir la concurrence normative de deux manières différentes. Les termes « concurrence normative » ou « concurrence réglementaire » (en anglais « regulatory competition ») désignent le plus souvent la compétition à laquelle se livrent les Etats, au niveau global ou régional, ou même à l’intérieur d’un cadre étatique fédéral, pour rendre leur droit plus favorable que celui des autres à tous ou certains sujets de droit, biens ou opérations que les Etats souhaitent attirer sur leur territoire ou sous leur juridiction. Cette première définition, qui a le mérite de mettre l’accent sur la manifestation la plus spectaculaire et lourde de conséquences du phénomène, n’en saisit pas cependant le principe moteur ni l’ensemble des aspects. Les Etats ne sont pas les seuls agents actifs sur le marché de la concurrence des droits et ceux-ci recourent à d’autres techniques que la réduction de leurs exigences normatives et la modification de leurs lois et règlements pour faire face à la situation de concurrence dans laquelle ils sont placés. Je propose dès lors de désigner ces pratiques par l’expression plus spécifique de dérégulation compétitive. On définira l’état de concurrence normative, comme la situation dans laquelle des sujets de droit se mettent ou sont mis en position de choisir, parmi plusieurs ordres juridiques ou régimes normatifs, les règles qui s’appliqueront à eux, soit de manière générale, soit pour une opération particulière. Cette définition large, privilégiant le point de vue des sujets de droit, permet une analyse plus complète du phénomène, de ses causes et de ses effets, en ce compris la pratique de la dérégulation compétitive6. La concurrence réglementaire est l’une des formes de la concurrence normative par le moyen de l’activité législative et réglementaire. Mais la concurrence normative recouvre aussi la mise en œuvre et l’application pratique du droit, par les diverses administrations et les professionnels du droit, ainsi que par les juges et donc la jurisprudence. La concurrence normative ou internormative peut également désigner la concurrence imposée par d’autres types de normes aux règles de droit et aux institutions qui les édictent et assurent leur application7. 3.- Origine du phénomène et évolution du concept. – La concurrence des normes est un phénomène ancien, probablement aussi ancien que la rivalité politique, économique et culturelle qui oppose, depuis l’aube de l’histoire, les cités, les états et les empires. Comme l’observe Jacques Vanderlinden, 6 Elle rejoint la notion de « pluralisme radical » développée par Jacques Vanderlinden dans son livre Les pluralismes juridiques, Bruxelles, Bruylant, col. ‘Penser le droit’, 2013. 7 V. uploads/S4/ la-concurrence-normative-europeenne-et-g-pdf.pdf
Documents similaires


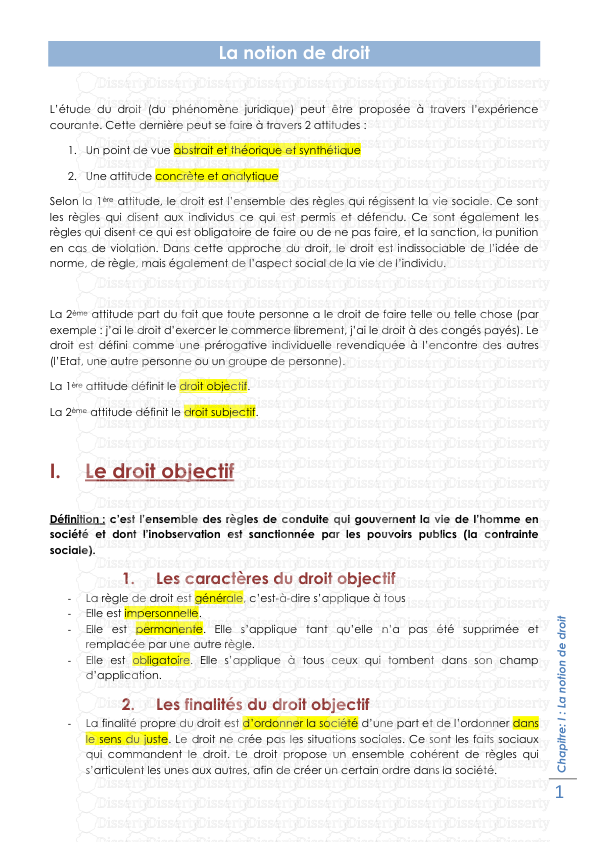







-
65
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 16, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.7543MB


