Chapitre 1 : Les sources du droit administratif français Sur Légifrance, on pou
Chapitre 1 : Les sources du droit administratif français Sur Légifrance, on pourra trouver l’essentiel du droit administratif. La notion de source est plus complexe que cela. Les règles sont des choses complexes. Les règles ne sont pas des choses réelles que l’on peut observeR. On peut constater des discours parlés ou écrits, voir dessinés, que l’on va devoir interpréter comme signifiant une volonté normative, c’est à dire la volonté de faire des règles. On trouve des textes qui sont sensés exprimés des règles. À l’occasion d’un procès, le juge interprète lui les règles. Des gens penseraient que la nature aurait fait des règles : le droit naturel. La nature veut que nous allions des droits. En tant que juriste, on va se cantonner au droit positif. Ce sont les règles faites par les êtres humains. La DDHC est une façon de positiver le droit naturel. À partir où se sont des êtres humains qui fabriquent une règle, on consiste que c’est du droit positif. On va retenir 3 éléments sur la notion de source. • Les règles ont des auteurs. • Les règles ont un contenu. On pourrait dire que la règle c’est l’expression de la volonté • Les règles ont un contenant. Cela peut être un dessin, un écrit ou un discours. La question des sources se résument à identifier les auteurs, le contenant et le contenu. De ce fait, on pourrait alors interpréter ces mots pour comprendre la règle en question. Exemple 1 : Le Parlement. Par principe, ce qui est fait par le Parlement c’est la loi. C’est donc une autorité collégiale qui fait donc des lois. Le contenant sont des textes écrits, dans lesquels on trouvera des règles. L’autorité collectivité = on présume que toutes ses personnes peuvent avoir une seule et même volonté. Exemple 2 : Le PM. Il est lui aussi l’auteur de texte, nommé des décrètes et qui continent des règles, des normes. En ce sens là, le Parlement et le PM peut être tenu pour des sources du droit. Par métonymie (prendre le contenant pour le contenu), la loi est la source de la règle. On peut dire au fond que la loi est une source de règle et que le législateur est une source de règles. Quand on regarde les souches du droit, elles ne sont pas si nombreuses que ça. La C reste la norme suprême. Le pouvoir constituant est la première source du droit. On peut dans un premier temps oublier le droit international, dans la hiérarchie de Kelsen, on trouvera ensuite le pourvoir législatif. En dessous, on trouvera l’administration (le pouvoir exécution). L’administration est donc une source du droit quand elle prend une décision et qu’elle applique le droit. L’office du juge qui est donc d’interpréter des règles préexistantes consistent dans une certaine mesure à donner une autre interprétation du droit, donnant alors une nouvelle règle. Lorsqu’il interprète un texte, c’est un travail de création. La juridiction c’est ce que dit le droit. Le juge dit le droit. On va donc prendre en compte que les juges sont une source du droit. Les seules vraies sources du droit sont des êtres humains. On cherche donc les règles qui s’appliquent à l’administration. Les règles ne s’appliquent pas à tous de la même manière. Il y a malgré tout des règles communes qui s’appliquent à tous. Dans chaque situation, les règles ne sont les mêmes. Au grès des services et des compétences donnés aux agents publiques, le droit n’est pas le même. Exemple : le préfet doit se soumettre aux décision du PM, et non l’inverse. Section 1. Les sources hiérarchisées du droit administratif Par habitude historique, le DA est appelé encore la légalité, correspondant à l’ensemble des règles applicables à l’administration. Cela renvoie à la loi. Aujourd’hui, par extension, la légalité correspond à l’ensemble des règles que l’administration doit respecter. Cela a donc crée le principe de légalité, qui dit que l’administration doit respecter la légalité. I. Les sources constitutionnelles du DA Pour l’instant, la C du 4 octobre 1958, entendue au sens large c’est à dire l’ensemble des règles de valeurs constitutionnelles, reste au sommet de l’ordre juridique. C’est vrai politiquement car on considère que la volonté du pouvoir constituant du peuple est au dessus. Il y a des nombreuses règles de valeur constitutionnelle qui vont devoir s’appliquer à l’administration. A. Le texte de la C, entend au sens des articles 1 à 89 C’est la première C à s’intéresser assez largement à certains aspects de l’administration et notamment aux autorités administratives nationales (le PM, le PR par exemple). Dans notre C, les règles les plus importantes sont les articles 34 et 37, avec la définition du domaine de la loi. Le législateur n’est pas compétent pour tout faire, il a une liste d’attribution pour lui dire ce qu’il doit faire. Il a des choses qui peut faire, d’autres choses qui doit faire. La loi n’a pas le droit de sortir de ce domaine. Toutes les compétences normatives non attribuées au législateur au vu de l’article 34 sont attribués au pouvoir réglementaire selon le 37. Le pouvoir réglementaire est essentiellement composé du PM et du PR. La C donne explicitement des compétences normatives, c’est à dire des règles de portée générale, au législateur. Il n’y a pas de définition à priori du domaine réglementaire. On verra que cela vient de la jurisprudence du CE. La C donne donc des compétences à l’administration mais aussi à la loi qui concerne l’administration. La C parle de l’exercice des libertés publiques (liberté d’association) doit être fait par la loi. On parle parfois de l’administration fiscale. La loi décide des impôts et c’est l’administration qui exécute. La loi regelante les dépenses et recettes de l’État. Il y a une bonne pelletée de loi faite par le ministère des finances. Les CT de la République : la loi régit ses compétences, etc. Les règle des fonctionnaires sont égaies par la loi. Les regels les plus importantes sont faites par la loi. Les règles concernant les différents établissements publics sont faites par la loi, qui a le pouvoir de créer la catégorie. Le pouvoir réglementaire correspond aux « matières autres que celles qui relèvent du domaine de la loi » (article 37). L’arrêt Labonne, CE du 8 août 1919 : le pouvoir exécutif en l’absence de loi a décidé d’instaurer un code de la route. Constatant l’existence d’accidents de plus en plus nombreuses, le PR a décidé de réglementer la route sans être autorisé par une loi. Le décret du PR a été attaqué devant le CE par M. Labonne. Le CE autorise la PR à cela. Il incombe aux autorités exerçant le pourvoi exécutif de préserver en toute circonstance, même si la loi ne le dit, l’ordre public. L’exécution de la loi entraide nécessairement des lois non prévues par le législateurs. Lorsque le pouvoir exécutif prend une décision pour maintenir l’ordre, en dehors de son pouvoir réglementaire, c’est légale. La doctrine l’a théorisé : l’administration n’est pas finalement que le pouvoir exécutif mais consacre quelques pouvoirs régaliens. C’est là que rejoint le gaullisme. M. Debré va consacrer dans la C l’existence de ce pouvoir réglementaire. Les gaullistes vont consacrer qu’il y a un pouvoir indépendant du pouvoir législatif qui est le pouvoir réglementaire. Les compétences et attributions du Parlement c’est l’exception. La C va également répartir les compétences entre les différentes autorités administratives. L’article 20 concerne le PM et le gouvernement : « le gouvernement dans son ensemble dispose de l’administration et de la force armée ». [L’administration et la force armée, deux choses différentes. En réalité c’est vrai.] L’administration n’est plus ignorée. L’administration c’est un ensemble de personne qui sont au ordre du gouvernement. L’article 21 énonce que : « le PM dirige l’action du gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13 il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires ». Le PM est donc le chef de l’administration, c’est lui qui exerce le pouvoir réglementaire. Globalement, l’administration c’est le PM. Sous réserve de l’article 13, relatif aux compétences du PR notamment le fait qu’il préside le conseil de ministres. C’est le conseil des ministres, autorité administrative qui relève de la compétence du PR. L’article 72 et suivants : les CT de la République. La C consacre aujourd’hui l’existence de CT de la République, nommé avant des collectivités locales. Cet article rejoint une proclamation de principe faite à l’article 2. L’organisation de notre République est décentralisée en vertu de l’article 2 de la C. LEs CT correspondent donc à la décentralisation, ce sont les compétences exécutifs, réglementaires et législatifs sont exercées par d’autres personnes que celles de l’État. L’article 72 règlemente en partie les CT en proclamant par exemple qu’elle s’administre librement par des conseils élus. L’article 72 et suivants énoncent également que l’État doit inclure des ressources liées aux compétences attribuées des CT. La C fait du DA. B. La DDHC du 26 uploads/S4/ les-sources-du-droit-administratif-chap-1.pdf
Documents similaires





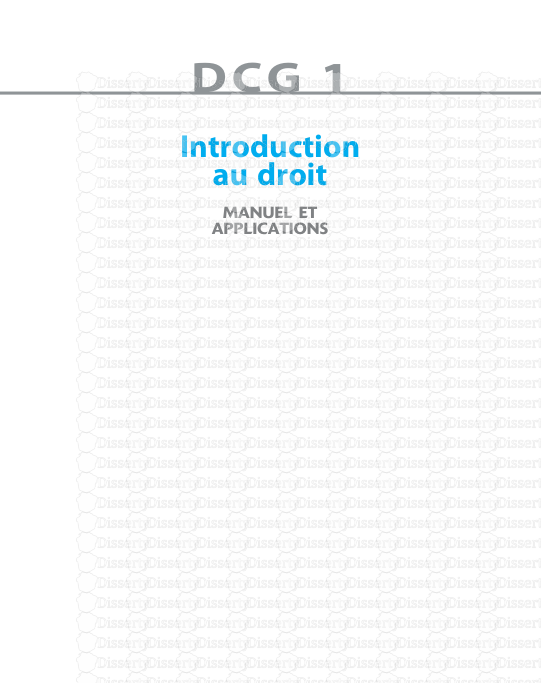




-
41
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 26, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1139MB


