PLAN PREMIERE PARTIE : LE DROIT OBJECTIF TITRE PREMIER : APPROCHE THEORIQUE DU
PLAN PREMIERE PARTIE : LE DROIT OBJECTIF TITRE PREMIER : APPROCHE THEORIQUE DU DROIT Chapitre premier : Définition du droit Le droit objectif : il existe des obligations et des interdictions. Des règles de bienséance, un mode de commandement religieux, équité, justice, convenance, savoir-vivre. Comment distinguer une prescription juridique et une règle morale ? Section première : Définition formelle du droit Paragraphe premier : Le critère de la règle de droit Le critère de la règle de droit est caractérisé par la sanction. La sanction d’une prescription de droit est une sanction est une sanction étatique. La sanction est étatique et elle inclut la susceptibilité d’être mise en œuvre par la force publique. Il existe des interférences entre les critères objectifs et substantiels. C’est un chevauchement entre règle de bienséance et de droits ainsi que de droit et religion. G.Ripert a démontré que l’ensemble du droit français est innervé par la religion. La force obligatoire des conventions se dit : pacta sum serventa. • Le chevauchement entre règles juridiques en les règles morales. Le droit doit correspondre à la morale au minimum pour être respecté. La force du pouvoir politique nom sera pas respectée si ne correspond pas à la morale. Le but est que la majorité de la population respecte spontanément les règles de droit. Ces chevauchements sont essentiels. Un exemple : l’éthique dans le domaine scientifique. Il faut concilier le progrès scientifique et dignité humaine. Les lois bioéthique (mais la 1994)réglementé : 2 lois bioéthique du (29 juillet 1994) .ses le comité consultatif national d’éthique qui a pour but de donner son avis sur les problèmes moraux que soulève le domaine de la de médecine, biologie … Le droit et la morale ne doive pas être confondue car ces deux domaines n’ont pas le même objectif : La morale : doit perfectionner l’individu Le droit : organise la société La confusion des deux, entraînerait toutes les idéologies de l’homme nouveau, de l’homme parfait,l’entraîne des systèmes totalitaires. Quelques exemples : le maire Durant la révolution française : avec l’idéal de peuples libres (système ou la guillotine a le plus fonctionner) Idéologie communiste L’idéologie nazie Parfois le droit s’oppose à la morale. De plus on observe une certaine méfiance du droit face aux actes généraux, comme par exemple l’acte de donation. En effet le donateur s’appauvrit au bénéfique du donataire. Ces actes généreux sont considérés par le droit comme dangereux. Paragraphe second : Les caractères de la règle de droit Il existe trois caractères : • Un caractère obligatoire. La règle de droit est obligatoire mais la portée de ce caractère n’est pas toujours la même,il existe différents degrés. ∙ Il existe deux types de règles : - les règles impératives : elles imposent au sujet de droit de manière absolu. Ils doivent respecter cette règle. Elles sont dites prohibitives ou règle d’ordre public. - les règles supplétives de volonté : elles ne s’imposent pas avec la même vigueur. Elles s’appliquent seulement si les sujets de droits ne les ont pas écartés. Ex : règles au contrat, transfert de propriété ( solo concensu) Elles sont dites : règles interprétatives ou déclarative. Le caractère supplétif ne remet pas en cause le caractère obligatoire car elle s’imposera si les parties ne l’ont pas écartés. • La règle générale et abstraite ( impersonnelle) Elle ne nomme personne en particulier. Elle s’applique a des personne non cités, non individualisés .Elle ne s’applique pas toujours a tous, mais a tout les individus compris dans les conditions d’applications. Ex : la loi sur les mineurs, la loi sur le président de la république. Cette impersonnalité et la généralité d’une loi. C ‘ est le gage de son impartialité et égalité des citoyens devant la loi. Une décision particulière est votée par la loi mais n’est pas une règle de droit. (ex : les obsèques nationale du général De gaulle) • La règle permanente Elle reste en vigueur jusqu’à son abrogation expresse ou tacite. - Expresse : lorsqu’une loi précise qu’elle abroge le texte antérieur. - Tacite : si la loi nouvelle est incompatible à une loi antérieure, on considère qu’elle abroge l’ancienne loi car il y a une priorité donné à la dernière volonté donné. La règle de droit spéciale déroge a la loi des règles générales : « specialia generalibus derogaus ».Quand une loi spéciale est incompatible à la loi générale, la loi spéciale n’abroge pas la règle générale. Ex : la loi de 1989 sur le bail d’habitation….pas d’abrogation de la li du code civil sur le bail. « generalia specialibus non derogante » : les règles générales ne déroge pas aux règles spéciales . l’ abrogation ne peut avoir lieu que par l’autorité qi a édicté la règle de droit.Une règle de droit n’est pas abrogé par désuétude. Section seconde : définitions suplétives du droit Des définitions relatives au contenu du droit : - Définition téléologique : definition donné en contemplation de la finalité du but poursuivi par la règle de droit. - Définition philosophique : transcendantale positiviste. Paragraphe premier : Définition téléologique Il doit y avoir justification du caractère obligatoire de la règle de droit. Les finalités de la règle de droit sont multiples. Ex : liberté- égalité - fraternité : c’est antinomique. A- La finalité du droit est-elle la justice ou l’utilité ? La justice est la finalité du droit. Aristote a distingué deux types de justice : a. La justice commutative : Cette justice doit présider aux échanges individuels. Elle doit assurer l’équilibre ou la préservation de l’équilibre entre les patrimoines individuels. Exemple : le vendeur en échange du bien doit recevoir un prix de valeur équivalente au bien. Ou encore , dans le as de la responsabilité civile, délictuelle. Le responsable doit indemniser la victime, quelque soit la position sociale ou économique de l’individu. b. La justice distributive : C’est une notion politique de la justice. On se place sur le plan collectif. Il faut assurer la meilleure répartition possible entre les richesses et les charges, les droits et les devoirs et ce même si on doit aboutir à des situations qui remettent en cause la justice commutative. Ex : les prestations sociales. Aujourd’hui la redistribution de fait selon les besoins. Le droit doit également assurer l’ordre social. En effet, parfois le droit heurte l’idéal de justice. Il écartera le cas échéant l’idéal de justice par l’ordre social. Il existe des règles de droits indifférentes avec la justice. Ex : code de la route, règle de l’urbanisme. Il y a certaine règles qui écarte la justice, comme la prescription, ou encore le refus de la lésion ( atteinte a la justice commutative). En effet, le droit refuse de rompre un contrat pour lésion, car le contrat est valable juridiquement. La justice en tant que finalité du droit doit être combiné avec l’utilité. « le droit est la science du juste et de l’utile »Maleauri → la justice sans ordre = anarchie → l ’ ordre sans justice = tyrannie Certains politiques anglais ont réfléchi a l’objectif d’utilité du droit : Bentham et stuart mill. Selon Bentham seul l’utilité permet d’évaluer une règle de droit. Le droit doit conclure au plus grand bonheur du plus grand nombre. C’est une philosophie d’essence libérale soucieuse du bonheur des plus déshérité. Le paradigme d’une règle de droit c’est son utilité. Selon la doctrine américaine : il faut faire une analyse économique du droit. « une règle de droit doit être efficace sur le plan économique » Posner. Cette doctrine remet e cause la force obligatoire des conventions « pacta sum servanta » La force obligatoire des conventions est occulté si elle empêche la production maximale. Cette doctrine n’a aucun succès en France pour trois raisons - Cette doctrine est tombée dans des excès homo-économicus - La féodation du droit à l’économie. Le droit ne peut pas se soucier exclusivement de l’économie. - La France n’est pas un pays libéral B- Individualisme ou collectivisme Il s’agit d’une distinction d’ordre politique. La politique et le droit sont intrinsèquement liés. Le droit est intrinsèquement liés. Le droit est au service du pouvoir politique. L’individualisme voit dans l’individu la valeur essentielle, celui-ci doit être au cœur du système économique, social et politique tout en respectant sa liberté et sa responsabilité. Le droit doit être élaboré en fonction de cet individu (concept de la révolution française 1789) Ex : art 4 de la DDHC du 26 / 08 / 1789. Avec la doctrine sociale ou même collectiviste on peut observer un excès du libéralisme au XIX ème siecle. Le collectivisme place l’Etat au cœur du système : pensée hégélienne / pensée marxiste. En ce qui concerne la pensée hégélienne, le droit a pour seule finalité le service de l’état. Les droits individuels doivent s’effacer pour l’intérêt de l’état. Le système politique des pays européens met l’individu au cœur du système sans oublier que la société permet à l’individu de s’épanouir. C’est grâce à la société que l’individu peut exercer ses intérêts personnels. Par leur nature, les droits subjectifs uploads/S4/ methodologie-juridique-et-indroduction-au-droit-l1 1 .pdf
Documents similaires







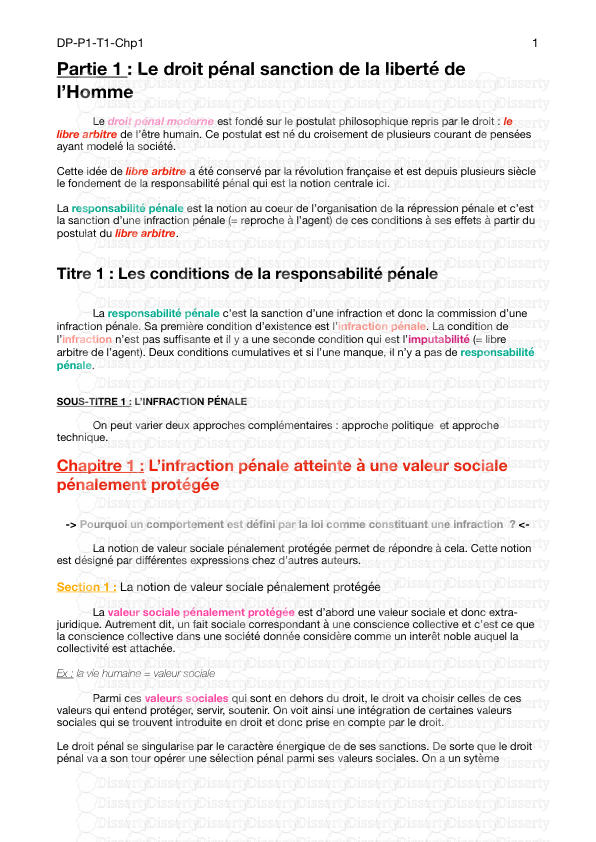


-
50
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 12, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.2577MB


