TD N°4 Droit administratif L’identité constitutionnelle de la France Désignant
TD N°4 Droit administratif L’identité constitutionnelle de la France Désignant à la fois le socle constitutionnel national et la dimension contentieuse de la norme suprême, l’identité constitutionnelle est un concept jurisprudentiel destiné à résoudre, dans l’ordre juridique interne, les conflits entre les normes inhérentes à l’intégration européenne et les normes constitutionnelles. Cette définition de l’identité constitutionnelle même conduit à se poser une certaine question qui découle du problème de conflit entre l’identité constitutionnelle de la France aux normes internationales et donc, à la notion de supra constitutionnalité. En effet, cela renvoie à la question de la Constitution elle-même, qui, si l’on admet que par définition elle constitue la norme suprême d’un ordre juridique, elle ne saurait pour cette raison être soumise à une quelconque exigence juridique supérieure et en l’occurrence, les normes internationales qui comprennent les normes inhérentes aux directives européennes. Il reste cependant à préciser que ce concept d’identité constitutionnelle, dont son attachement importe tant, ne sort pas de nulle part et n’est pas survenue de manière hasardeuse. L’origine même de cette idée d’identité constitutionnelle française est, contradictoirement, du à l’Europe qui a grandement contribué, si ce n’est totalement, à la reconnaissance de son l’identité constitutionnelle. A cet égard, le défunt traité établissant une constitution pour l’Europe, dont les effets restent néanmoins gravés dans l’interprétation constitutionnelle, consacre un principe de primauté du droit de l’Union européenne qui contribue grandement à cette reconnaissance de son identité par la France grâce à l’Union européenne Néanmoins, en continuant dans cette vision purement positiviste, il est possible de trouver des éléments de supra-constitutionnalité, ne serait-ce que dans l’identification du contenu de la norme fondamentale qui domine tout ordre juridique. A cet égard, il s’agit de citer notamment l’article 88-1 de la Constitution disposant que « la République participe à l’Union européenne constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ». De cette formulation découle une exigence certaines de transposition des directives européennes par les autorités des Etats membres dont le France en fait partie et ainsi, un élément certain de contrariété avec la norme fondamentale qui domine tout l’ordre juridique, à savoir la Constitution, en principe. En effet, contrairement à cette exigence de transposition des normes européennes, le préambule de la Constitution de 1958 et plus précisément celui de la Constitution de 1946 qui le compose, fait référence à des « principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France ». Cette expression dégage ouvertement l’idée qu’au sein même des normes de rang constitutionnel, certaines seraient plus dignes d’intérêt et plus digne de protection que d’autres. C’est en ce sens que l’opposition traditionnelle entre identité constitutionnelle et supra constitutionnalité voit le jours et fait apparaitre une certaine forme de hiérarchie entre ce qui est inhérent à l’identité constitutionnelle de la France et ce qui ne l’est pas, qui, en conséquence serait juridiquement moins important que celle-ci. A cet égard, le rapprochement de ces deux notions d’identité constitutionnelle et de supra constitutionnalité dégage une certaine proximité dans les finalités qu’elles poursuivent. En ce sens, Il serait même possible d’affirmer que ce que vise à protéger toute forme de supra constitutionnalité est le fondement même d’un système constitutionnel et donc son identité constitutionnelle En outre, il serait absolument rationnel de soulever une certaine forme d’interdépendance bénéfique en deux points de vue. D’une part, d’un point de vue fonctionnel qui se rattache aux fonctions remplies par les notions de supra constitutionnalité et d’identité constitutionnelle qui fait qu’on ne peut qu’en déduire une indéniable proximité (I). Et, d’autre part, d’un point de vue opérationnel qui s’intéresse aux modalités de mise en œuvre et de contrôle de leur respect, ce qui entraine une certaine forme d’interdépendance entre ces deux notions (II). I/ Une proximité fonctionnelle certaine entre les notions de supra constitutionnalité et d’identité constitutionnelle En affirmant que ces deux notions présentent une certaine proximité dans leur fonction, il convient de préciser qu’elles poursuivent toutes deux un but qui vise à empêcher toute remise en cause de ce qui est au fondement même d’un système juridique. Ainsi, cette fonction commune se divise en deux aspects. Ces deux notions partagent la volonté de protéger certaines valeurs (A) et ceci afin d’en déduire des conséquences en termes d’articulation des normes relatives à ces dernières (B). A) La protection de valeurs : un objectif commun à ces deux notions Le premier point commun entre identité constitutionnelle et supra-constitutionnalité découle de l’ambition commune de ces deux notions, à savoir protéger de telles valeurs. A cet égard il convient de préciser que l’objectif de cette protection et son objet sont, dans une certaine mesure, aussi commune que leur volonté de protéger certaine valeur. Ce qui découle de leur confrontation, à l’égard de l’identité constitutionnelle, n’est rien de plus qu’une forme de résistance dirigée contre l’Union européenne et tel est sa fonction. Cette fonction consiste, plus précisément, à se protéger elle-même contre les compétences de l’Union européenne qui portent atteinte à son intégrité et à se protéger de son contrôle relatif aux moyens mis en œuvre par les Etats membres qui ont pour finalité de transposer les directives européennes. A cet égard, en modifiant sa formulation de 2001, le Conseil constitutionnel, par sa décision du 27 juillet 2006 dite loi relative au droit d’auteur, considère que la transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France sauf à ce que le constituant en ait consenti. En l’occurrence, il s’agit d’une opinion partagée par le Conseil d’Etat qui, néanmoins, est un peu plus radical à cet égard en affirmant plus tôt dans son arrêt du 3 décembre 2001 syndicat national de l’industrie pharmaceutique, dans une certaine mesure, que le principe de primauté du droit européen sur tout ordre juridique ne saurait conduire à remettre en cause la suprématie de la Constitution et, par voie de conséquence, ce qui fonde cette fonction de protection de l’identité constitutionnelle de la France. Ces principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, sont dès lors, son objet et à savoir la catégorie de norme fondant l’adhésion au système constitutionnel national, autrement dit, l’expression de valeurs essentielles au constitutionnalisme français. Cela nous ramène donc au concept de supra constitutionnalité, et en ce sens, nous comprenons qu’elle est communément appréciée comme une forme de contrainte qui pèse directement sur la Constitution qui en limiterait elle-même la détermination et qui protège également certaine valeur. Les principes supra-constitutionnels procèdent dès lors que la Constitution repose avant tout sur un ordre de valeurs sur lequel se base l’institution même de pouvoirs. En ce sens, le constituant lui- même désigne ce concept de supra constitutionnalité et le défini comme étant tout ce qui est interne et externe à la Constitution, ce qui amène à une certaine fonction de cette dernière qui consiste en une forme d’autolimitation. Dans une certaine mesure, cette fonction de la supra constitutionnalité découle alors du fait que la Constitution se protège elle-même contre elle-même. Ainsi, nous comprenons que les valeurs protégées par ces deux notions sont considérées comme étant le fondement même d’un ordre juridique duquel découle le droit positif et sont dès lors, non si éloignées que l’on pourrait le croire. En conséquent, elles se trouvent à l’abri de toute atteinte à leur intégrité et ceci sous l’égide d’un certain système d’articulation des normes. B) Un système d’articulation des normes favorable à ces dernières Ces deux notions permettent de déterminer l’issue d’un désaccord découlant d’un conflit de normes par voie de conciliation, bien qu’elle soit traditionnellement assez difficile. Ce faisant, ces deux notions peuvent servir de moyen de conciliation en cas de conflits entre deux normes non si antinomiques de par leur objet. L’identité constitutionnelle est souvent conçue comme un moyen de concilier l’ordre juridique interne, qui cherche à défendre les normes constitutionnelles, et l’ordre juridique européen, qui cherche à défendre ses exigences et ceci, sans hiérarchisation. En ce sens il ne serait pas faux de dire que le recours à l’identité constitutionnelle essaye de concilier l’inconciliable en utilisant une méthode tout aussi impensable en ce qu’elle consiste à privilégier une approche consensuelle fondée sur la conciliation matérielle des normes suprêmes. Cependant cette tentative de conciliation dont l’acheminement fut assez laborieux ne fut pas immédiatement acquise. En outre, la mission du juge administratif dans cette méthode de conciliation entre identité constitutionnelle et supra constitutionnalité, qui défendent toutes deux un ordre juridique différent, est cruciale. Traditionnellement, ce dernier étant conçu pour assurer notamment la primauté de la Constitution sur toute autre norme de nature différente, il était dès lors difficile de procéder à cette approche consensuelle fondée sur la conciliation matérielle des normes suprêmes que cherchent à protéger ces deux ordres. A cet égard il convient évidemment de préciser qu’en plus de la constitutionnalisation de l’autorité des directives européennes par l’article 55 et 88-1 de la constitution, uploads/S4/ td-4-dissert-droit-administratif.pdf
Documents similaires






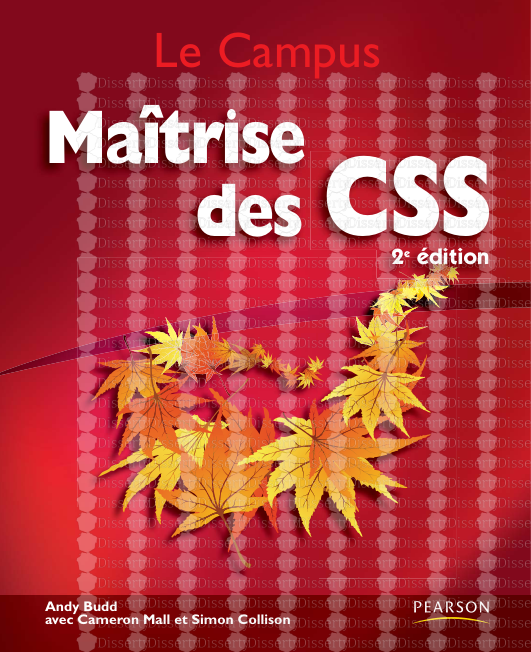



-
79
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 15, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1325MB


