Travaux Dirigés- Droit des sociétés Dissertation: Les clauses léonines Puisant
Travaux Dirigés- Droit des sociétés Dissertation: Les clauses léonines Puisant en la notion de jus fraternitatis en droit romain, les canonistes ont élaboré la nature juridique de la société et l’ont opposé à la société léonine. Cette opposition a permis d’interdire les actes juridiques qui priveraient un associé de sa participation aux bénéfices ou de sa contribution aux pertes conformément au jus fraternitatis. Robert Joseph Pothier écrivait de même « il est de l’essence du contrat de société que les parties se proposent par le contrat, de faire un gain ou un profit », tout en expliquant qu’une convention conférant la totalité des bénéfices à l’un des associés serait « nulle, comme manifestement injuste ». La prohibition des clauses dites léonines s’est alors vu esquisser un régime particulier au fil des siècles qu’il conviendra d’explorer sous tous ses angles. Dans une première approche il convient de définir les termes qui composent le sujet afin de dessiner les contours de cette notion. De manière générale, une clause est une phrase ou un ensemble de phrases contenues dans le texte d'un acte juridique qui définit les droits et les obligations des personnes concernées par cet acte. Notre sujet nous invite à nous pencher sur les clauses léonines où le terme léonin se réfère au latin « part du lion » qui signifie « la meilleure des parts » puisqu’elle s’octroie tous les avantages et n’est pas conforme à la notion d’équité. En effet, le terme léonin ne fait pas référence au célèbre guerrier de la bataille de Thermopyles, le grand Léonidas Ier de Sparte mais bel et bien à la fable de Phèdre reprise par la Fontaine où le lion s’accapare l’entièreté du butin. On ne peut retrouver ce caractère léonin que lors d’un partage de butin. Naturellement, l’idée de butin ne se retrouve qu’en droit des sociétés puisque toute société implique le partage des bénéfices ou des pertes entre associés. Ainsi il a fallu, en vertu du jus fraternitatis, bannir tout acte juridique doté d’un caractère léonin afin de garantir les droits des associés en terme de participations aux bénéfices et de contributions aux pertes. Les rédacteurs du code civil sont donc intervenus afin de prohiber toute pratique d’actes juridiques qui impliquent l’attribution à un seul associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes. Dès lors, l’insertion de clause léonine défini comme étant une clause privant un associé de tout droit aux profits de la société ou lui attribuant la totalité des profits, mettant à sa charge la totalité des pertes ou l’exonérant de toute contribution au passif social s’est vus rigoureusement interdire. L’intérêt d’étudier un tel sujet est à la fois juridique et économique puisqu’étudier la prohibition des clauses léonines sous l’angle de ses caractéristiques spécifiques, de ses fondements, de son évolution dans le temps avec les nouvelles pratiques nous permettra d’analyser ses répercussions économiques et ébaucher un tableau de ses lacunes tout en proposant des réformes judicieuses sur cette notion qui se voit peu à peu éroder avec l’apparition de nouvelles pratiques. Dès lors, se pose la question de savoir si le régime de prohibition des clauses léonines est en phase avec l’apparition des nouveaux mécanismes juridiques actuels. La genèse de la clause léonine date de l’époque romaine où déjà les société léonine, conférant à une seule personne tous les bénéfices d’une société était prohibé. En vertu du jus fraternitatis, les rédacteurs du code civil ont repris ce principe de prohibition de clause léonines en aménageant un régime spéciale. La seule intervention du législateur a permis de modifier la sanction de l’insertion de cette clause litigieuse dans les statuts qui auparavant, même si justifié par la doctrine civiliste, venait paralyser l’effectivité des sociétés en droit français. Bien que la stipulation de clauses permettant l’associé d’échapper à des aléas sociaux soit assez rare, c’est un contentieux tout autre qui s’est vus esquisser de par l’arrivée de nouveaux mécanismes juridiques. En effet, l’appréciation de la validité des promesses d’achat de droits sociaux à prix garanti a fait l’objet d’une évolution jurisprudentiel qu’il conviendra d'étudier. Toutefois, ces solutions encourent naturellement la critique, dans le sens où cette interdiction de clause léonine, même si elle s’est vus assouplir n’est plus en adéquation avec l’évolution du droit actuel lorsqu’on la confronte avec des nouvelles techniques juridiques qui n’existait pas à l’époque des canonistes . Il conviendra donc de proposer une réforme du droit positif. Ainsi, nous verrons dans une première partie comment a été consacré le principe de l’interdiction de stipulations de clauses léonines (I.) avant de nous pencher sur la corrosion du principe dans le temps dû à son frottement avec certaines pratiques, dans le sens où elle se voit peu à peu dépasser avec l’apparition de nouvelles techniques juridiques (II.). I. Le système de la prohibition des clauses léonines Nous étudierons pourquoi la prohibition des clauses léonines reste un pilier du contrat de société (A) avant de nous consacrer à établir la frontière entre les clauses qui sont purement léonines et les clauses qui ne portent pas atteinte au contrat de société (B) A) Un principe fondateur du contrat de société Nous verrons que les fondements de cette interdiction préservent le contrat de société (a) avant d’en étudier ses sanctions qui préservent aussi le contrat de société (b). a) Fondements théoriques du principe de prohibition des clauses léonines L’article 1844-1 actuel du Code civil prohibe les clauses « attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes », ainsi que celles « excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes ». Dès lors, elle exige que les associés se partagent le profit procuré par la société et exige aussi que les associés contribuent aux pertes en vertu d’un fondement légal sous jacent, à savoir l’article 1832 du code civil qui définit la nature de la société tout en exposant ses effets recherchés. C’est dans cette optique que l’article 1844-1 vient donc interdire toute stipulation contraire à la finalité de l’article 1832 du code civil. Une petite critique est ici envisageable quant à l’utilité de l’insertion de l’article 1844-1 dans le code civil puisque cet article ne reprend que la finalité de la société disposé à l’article 1832 du code civil. Ainsi, on peut se demander si les juges ne pouvaient pas baser leur raisonnement sur le fondement de l’article 1832 du code civil. Reléguant la disposition de l’article 1844-1 à une disposition superfétatoire, qualifiable de « poudre de perlimpinpin » Bien que datant de l’époque romaine où naquit l’interdiction de société léonine, cette logique a été repris par les les rédacteurs du Code civil qui définirent la société comme « un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter » . D’instinct, ils en ont déduit que la société devait se voir appliquer tous les principes qui règlent les contrats de droit communs. Ce faisant, le contrat de société doit ainsi reposer sur un principe d’équité qui est la base de tous contrats et sur la bonne foi. De plus, la société est constituée dans l’intérêt commun des parties afin que tous aient vocation aux résultats. Le juriste Jean Baptiste Treihlard exposa dans son discours de présentation sur le projet de Code civil devant le Corps législatif que « c’est là la première règle, la règle fondamentale de toute société », et ajouta « qu’il est contre la nature qu’une société de plusieurs, de quelque espèce qu’on la suppose, se forme pour le seul intérêt d’une des parties ». Ainsi naquit la logique qu’il faut s’unir pour l’intérêt commun des parties qui contractent où l’intérêt commun s’oppose à l’intérêt d’un seul puisque la société est un contrat consensuel, et la loi ne peut voir de consentement véritable dans un contrat de société dont un seul recueillerait tout le profit, et dont l’intérêt commun des partie n’en serait pas la base. Par conséquent, en vertu de ces principes résultèrent la prohibition des clauses privant un ou plusieurs associés des bénéfices, ou exonérant un ou plusieurs associés des pertes. Dès lors, la prohibition de clauses léonines préserve les principes qui régissent du contrat de société, en ces sens où l’intérêt commun des associés est de partager les fruits qui résultent de la création de la société, à savoir les bénéfices. Le tribun Gillet, avant la rédaction du code civil, prononça un discours auquel il avança l’idée que « l’espoir de ce partage est la vue intentionnelle qui dirige ce contrat » . Par conséquent, un contrat de société aux termes duquel un associé ne participerait pas aux bénéfices, ne permettrait pas à associé d’atteindre l’objectif pour lequel il s’est engagé, et ne serait ainsi pas conclu dans l’intérêt de celui-ci. A contrario, les rédacteurs du code civil ont jugé bon, ne vertu du principe de bonne foi et des relations entre associés uploads/S4/ td-ds7.pdf
Documents similaires
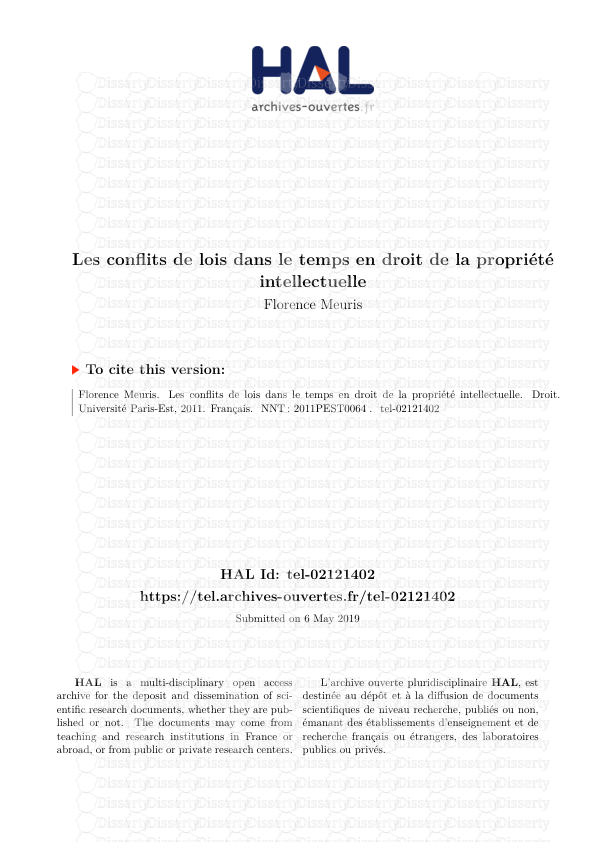









-
96
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 23, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1762MB


