1 2ème année groupe 1 – Droit administratif semestre 2 Eléments de correction S
1 2ème année groupe 1 – Droit administratif semestre 2 Eléments de correction Sujet pratique 1 – Les faits M. Amegboh a été renversé par une vague sur la plage de la grande Anse, située sur le territoire de la commune de Deshaies, en Guadeloupe. Aucune signalisation n’indiquait les dangers encourus sur cette plage pourtant très fréquentée. En outre, les secours n'ont pu être appelés qu’à partir d’une station service éloignée de la plage. La victime a subi un important préjudice corporel, en raison de fractures cervicales. 2 –La procédure M. Amegboh et sa mère, Mme Sabine, ont souhaité engager la responsabilité pour faute de la commune. Mme Sabine est une victime par ricochet : elle a subi indirectement un préjudice moral en raison du handicap de son fils. Ils ont, pour cela, d’abord dû demander une indemnisation à la commune elle-même. De cette demande est née une décision préalable de la commune, nécessaire avant d’intenter toute action en justice. M. Amegboh et sa mère ont alors saisi le tribunal administratif de Basse-Terre. Ce dernier a fait droit à leur demande et a condamné la commune à les indemniser. Il a notamment considéré que la commune avait commis une faute en s’abstenant de mettre en place un dispositif d’alerte à proximité de la plage. La commune a alors fait appel du jugement du TA. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du TA et refusé d’indemniser les requérants, en considérant qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à la commune. M. Amegboh et sa mère se sont alors pourvus en cassation devant le Conseil d’Etat. 3 – la nature du recours dont est saisi le Conseil d’Etat et le type de contentieux Le Conseil d’Etat est ici saisi d’un recours en cassation. L’impétrant se devait, dans le cadre de cette question, développer les grands traits de ce recours tels qu’ils figurent dans le cours de Madame Gonod. Il était aussi possible de relever qu’en l’espèce, après avoir cassé l’arrêt d’appel, le Conseil d’Etat va directement se prononcer au fond, sans renvoyer le contentieux à une autre Cour d’appel, ainsi que l’y autorise l’article L. 821-2 CJA. Dans ce cas, le Conseil d’Etat statue en tant que juge du fond. Le contentieux que le Conseil d’Etat devait juger est un contentieux de pleine juridiction, ou plein contentieux. Il s’agit en effet d’une action en responsabilité, dans laquelle le requérant demande au juge plus que la seule annulation d’une décision litigieuse comme c’est le cas dans un recours pour excès de pouvoir. On rappellera que, dans un contentieux de pleine juridiction, le juge se place à la date du jugement pour trancher le litige, prenant ainsi en compte les changements intervenus dans les circonstances de droit et de faits depuis l’origine du litige. Ce document est strictement réservé aux étudiants du Centre de formation juridique. Document imprimé le 04/05/2018 à 19h43 par Papa Sarr (identifiant:182557 :: email:padiegane@gmail.com :: mdp:marie) 2 4 –La distinction entre police spéciale et police générale La police spéciale peut se caractériser de trois façons différentes : - elle est souvent confiée à une autorité de police différente de celle qui serait normalement compétente en matière de police générale. - elle s’exerce par des procédures spéciales, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques - elle a une finalité différente de la police générale. Alors que cette dernière vise la prévention de l’ordre public (entendu comme la tranquillité, la sécurité, la salubrité, la moralité en cas de circonstances locales et la dignité de la personne humaine), la police spéciale peut viser toute finalité d’intérêt général. En l’espèce, le juge rappelle que le maire cumule un pouvoir de police générale et un pouvoir de police spéciale. Le maire exerce un pouvoir de police générale sur le territoire de sa commune afin d'y assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Cette police s'exerce sur le rivage jusqu'à l'eau. L’article 131-2 du Code des communes rappelle ainsi que « la police municipale compote notamment (…) le soin de prévenir par des précautions convenables (…) les accidents et les fléaux calamiteux », ainsi que de « pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours ». Ces dispositions, qui évoquent clairement la « police municipale » dont le maire à la charge (v. aujourd’hui, art. L. 2212-2 CGCT), se réfèrent à un aspect de la mission de sécurité publique, composante traditionnelle de l’ordre public et but de la police générale. Un pouvoir de police spéciale des baignades en mer est en outre attribué aux maires des communes littorales. Cette police s'exerce en mer jusqu'à 300 mètres à compter de la limite des eaux à l'instant considéré. Cette police spéciale vise la sécurité des lieux de baignade. C’est ce que rappelle l’ex- article 131-2-1 du Code des communes. Cette police du maire est une police spéciale de par son objet (la baignade) et du fait de l'espace très spécifique sur lequel elle se déploie (l’espace maritime jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Elle est pourtant très proche d’une police générale, en raison de son but et de l’autorité compétente. En effet, cette police est confiée à la même autorité que l’autorité de police générale, à savoir le maire. En outre, elle vise le même but que la police générale, en l’occurrence la protection de la sécurité publique. Suivant cette distinction, c’est bien son pouvoir de police spéciale qu’aurait du mettre en œuvre le maire. Le juge considère en effet que le maire aurait du prévenir tout accident en édictant « les mesures appropriées en vue d’assurer la sécurité des baigneurs ». La mesure que le maire devait édicter concernait donc bien l’espace géographique délimitant le pouvoir de police spéciale. 5 – La responsabilité de la commune Dans les cinquièmes et sixièmes considérants reproduits, le juge se prononce sur la responsabilité de la commune. Il considère que cette dernière est entièrement responsable des dommages subis par M. Amegboh et sa mère. Pour ce faire, le juge avait déjà caractérisé le dommage des requérants (le handicap du fils, le préjudice moral de la mère, indemnisable depuis CE, 1961, Letisserand). Il considère surtout que ces préjudices sont la conséquence directe d’une faute de la commune. Cette faute résulte de la carence du maire dans l’exercice Ce document est strictement réservé aux étudiants du Centre de formation juridique. Document imprimé le 04/05/2018 à 19h43 par Papa Sarr (identifiant:182557 :: email:padiegane@gmail.com :: mdp:marie) 3 de son pouvoir de police (A). Elle est de nature à engager la responsabilité de la commune (B). A – Une faute résultant de l’abstention de l’autorité de police Selon le juge, le fait pour la commune de ne pas prendre les mesures de signalisation des dangers qui excèdent ceux contre lesquels les usagers doivent normalement se prémunir est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique. Les autorités de police ont en effet une obligation d’action, qui leur impose de prendre toute mesure utile pour prévenir une atteinte à l’ordre public (CE, 1959, Doublet). En l’espèce, le maire s’est abstenu d’agir et a ainsi commis une illégalité fautive. Cette faute, bien que commise par un agent du service, demeure une faute de service, et non une faute personnelle du maire : elle a été commise dans l’exercice des fonctions du maire, et est en tout état de cause rattachable au service (TC, 1873, Pelletier). B – Une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Le juge relève que la faute de l’autorité de police n’est qu’une faute « simple » (il n’utilise pas le qualificatif de faute « lourde »). Cette simple faute suffit à engager la responsabilité de la commune. On sait en effet qu’en matière d’activité de police, les missions qui ne présentent aucune difficulté engagent la responsabilité du service pour faute simple. Ce n’est que quand la mission présente une difficulté particulière que le juge exige un faute lourde pour engager la responsabilité de la puissance publique (CE, 1972, Marabout). En outre, cette faute est la cause directe du préjudice subi. Il n’existe pas en l’espèce de cause d’exonération : le juge relève en effet « l’absence de toute imprudence établie de la victime ». Il n’ya donc pas de faute de la victime susceptible d’atténuer la responsabilité de la commune. Ce document est strictement réservé aux étudiants du Centre de formation juridique. Document imprimé le 04/05/2018 à 19h43 par Papa Sarr (identifiant:182557 :: email:padiegane@gmail.com :: mdp:marie) 4 Sujet théorique : Dissertation Le recours pour excès de pouvoir est-il toujours un recours « original » ? Analyse du sujet Ce sujet de dissertation ne reprend la forme classique des sujets de Madame Gonod, à savoir des sujets courts, précis et non problématisés. Pour une fois, le sujet prend la forme interrogative et pose directement une question à l’étudiant. Mais, comme d’habitude, la dissertation est plutôt difficile d’accès afin d’orienter les étudiants vers le commentaire d’arrêt. Le sujet concernait le contentieux uploads/S4/2-annee-groupe-1-droit-administratif-semestre-2-elements-de-correction.pdf
Documents similaires
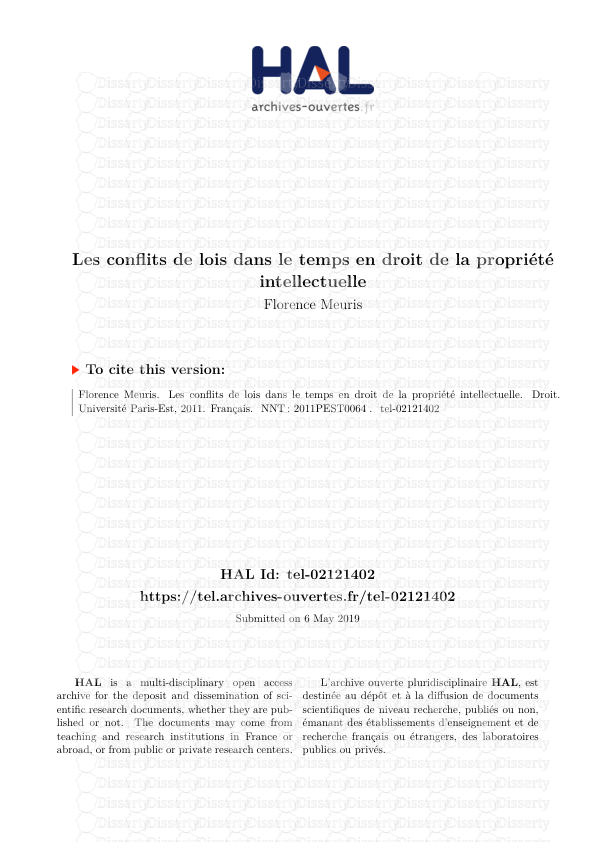









-
66
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 11, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.0425MB


